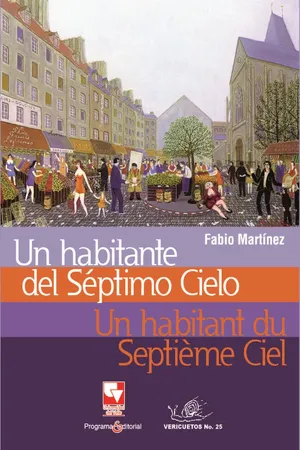
This is a test
- 168 páginas
- Spanish
- ePUB (apto para móviles)
- Disponible en iOS y Android
eBook - ePub
Detalles del libro
Vista previa del libro
Índice
Citas
Información del libro
Fabio Martínez mezcla en su marmita belleza y sordidez. Los cuatro ciclos del libro: Verano, Otoño, Infierno (donde los personajes pasan una rimbaldiana temporada) y Primavera, forman un fresco de esa ciudad tantas veces mitificada. (Juan Manuel Roca)
Preguntas frecuentes
Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.
Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.
Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.
Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.
Sí, puedes acceder a Un habitante del Séptimo Cielo de Fabio Martínez, Yves Moñino en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Letteratura y Letteratura generale. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.
Información
AUTOMNE
Le ciel en automne est une gelée sirupeuse qui se décompose au cours de l’après-midi comme une mélodie de John Cage ; une spatule de cristal n’en finit pas de passer un bleu intense en le mélangeant avec du turquoise et du magenta. Si tu étais au Trocadéro ou au dernier étage de la tour Montparnasse, tu pourrais voir les traînées de taches immenses qui s’étirent aux quatre coins de la ville On dit pourtant que c’est la saison des amants, le temps rêvé pour écrire de la poésie. La lumière est idéale, d’une couleur ténue, cuivrée, qui glisse tous les jours, silencieuse comme un serpent, sur la brume épaisse qui se concentre dans les rues. Mais peu importe qu’il soit midi ou que le jour se lève: au milieu de ce spectacle de couleurs intenses qu’est l’automne, il y a toujours un fil noir et invisible qui se déplace, et le pire est que tu ne t’en rends pas compte.
Le matin, il bruine parfois comme une rosée qui trempe le visage des passants et mouille les rues et les trottoirs ; il y a des jours où le soleil se montre et essaie de décongeler cette masse de brouillard qui transforme Paris en une voûte funèbre, mais à mesure que le temps passe, le « Beau Blond » réchauffe de moins en moins et perd de son pouvoir, plongeant la ville dans une grisaille déprimante qui te corrode par dedans. À partir de là, tout va dépendre de toi. Ou tu t’enfonces dans la ville en t’abandonnant à cette masse de brume, ou tu émerges à la surface avec l’adresse et la patience du bon plongeur. Mais ces choses-là ne sont jamais aussi évidentes qu’on le croit ou qu’on le désire. Quelquefois, tu es en bas et tu te sens pourtant heureux, sans problèmes ; ou alors tu es tout en haut, au paradis, et tu éprouves soudain une sensation désagréable de dégoût et d’aversion envers toi-même ; tu découvres le pire en toi et tu te rends compte que tu es l’homme le plus malheureux de la terre. Mais ce n’est même pas ça, le plus terrible ; le pire est que tu ignores l’origine de ta haine, de ta difficulté à être, et que tu ne sais pas à qui l’attribuer. Tu sens à chaque instant cette petite bête qui te travaille en dedans, et pourtant tu ne sais pas pourquoi ni depuis quand elle agit en toi ; tu ne peux pas dire si tu l’avais avant d’arriver ici ou si tu viens de l’attraper dans ce lieu où tu désires vivre et faire ta vie même si tu ne connais personne et qu’au début tout paraissait neuf et attrayant.
Un peu par hasard, l’automne a signifié, pour Andrés et pour moi, le début d’une séparation inévitable. Par ailleurs, la cité devenait froide et hostile envers nous, et au lieu de nous inciter à nous rencontrer quelque part, elle nous éloignait chaque jour davantage, nous abandonnant à notre sort et au cours incertain que prenaient les jours. La solitude et le désarroi se livraient à la triste besogne de nous voler notre énergie, et nous laissaient dans un état de désolation rendu encore plus pesant dans cette chambra5 du Septième Ciel où le silence était si fort que même les mouches laissées par le dernier locataire s’étaient enfuies, effrayées, pour ne plus revenir.
C’était un endroit sordide, peu lumineux, avec des murs épais et écaillés d’où émanait encore l’odeur pestilentielle de l’ancien locataire ; il n’y avait pas d’eau, ni de waters et, quand on avait envie d’uriner la nuit, mieux valait pisser par la fenêtre pour éviter l’obscur couloir où se trouvaient les « turcs », un lavabo et trente-cinq chambres numérotées comme celles des asiles.
Dans le corridor, l’alignement de portes de la même couleur évoquait un hôpital où les malades vivent enfermés, ne sortant qu’en cas de ras-le-bol ou de nécessité urgente. On se croisait le matin devant les « turcs » où il y avait toujours la queue, ou dans l’escalier en colimaçon sale et noirci par la crasse. Le reste du temps, on ne voyait âme qui vive dans le couloir, rien que la succession infinie des portes numérotées, qui observées depuis n’importe quel angle, produisaient une sensation désagréable de vide et de solitude, comme si personne n’habitait ce lieu ou qu’il était hanté par des fantômes.
J’ai débarqué là par un matin froid et ensoleillé d’octobre. Les feuilles d’arbres qui jonchaient l’asphalte formaient un tapis épais sur lequel il faisait bon marcher. La concierge m’avait remis les clés en alléguant une vieille maladie qui l’importunait juste à ce moment-là, et elle m’avait laissé devant une porte grise, sur laquelle un panneau indiquait :
« ESCALIER DE SERVICE »
et plus bas, d’un tracé flou et décoloré, la lettre
« C »
Les premiers jours ont été tranquilles, sans qu’aucun événement ne vienne rompre le cours des choses. Je restais toute la journée dans la chambra, m’habituant au lieu et m’appropriant ce nouvel espace de vie, mon domicile fixe comme le disait le contrat. J’apprenais à reconnaître les nouveaux objets qui m’entouraient, les odeurs et les humeurs entrant du corridor quand je sortais pour aller aux waters ou descendre faire les courses ; les voix et certain bruit particulier que je ne connaissais pas encore, mais que la force de l’habitude et les visites répétées aux « turcs » m’ont permis d’identifier. Assis à une table récupérée dans la rue, je passais des heures entières à écrire des lettres à ma mère et à mes amis les plus chers, leur racontant par le menu ma première journée en France, les longues et harassantes promenades dans Paris en compagnie d’Andrés, qui était considéré depuis toujours comme un membre de plus de la famille Velásquez, nos aventures et mésaventures (en exagérant les premières), et surtout, dans ces lettres entre les plis desquelles j’insérais des feuilles d’automne et des billets d’entrée aux musées, je me délectais en leur décrivant, savamment et avec habileté, ma nouvelle résidence en France.
« Chère maman,
J’habite maintenant au septième étage, dans une chambre prêtée, moquette, électricité, eau chaude et froide, charges comprises. Je m’offre le luxe de faire mes besoins —comme disent les gens guindés lorsqu’ils sont à table —, dans une chiotte en porcelaine chinoise qui se nettoie par l’action de l’énergie électrique. En ce moment même, je trône en ce lieu sublime où je puise mon inspiration et me souviens des moments les plus heureux de ma vie.
Il va sans dire que pour moi, la cuvette des waters a toujours été une source de vie, où de grands projets ont été cogités et de grandes affaires mises sur pied ; les crimes les plus horribles ont été prémédités dans ce lieu obscur, les passions les plus perverses y ont éclos. Les arguments les plus sérieux et convaincants, les plus sincères surtout, c’est dans les WC publics que je les ai lus.
Là, en cet endroit, j’ai compris la profonde affection que « Pajarito » éprouvait pour ses élèves ; j’ai su que María, la marchande de groseilles, s’offrait pour dix pesos et si tu lui plaisais, pour rien ; j’ai pris connaissance de la liste de ceux qui avaient dénoncé (ils étaient tous dessinés sur un papier avec lequel on s’était torché le cul), j’y ai fumé de l’herbe et lu Kafka pour la première fois.
Maintenant, c’est différent. Je suis assis « en train d’étrenner », comme on dit à Cali quand on assiste à une première, les fesses bleuies de froid et voyant défiler les films du moment. Près de moi, le papier hygiénique « Lotus » et un spray pour préserver l’environnement, en cas de mouches… Des journaux, le Petit Larousse de poche et quelques bouquins de science fiction.
Peut-être que maintenant j’assume une attitude plus intellectuelle, mais la position est toujours la même ; je m’assieds, j’ouvre une page pour me distraire et mon cinéma intérieur se déclenche. C’est comme l’oracle des dieux : la posture est d’abord sereine, à prier et implorer, cela va croissant jusqu’au moment le plus intense et plouf ! C’est là que je dis que la muse m’attrape, l’inspiration, la Merde Majuscule, et on attend la paix.
Ton fils qui t’aime,
Román »
Je ne racontais pas tout ce qui m’arrivait, et si quelque chose pouvait leur paraître étrange, je le présentais comme un fait normal et même amusant, comme l’affaire des WC électriques. S’ils avaient su que ces prétendus waters électriques n’étaient qu’un trou vidé par une chasse qui faisait un boucan aussi terrible que le cri d’un pendu ! Je ne disais rien de mes repas, ni de mes errances dans le quartier d’Henry Miller, ni des dimensions de ma chambre, et encore moins de mes nouvelles fréquentations…
Quand les lettres m’interrogeaient sur la bonne table française et sur mes possibilités d’accès à son excellente nourriture, j’empruntais illico un paragraphe à l’Irlandais et le transcrivais textuellement :
« Monsieur Léopold Bloom se nourrissait avec délectation des organes internes des mammifères et des oiseaux. Il aimait une épaisse soupe d’abatis, les gésiers au goût de noisette, un cœur rôti avec sa farce, des tranches de foie frites dans la chapelure, des œufs de morue rissolées. Par-dessus tout il aimait les rognons de mouton au gril qui flattaient ses papilles gustatives d’une belle saveur au léger parfum d’urine. » 6
Ma mère lisait tout cela et elle adorait. « Tu es un peu fou, me disait-elle dans une de ses lettres, mais je t’en prie, étudie et profite bien de ton séjour à Paris ».
« Il avait des rognons en tête tandis qu’il allait et venait sans bruit… Dans la cuisine un air froid, une clarté froide, mais dehors une douce matinée d’été partout répandue. Et ainsi, il commençait à se sentir le ventre creux. » 7
Au bout d’un mois exactement que j’étais là, tout mon corps a commencé à se couvrir de boutons. En devisant un matin avec le vieux peintre de la chambra d’en face, je les ai découverts pour la première fois. C’étaient des sortes de boules de suif, dures et compactes, qui apparaissaient et se répandaient partout. Au début, j’ai eu peur, j’ai imaginé le pire. Tumeurs, cancer, furoncles. Au restaurant universitaire, j’avais connu le cas d’un gars jeune et allègre qui avait dû quitter Paris pour la même raison, et cela me rendait complètement parano. Mais le restau U. bruissait toujours de rumeurs variées, et la majorité de ces rumeurs étaient comme les tumeurs : malignes. J’y ai entendu par exemple que Dany avait été arrêté avec de la « marchandise » au moment où il tentait de traverser la frontière franco-allemande ; d’autres disaient que ce n’était pas Dany qu’on avait pincé mais Ángel Nieves ; Dany, commentait-on, était à l’abri depuis quinze jours à La Santé. En vacances.
Je me suis palpé un des boutons, je l’ai senti très dur mais indolore.
—Ça fait mal ? me disait le peintre, qui trempait une biscotte dans sa tasse de café.
—Non, mais j’ai une sensation bizarre, comme de la gelée.
—Bon, si ça ne vous fait pas mal, ce n’est pas si grave ; la voisine d’à côté a quelque chose de bien pire.
—Qui donc ? ai-je demandé.
—Angustias, l’Espagnole. Cela fait un an qu’elle a une tumeur au sein gauche et le médecin lui dit de se faire opérer parce que c’est une tumeur maligne.
—Et comment vous savez ça ?
—C’est elle-même qui me l’a raconté un soir…
Tout à sa tasse de café, le peintre léchait ses moustaches dégoulinantes de beurre, trempait une autre biscotte et l’engloutissait avec un plaisir surprenant. Il a fini par venir à bout de tout le paquet de biscottes que j’avais chouré au « Félix Potin ».
La vie au Septième Ciel commençait à me dégoûter. Chaque événement qui y survenait commençait à perdre son sens, comme si j’étais en dehors de tout et que rien ne m’affectât, pas même des situations qui lésaient ma propre intégrité physique, comme les fameuses queues devant les « turcs », ou les ordures que les gens, par flemme de les descendre, laissaient s’amonceler dans les coins. Se lever et savoir que pour prendre une douche il fallait faire une queue qui ne diminuait que vers neuf ou dix heures du matin, était si désagréable que cela ôtait l’envie de se laver et mettait de mauvaise humeur pour la journée. La crasse et ces foutus sacs d’ordures qui pourrissaient dans les couloirs du fait de la négligence de leurs auteurs te détraquaient les nerfs et te mettaient en mauvais termes avec tout le monde ; mais le pire était que ce laisser-aller était contagieux comme le sida : tu l’attrapais un beau jour sans t’en apercevoir et quand tu en ressentais les symptômes, il n’y avait plus rien à faire. Tout, autour de toi, provoquait un ras-le-bol, les gens, la nourriture, les voisins ; tu détestais te réveiller avec la certitude qu’à huit heures pile du matin, le peintre allait frapper à ta porte pour quémander une cuillerée de sucre ou de café ; tu savais qu’il ne s’agissait que d’un prétexte pour se faire inviter au petit-déjeuner, vu que lui n’avait jamais rien à manger dans sa porcherie, pas même un simple réchaud pour faire un café ou cuire deux œufs. Se doucher aux « turcs » ? Ça faisait une paye que tu y avais renoncé en faveur des bains publics, où on se lave pour cinq francs (en apportant le savon et la serviette), mais c’était casse-pieds de descendre tous les jours avec son bout de savon et sa serviette sous le bras ; d’autant qu’à cette époque il faisait bien froid, et que ne pas se l...
Índice
- Portada
- Título
- Derechos de autor
- Verano
- Été
- Otoño
- Automne
- Infierno
- Enfer
- Primavera
- Printemps