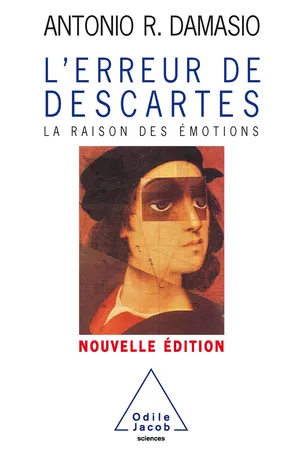Une mystérieuse constellation
Dans la première partie de ce livre ont été décrits des déficits dans les domaines du raisonnement et de la prise de décision. Les recherches chez les patients qui en sont atteints ont donc conduit à l’identification d’un ensemble particulier de systèmes neuraux qui se trouvent toujours lésés chez eux. Elles ont aussi mis en lumière une série apparemment disparate de processus neuropsychologiques dépendant de l’intégrité des systèmes neuraux en question. On peut se demander en premier lieu quelle nécessité relie ces différents processus entre eux, et ensuite quelle raison explique qu’ils dépendent des systèmes neuraux mis en évidence dans le chapitre précédent. Les paragraphes suivants tentent d’y apporter des réponses provisoires.
Considérons d’abord les problèmes personnels qui se posent classiquement dans un environnement social, lequel est toujours complexe et d’évolution incertaine. Arriver à une décision, dans ces conditions, demande de posséder des informations relevant de toutes sortes de domaines, et d’être en mesure de leur appliquer certaines stratégies de raisonnement. Les informations en question doivent porter sur les choses, les personnes et les situations rencontrées dans le monde externe. Mais dans la mesure où les décisions dans les domaines personnel et social sont inextricablement liées à la survie, ces informations doivent aussi comprendre des données concernant la régulation de l’organisme en tant que tout. Les stratégies de raisonnement, quant à elles, doivent envisager des objectifs à atteindre, des séries d’actions alternatives, des prédictions sur l’avenir, des programmes d’application des décisions sur des échelles de temps plus ou moins vastes.
Deuxièmement, les processus d’expression et de perception des émotions font partie des mécanismes neuraux desservant la régulation de l’organisme, lesquels comprennent notamment des mécanismes homéostatiques, des instincts et des pulsions.
Troisièmement, étant donné la façon dont est organisé le cerveau, les informations nommées ci-dessus dépendent de nombreux systèmes neuraux siégeant dans des régions cérébrales relativement séparées, et non pas dans une seule. Une grande partie de ces informations est rappelée à la mémoire sous la forme d’images distribuées entre de nombreux sites cérébraux, et non pas en un seul. Bien que nous ayons l’impression d’un seul théâtre mental pour ces images, des données récentes indiquent que celui-ci est formé de nombreuses parties distinctes. C’est probablement la relative simultanéité des processus se déroulant à leurs différents niveaux qui conduit à une impression d’unité.
Quatrièmement, puisque les informations ne peuvent être rappelées à la mémoire que sous forme distribuée, en des sites relevant de nombreux systèmes parallèles, les stratégies de raisonnement ne peuvent leur être appliquées que si leurs représentations y sont maintenues présentes pendant des périodes de temps prolongées (au minimum, plusieurs secondes). En d’autres termes, les images sur lesquelles nous raisonnons (images d’objets spécifi ques, schémas d’actions et diagrammes de relations, ainsi que leur traduction sous forme de mots) doivent non seulement occuper le centre du champ mental – ce qui est obtenu grâce aux mécanismes neuraux de l’attention – mais doivent y être maintenues plus ou moins longtemps – ce qui est obtenu grâce aux mécanismes d’une mémoire de travail perfectionnée.
Je soupçonne que la mystérieuse constellation de processus que nous avons mise en évidence dans le chapitre précédent découle en partie de la nature des problèmes que l’organisme essaie de résoudre, et en partie de la façon dont est organisé le cerveau. Les décisions dans les domaines personnel et social comportent de nombreuses incertitudes, et ont des conséquences directes ou indirectes sur la survie. Elles ont donc besoin d’être fondées sur un vaste répertoire d’informations relatives aussi bien au monde externe qu’au monde interne. Cependant, puisque le cerveau rappelle ces informations de façon spatialement distribuée, et non pas de façon intégrée, il est nécessaire qu’interviennent les processus de l’attention et de la mémoire de travail, de telle sorte que les représentations, sous la forme desquelles sont rappelées les informations, puissent être manipulées durant une certaine période de temps.
Quant à la raison pour laquelle les systèmes neuraux que nous avons identifiés se recoupent de façon aussi étroite, je soupçonne que l’explication en réside dans les nécessités évolutives. Admettons que les processus de régulation biologique fondamentale de l’organisme orientent de façon déterminante les comportements exprimés dans le domaine social et personnel. Dans ces conditions, il est probable que la sélection naturelle a dû favoriser une organisation du cerveau dans laquelle les systèmes impliqués dans le raisonnement et la prise de décision sont étroitement interreliés avec ceux qui sous-tendent la régulation biologique, puisque ces deux catégories de processus neuraux sont impliquées dans les impératifs de la survie.
Les explications avancées ci-dessus apportent, dans leurs grandes lignes, des premières réponses approximatives aux questions posées par le cas de Phineas Gage. Quels sont les mécanismes permettant à l’homme de se comporter de façon raisonnable ? Comment fonctionnent-ils ? Je résiste généralement à la tentation de résumer l’ensemble des réponses que l’on peut faire à ces questions, par l’expression : « neurobiologie de la faculté de raisonnement », parce que cela peut paraître académique et prétentieux, mais pourtant, c’est bien de cela qu’il s’agit : les prémisses d’une neurobiologie de la faculté qu’a l’homme de raisonner, reposant sur l’étude de systèmes neuraux impliquant de vastes régions du cerveau.
Mon objectif dans la seconde partie de ce livre est d’essayer de voir si les grandes lignes des explications avancées ci-dessus sont plausibles, et d’en tirer une hypothèse pouvant être mise à l’épreuve. Comme la discussion de cette question peut se développer à l’infini, je me restreindrai à quelques sujets bien choisis, de façon à bien faire comprendre mes idées.
Ce chapitre représente un pont entre les faits rapportés dans la première partie et les interprétations que je vais proposer ensuite. Je vous invite à le passer avec moi (j’espère que vous ne le prendrez pas comme une interruption), car ce chapitre vous permettra de vous familiariser avec des notions auxquelles je ferai souvent appel (telles que : organisme, corps, cerveau, comportement, fonctionnement mental, état) ; il y sera discuté brièvement des bases neurales sous-tendant le traitement des informations énumérées ci-dessus, pour souligner qu’il porte essentiellement sur des images et s’effectue en de nombreuses régions du cerveau séparées les unes des autres ; des commentaires sur le développement du système nerveux seront enfin présentés. J’éviterai l’exhaustivité (par exemple, il aurait pu être utile de discuter de l’apprentissage ou de la fonction du langage ; mais ni l’un ni l’autre de ces sujets ne sont indispensables pour le but que je me suis fixé ici) ; je ne traiterai aucune des questions envisagées sous la forme du « manuel scolaire » ; et je n’essaierai pas de justifier chacune des opinions que je présenterai. Rappelez-vous que ce livre cherche à se présenter sous la forme d’une conversation.
Les chapitres suivants retourneront à notre sujet principal et s’attaqueront aux problèmes de la régulation biologique, à la façon dont elle implique l’expression et la perception des émotions, ainsi qu’à la question des mécanismes par lesquels la capacité d’expression des émotions peut contribuer à ceux de la prise de décision.
Avant d’aller plus loin, je voudrais répéter quelque chose que j’ai déjà dit dans l’introduction. Ce livre obéit au modèle du voyage de découverte jamais terminé, et non pas à celui du recensement des faits admis par tout le monde. Je présente ici des hypothèses et leur mise à l’épreuve, non pas un catalogue de certitudes.
De l’organisme, du corps et du cerveau
Quelle que soit la question que l’on se pose au sujet de l’homme (comme, par exemple, qui sommes-nous et pourquoi sommes-nous ainsi ?), on peut partir du fait certain que nous sommes des organismes vivants complexes, possédant un corps proprement dit (que j’appellerai « corps », en bref) et un système nerveux (que j’appellerai « cerveau », en bref). Autrement dit, lorsque je mentionnerai le corps, cela désignera le corps moins le système nerveux (lequel comprend une partie centrale et une partie périphérique), bien que, dans un sens traditionnel, le cerveau fasse aussi partie du corps.
L’organisme est caractérisé par une structure et possède un très grand nombre de composantes. Il comprend un squelette formé de nombreuses pièces, qui sont reliées entre elles par des articulations et sont mises en mouvement par des muscles. Il comporte de nombreux organes, dont les combinaisons forment des systèmes. Il présente une limite externe, qui, le plus souvent, est constituée par la peau. Dans certains cas, je désignerai les organes – vaisseaux sanguins, peau, organes localisés dans la tête, la poitrine ou l’abdomen – par le terme de « viscères ». Là encore, dans le sens traditionnel, on inclurait le cerveau sous ce vocable ; mais ce ne sera pas le cas ici.
Chaque organe est constitué de tissus, qui sont à leur tour constitués de cellules. Chacune de ces dernières est formée de très nombreuses molécules, dont les arrangements variés déterminent le squelette de la cellule (ou cytosquelette), ou bien ses organes internes (noyau et divers organites), ou bien sa limite externe (la membrane cellulaire). La structure et le fonctionnement d’une seule de ces cellules sont d’une complexité impressionnante ; et la structure et le fonctionnement d’un seul des systèmes d’organes du corps sont d’une complexité vertigineuse.
Les états de l’organisme
Dans la discussion qui va suivre, il sera souvent fait référence à des « états du corps » ou des « états du fonctionnement mental ». Les organismes vivants sont continuellement en train de changer, passant par une série d’« états » : chacun de ces derniers correspond à une configuration dans laquelle les diverses composantes de l’organisme présentent un niveau d’activité donné. Vous pouvez vous représenter cette figure à l’image d’une scène où seraient en cours toutes sortes de mouvements de gens et d’objets, au sein d’une aire circonscrite. Imaginez que vous vous trouviez dans un grand terminal d’aéroport, et que vous regardiez autour de vous, à l’intérieur et à l’extérieur. Vous verriez et entendriez l’animation constante due à de nombreux processus : les personnes embarquant dans les avions ou en descendant ; d’autres se promenant ou, au contraire, marchant dans un but déterminé ; les avions roulant sur la piste ou en train de décoller ou d’atterrir ; les mécaniciens et les porteurs de bagages accomplissant leur tâche. Imaginez à présent que la scène soit enregistrée par un magnétoscope et que vous fassiez un arrêt sur une image lors de la relecture ; ou que vous ayez pris une photo grand-angle de tout le spectacle se déroulant sous vos yeux. Ce que vous observeriez ainsi sur l’image vidéo arrêtée ou sur le cliché grand-angle, serait l’image d’un état, une tranche de vie instantanée, révélant ce qui était en train de se passer dans les divers organes d’un vaste organisme, dans le bref intervalle de temps défini par la vitesse de prise de vue. (En réalité, les choses sont un peu plus complexes que cela. Selon le niveau auquel se place l’analyse, les « états » d’un organisme peuvent représenter des unités distinctes ou être enchaînés de façon continue.)
Le corps et le cerveau interagissent : l’unité interne
Le cerveau et le corps forment une unité indissociablement intégrée, par le biais de circuits neuraux et biochimiques, où les messages sont acheminés aussi bien dans un sens que dans l’autre. Il existe deux voies principales d’interconnexion. Celle à laquelle on pense généralement, en premier lieu, est représentée par les nerfs périphériques sensoriels et moteurs, les uns apportant au cerveau les messages en provenance de tout le corps, et les autres acheminant à toutes les parties du corps les messages provenant du cerveau. L’autre voie, à laquelle on pense moins facilement, bien qu’elle soit évolutivement plus ancienne, est constituée par la circulation sanguine ; celle-ci achemine des messages chimiques, tels que des hormones, des neurotransmetteurs et des modulateurs.
Un résumé même simplifié des relations entre cerveau et corps montre à quel point celles-ci sont complexes :
1. Pratiquement toutes les parties du corps (muscles, articulations et organes internes) peuvent envoyer des messages au cerveau, via les nerfs périphériques. Ces messages entrent dans le système nerveux au niveau de la moelle épinière ou du tronc cérébral, et sont ensuite acheminés de relais en relais, jusqu’au cortex somatosensoriel du lobe pariétal et de l’insula.
2. Les substances chimiques issues de l’activité du corps peuvent atteindre le cerveau par voie sanguine et influencer son fonctionnement, soit directement, soit indirectement, en stimulant des sites cérébraux particuliers, comme, par exemple, l’organe subfornical.
3. Dans la direction opposée, le cerveau peut agir, via les nerfs, sur toutes les parties du corps. Ces actions sont médiées par le système nerveux autonome (ou viscéral) et par le système nerveux musculosquelettique (ou volontaire). Les messages empruntant le système nerveux autonome proviennent de régions évolutivement anciennes (l’amygdale, le cortex cingulaire, l’hypothalamus et le tronc cérébral), tandis que les messages empruntant le système musculosquelettique proviennent de plusieurs cortex moteurs ou noyaux subcorticaux, d’âges évolutifs variés.
4. Le cerveau agit aussi sur le corps en élaborant ou en commandant l’élaboration de substances chimiques libérées dans la circulation sanguine, telles que des hormones, des neurotransmetteurs et des modulateurs. J’en dirai plus au sujet de ces diverses substances dans le prochain chapitre.
Lorsque je déclare que le corps et le cerveau forment une unité organique indissociable, je n’exagère pas. En fait, je simplifie plutôt. Car le cerveau reçoit des messages non seulement de tout le corps, mais aussi, à certains niveaux, de quelques-unes de ses propres régions, lesquelles reçoivent des messages du corps ! L’unité organique constituée par le partenariat corps-cerveau interagit en tant que tout avec l’environnement, l’interaction n’étant le fait ni du corps seul, ni du cerveau seul. Mais des organismes complexes tels que les nôtres ne se bornent pas à simplement réagir, à simplement exprimer ces réponses spontanées ou réflexes, que l’on appelle du nom générique de « comportements ». Ils donnent également lieu à des réponses internes, dont certaines constituent les images (visuelles, auditives, somatosensorielles, etc.) que je postule être à la base du fonctionnement mental.
Du comportement et du fonctionnement mental
De nombreux organismes simples, et même ceux formés d’une seule cellule et ne possédant pas de système nerveux, manifestent des activités spontanées, ou bien des activités répondant à des stimuli de l’environnement ; autrement dit, ces organismes réalisent des comportements. Certaines de ces activités concernent l’organisme lui-même, et peuvent être invisibles à l’observateur (comme, par exemple, une contraction au sein d’un organe interne) ou bien être observables de l’extérieur (comme une secousse musculaire, ou l’extension d’un membre). D’autres activités mettent en jeu l’environnement (ramper, marcher, tenir un objet). Mais chez quelques organismes simples et chez tous les organismes complexes, les activités, qu’elles soient spontanées ou qu’elles répondent à des stimuli, sont provoquées par des commandes du système nerveux central (il faut noter, en passant, que les organismes dépourvus de système nerveux central, mais capables de mouvement, ont précédé, puis ont coexisté avec, les organismes dotés de système nerveux central).
Toutes les actions commandées par le système nerveux central ne sont pas forcément volontaires. Au contraire, on peut tenir pour assuré que la plupart des actes que l’on dit commandés par le système nerveux central, en train d’être réalisés de par le monde, ne sont pas du tout volontaires. Ce sont simplement des réponses, à l’instar du réflexe le plus simple : un stimulus est acheminé par un neurone vers un autre neurone, lequel déclenche une action.
À mesure que les organismes ont acquis une plus grande complexité, les actions déclenchées par le système nerveux central ont nécessité davantage d’étapes de traitement intermédiaires. Des neurones supplémentaires ont été interposés entre le neurone recevant le stimulus et le neurone délivrant la réponse, et divers circuits parallèles ont été ainsi mis en place ; mais on ne peut pas dire pour autant que les organismes dotés de ces systèmes nerveux centraux plus complexes ont été immédiatement caractérisés par un fonctionnement mental. Un système nerveux central peut posséder de nombreuses étapes intermédiaires au sein des circuits menant du stimulus à la réponse, et néanmoins ne pas présenter de fonctionnement mental, s’il ne remplit pas une condition essentielle : l’aptitude à former des images internes, et à organiser celles-ci en un processus que nous appelons « pensée » (il ne s’agit pas seulement d’images visuelles ; ce sont également des « images » auditives, olfactives, etc.). Ma description des organismes capables de comportement peut donc maintenant être complétée par la remarque suivante : ils ne sont pas tous dotés d’un fonctionnement mental, c’est-à-dire qu’ils ne présentent pas tous des phénomènes mentaux (ce qui est la même chose que de dire qu’ils ne sont pas tous capables de processus cognitifs). Certains organismes sont caractérisés à la fois par la capacité de réaliser des comportements et par une capacité cognitive. D’autres organismes sont capables d’actions « intelligentes », mais n’ont aucun fonctionnement m...