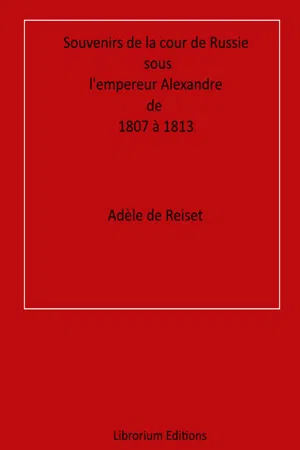
eBook - ePub
Souvenirs de la cour de Russie sous l'empereur Alexandre, de 1807 à 1813
This is a test
- 300 pages
- French
- ePUB (adapté aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Souvenirs de la cour de Russie sous l'empereur Alexandre, de 1807 à 1813
Détails du livre
Aperçu du livre
Table des matières
Citations
À propos de ce livre
1807!... glorieuse époque!... Oh! quel est celui d'entre nous qui ne sent pas son cur battre d'un noble orgueil en reportant sa mémoire vers ce temps à jamais célèbre, où le nom Français, semblable aux magiques talismans des siècles chevaleresques, faisait courber les plus hauts fronts et fléchir les plus opiniâtres volontés! Napoléon ne pouvait plus monter désormais; debout sur l'immense piédestal que son génie militaire et politique avait construit à force de conquêtes et d'habileté, il montrait à l'Europe, humiliée de tant d'audace, sa majestueuse figure dominant de toute la puissance colossale d'un héroïsme excentrique, les figures homériques dont elle était environnée.
Foire aux questions
Il vous suffit de vous rendre dans la section compte dans paramètres et de cliquer sur « Résilier l’abonnement ». C’est aussi simple que cela ! Une fois que vous aurez résilié votre abonnement, il restera actif pour le reste de la période pour laquelle vous avez payé. Découvrez-en plus ici.
Pour le moment, tous nos livres en format ePub adaptés aux mobiles peuvent être téléchargés via l’application. La plupart de nos PDF sont également disponibles en téléchargement et les autres seront téléchargeables très prochainement. Découvrez-en plus ici.
Les deux abonnements vous donnent un accès complet à la bibliothèque et à toutes les fonctionnalités de Perlego. Les seules différences sont les tarifs ainsi que la période d’abonnement : avec l’abonnement annuel, vous économiserez environ 30 % par rapport à 12 mois d’abonnement mensuel.
Nous sommes un service d’abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d’un seul livre par mois. Avec plus d’un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu’il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l’écouter. L’outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l’accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui, vous pouvez accéder à Souvenirs de la cour de Russie sous l'empereur Alexandre, de 1807 à 1813 par Adèle de Reiset en format PDF et/ou ePUB ainsi qu’à d’autres livres populaires dans Geschichte et Historische Biographien. Nous disposons de plus d’un million d’ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Sujet
GeschichteSous-sujet
Historische BiographienXXVI — Le retour.
Un an s’était écoulé depuis le départ de la comtesse, et déjà le souvenir de cette beauté ambitieuse était tout à fait effacé dans la capitale dont elle avait fait l’ornement : on savait qu’elle n’avait jamais rien aimé, qu’elle avait abusé de ses brillants avantages personnels pour faire des malheureux, et que la sécheresse de son cœur avait passé en proverbe ; aussi nul ne s’intéressait à sa destinée, si ce n’est, pourtant, une de ces âmes d’élite, vraiment créées à l’image d’un Dieu de bonté, et qui sont touchées de l’infortune d’autrui, quelque indigne de compassion que soit le misérable jouet du sort.
Louise de Manstein était une de ces âmes indulgentes, toujours ouvertes à la pitié. Les torts d’Antonie à son égard, sa conduite condamnable, ses sentiments dénaturés envers sa fille, n’avaient pu chasser de sa mémoire leur ancienne intimité ; et l’isolement douloureux dans lequel Mme de Narihksim désirait se trouver était souvent le sujet de ses conversations particulières avec sa fille aînée.
— Antonie doit être bien à plaindre, disait alors Mme de Manstein à Estelle, qui l’écoutait avec plus de docilité que d’intérêt ; elle n’est pas méchante, et quoiqu’une excessive vanité l’ait peut-être rendue insensible à l’amour, quoique des adulations continuelles l’aient gâtée, je suis convaincue qu’il existe au fond de cette âme, si froide en apparence, quelques replis inaperçus où se cachent d’affectueuses dispositions.
— Il me semble, cependant, ma mère, reprend timidement Estelle, qu’à moins de posséder votre inépuisable bienveillance, on ne saurait avoir bonne opinion de la sensibilité d’une femme inaccessible au plus dévoué de tous les amours : vous ne vous rappelez donc plus qu’elle a maudit sa fille !
— Eh bien, mon enfant, je vais te surprendre beaucoup, sans doute, en le disant que c’était justement de l’amour maternel dont je voulais parler, quand je prétendais que Mme de Narishkim n’était pas si égoïste qu’on devait le croire... Oh ! je comprends ton air étonné, j’entends d’avance tes exclamations d’incrédulité ; mais il me sera facile, j’imagine, d’y répondre victorieusement par une seule observation. Antonie a toujours aimé les enfants des autres, je lui ai constamment vu la prédilection la plus marquée pour ces petits êtres, que leur faiblesse seule rendrait intéressants s’ils n’avaient pas, pour se faire chérir, leur sourire naïf, leurs larmes éloquentes, le timbre argentin de leur voix si douce, et ces manières ingénues, ces gentilles caresses, qui les rendent irrésistibles. Antonie a toujours aimé les enfants, dis-je, et c’est dans l’amour maternel qu’ont dû se concentrer toutes ses facultés aimantes. Elle a maudit sa fille, à la vérité ; mais si l’ambition trompée a pu l’emporter un instant sur le penchant naturel de son cœur, elle n’aura certes pas tardé a se repentir de son coupable abandon, et ses remords ont déjà sûrement vengé sa jeune victime.
— A propos, ma bonne mère, vous ne m’avez pas encore parlé de cette pauvre petite fille, et pourtant je présume que vous n’ignorez pas ce qu’elle est devenue ; vous avez l’âme si généreuse, que vous aurez pris pitié de l’orpheline délaissée et qu’elle aura trouvé en vous une seconde mère.
— Il n’y en a qu’une au monde, ma fille ; aucune femme, quelque bonne qu’elle soit, ne peut réellement remplacer une mère dévouée, et, je le sens bien moi même, ma sollicitude pour la petite Alexandrine ne saurait être comparée à celle que j’éprouvais pour toi, pour ta sœur, à cet âge tendre où les soins maternels sont si nécessaires, parfois si urgents, si indispensables. Bien certainement, sans les miens auprès de vous deux à cette époque, sans mes veilles constantes, assidues, vous eussiez succombé aux graves maladies qui sont venues assiéger vos berceaux, et je crains bien que la pauvre petite Alexandrine, moins heureuse que vous, ne paye de sa vie la privation de cette tendresse vigilante, attentive, qui l’eût peut-être sauvée !
— Comment cela ?
— Oui, ma chère Estelle, la fille d’Alexandre et d’Antonie se meurt, le médecin la croit atteinte d’une fluxion de poitrine avec une effrayante complication de ces petits maux d’enfance, qui ne sont rien dans le principe quand on s’empresse d’y porter remède dès leur apparition, mais qui menacent l’existence dès qu’on les néglige.
— Alexandrine est née avec une constitution fort délicate ; le lait, les soins éclairés, l’affection d’une mère zélée, eussent, sans nul doute, conjuré ces dispositions maladives ; son abandon la livra à la bonne volonté d’une nourrice insoucieuse, choisie sans précaution, qui ne se fit pas de scrupule de donner à sa fille adoptive le lait à demi formé que la nature préparait en secret pour nourrir plus tard un autre enfant qui souffrait aussi, de son côté, du vol qu’on lui faisait.
L’empereur avait abondamment pourvu aux besoins de sa fille, mais il ne pouvait pas s’en occuper activement. Lorsqu’on lui apprit sa maladie, il pensa que l’œil d’une femme serait plus clairvoyant que le sien dans cette circonstance, et je fus chargée, par lui, de veiller à la conservation d’Alexandrine.
Courir chez la nourrice, lui faire avouer sa grossesse, exiger qu’on sevrât l’enfant sur-le-champ, et le remettre en de meilleures mains, fut l’ouvrage d’un jour. Par malheur, il était bien tard pour réparer le mal : ses ravages avaient encore altéré la débile organisation d’Alexandrine, et maintenant il lui faudrait une mère au chevet de son lit pour la sauver.
C’est dommage, pourtant, de voir ainsi succomber cette jolie petite fille ! elle est si douce, si caressante ; son œil bleu a déjà tant d’expression ! c’est un ange qui s’épure par la souffrance pour monter au ciel.
— Oh ! ma mère, il faut la soigner vous-même, s’écrie Estelle, vivement émue à la peinture du danger de la petite orpheline.
Louise sourit à cette exclamation ; mais elle lui eut bientôt prouvé que ses devoirs d’épouse et de mère s’opposaient au dévouement de tous les instants qu’il eût fallu prodiguer à la petite malade.
Estelle fut convaincue de la justesse des raisonnements de Mme de Manstein ; mais un profond soupir sortit de sa poitrine en la quittant, et quand elle embrassa, quelques moments après, son premier-né, qu’elle nourrissait, la jeune mère lui dit avec effusion : — Je ne t’abandonnerai jamais, moi !
Il s’était à peine passé deux ou trois jours depuis cet entretien, et Louise se trouvait seule dans son appartement, quand elle vit sa porte s’ouvrir, une femme s’avancer vivement à sa rencontre et tomber dans ses bras, en s’écriant d’une voix entrecoupée :
— Ma fille ? où est ma fille ? Qu’as-tu fait de ma fille ? Mme de Manstein a reconnu Antonie, sa belle cousine ; mais quelle métamorphose, grand Dieu ! et comment retrouver la brillante comtesse sous cet extérieur si différent de celui qui lui avait valu tant d’hommages ? Un changement extraordinaire s’est opéré dans ses manières, et quoiqu’elle soit toujours belle, on voit aisément qu’une peine profonde a flétri ses traits charmants et fait disparaître les roses de son teint.
C’est le remords, le poignant remords, dont la griffe de vautour a déchiré son cœur ; c’est le sentiment intime de sa faute, de sa barbarie, qui la poursuit partout depuis le fatal jour de la naissance d’Alexandrine ; en vain a-telle voulu fuir ce reproche permanent, la mauvaise mère, il l’accompagne en tous lieux ; elle sent son aiguillon au milieu des fêtes, des jouissances du monde, elle entend sa voix malgré le murmure flatteur qui l’accueille dans les cercles élégants ; elle voit son aspect menaçant à travers les nuages d’encens qu’on brûle en son honneur : le remords impitoyable la suit jusque dans la solitude ; il s’assied près de sa couche brûlante, afin de la torturer à son gré ; il verse sur sa paupière douloureuse la fatigante insomnie, ou trouble son sommeil par des rêves sinistres ; à toute heure du jour ou de la nuit, dans le tumulte des grandes réunions ou dans l’isolement absolu, ce terrible remords lui crie sans cesse :
— Antonie, Antonie ! ta bouche infâme a maudit ton enfant : le ciel le maudit à son tour ! Il n’est plus de repos pour toi sur la terre !...
Et voilà pourquoi Mme de Narishkim est si étonnamment changée ; voilà pourquoi elle revient tremblante, éperdue, demander à Louise, sa cousine, dont la bonté lui est connue, des nouvelles de cette pauvre petite qu’elle a maudite dans un instant d’exaspération, mais sur laquelle il lui serait doux de verser toutes les bénédictions du ciel, si le ciel voulait, à ce prix, diminuer la rigueur de son châtiment.
Et qu’on ne soit pas surpris vraiment de la révolution opérée dans l’âme de la comtesse ; l’affection maternelle était, ainsi que l’avait bien présumé Mme de Manstein, le seul point vulnérable de l’âme égoïste d’Antonie. Le souvenir de sa fille, immolée à l’impatience de l’orgueil blessé dans son espoir ambitieux, éveilla vivement au fond de son cœur de tendres sensations jusqu’alors inconnues ; l’anathème qu’elle avait lancé sur cette innocente créature retomba de son énorme poids sur son sein bourrelé de remords ; son instinct maternel en reçut un degré d’exaltation de plus ; elle se répéta plusieurs fois avec délire :
— Si mon enfant souffre, si le malheur l’accable, si je la perds un jour, c’est moi qui aurai été son persécuteur, son assassin, sa plus cruelle ennemie... je l’ai maudite !... O mon Dieu ! révoquez cette sentence insensée ! .... j’étais folle quand j’ai proféré ces affreuses paroles !... si j’avais eu la plénitude de ma raison, je n’aurais pas dévoué ma fille à l’infortune !... une mère ne saurait maudire son enfant... à moins d’être en démence !
Cependant l’ambition et la vanité luttaient encore, à celte époque, contre les inspirations de la nature ; humiliée de l’abandon de l’empereur, il lui en coûtait de rentrer dans cette capitale, où sa beauté et la violente passion du czar de toutes les Russies l’avaient placée si près du trône. Elle parcourut successivement, pour se distraire, l’Allemagne, la France et l’Italie ; mais, tous ses efforts à cet égard étant infructueux, elle reprit enfin la route de Saint-Pétersbourg. L’amour maternel l’emporta sur les considérations d’amour-propre.
Louise, touchée du repentir de sa cousine, lui parla, avec tous les ménagements possibles, du triste état de sa fille ; et les premiers tourments que la Providence avait résolu de lui infliger, pour ses fautes de tout genre, s’accrurent du douloureux spectacle de la longue maladie de cette chère enfant.
Mais sa punition ne devait pas se borner à la mort prochaine du seul objet de ses affections. Antonie était trop coupable, elle avait fait verser trop de larmes aux innombrables victimes de sa coquetterie, de son ambition pour ne pas être condamnée à répandre, à son tour, ces pleurs amers que rien ne peut essuyer, dont la source ne tarit jamais.
Alexandrine lui fut rendue : les soins maternels la sauvèrent du trépas qui l’avait déjà flétrie de son souffle fatal, et la joie qu’Antonie ressentit de cette faveur insigne de la destinée ne saurait se décrire.
La petite fille, élevée avec toute la sollicitude imaginable, triompha momentanément du mal qui avait failli la tuer, et Mme de Narishkim, retrouvant, avec sa tranquillité d’esprit, ses vaniteuses impulsions, redevint bientôt la coquette Antonie.
Cependant, la vive inquiétude que lui avait causée la maladie d’Alexandrine apporta de grandes modifications à sa conduite : loin de se faire un jeu inhumain, comme autrefois, des sentiments passionnés que ses charmes faisaient naître, son cœur, sensible désormais, car il avait souffert, son cœur se serrait à l’idée seule de donner de fausses espérances à ses adorateurs, et c’était avec une scrupuleuse réserve qu’elle se montrait flattée des hommages qu’on lui adressait. Le souvenir de Léon, celui de la princesse de Scaretsen, la rendaient circonspecte ; la mort tragique de ces deux personnes, si dignes d’un meilleur sort et que sa froide coquetterie avait réduites au plus violent désespoir était un cauchemar souvent renouvelé qui répandait sur son avenir, sur celui de sa fille bien-aimée surtout, le plus lugubre voile.
— Je suis bien criminelle ! se disait-elle quand ce ver rongeur chassait le sommeil de ses yeux ; j’ai versé goutte à goutte, sans pitié, avec un cruel badinage, le poison qui devait brûler les entrailles de la plus aimante des femmes ; j’ai placé dans les mains d’un jeune insensé l’arme meurtrière qui devait trancher une si belle vie ; et dans ma folle vanité j’ai vu tomber à mes pieds les deux victimes de mon insatiable coquetterie, sans leur accorder un regret, une larme ; que dis-je ? ce spectacle était délectable pour mon infernal orgueil : je triomphais ; on m’adorait jusqu’à verser du sang humain sur mon autel !... Oh ! j’étais un monstre !... et pour mettre le comble à mes crimes, j’ai maudit ma fille !... Pauvre Léon, malheureuse Sophie ! le ciel vous vengera, il me prendra mon enfant !
Et la triste Antonie s’élançait vers le berceau d’Alexandrine, examinait avec anxiété le visage pâle et les traits délicats de ce jeune être qu’un souffle pouvait anéantir ; puis, l’instinct de coquetterie inné en elle reprenant, son ascendant sur cette âme indécise, elle cherchait le lendemain, dans le grand monde, des distractions qui ne lui manquaient pas elle était si belle !
Ce fut dans ces alternatives de remords et de frivoles jouissances que s’écoulèrent les premières années d’Alexandrine. Cédant tour à tour au vain désir de plaire, d’être adulée, dont elle avait contracté l’habitude, ou bien aux cris importuns de sa conscience qui lui rappelait, avec l’accent d’un juge irrité, le nombre des malheureux qu’elle avait faits, sa mère était tantôt gaie, tantôt triste, parfois retrouvant sa légère insouciance, son besoin effréné d’hommages ; souvent aussi, rêveuse, inquiète, préoccupée.
Le passé et l’avenir étaient, il est vrai, pour cette femme exceptionnelle, le sujet de pénibles réflexions ; jadis, en effet, la fière comtesse de Narishkim, alliée à la famille régnante, d’une beauté sans égale, possédant tous les avantages qui procurent des succès dans le monde, objet de l’admiration, des respects des plus exigeants censeurs des grâces et de la conduite ; la fière comtesse, jouissant d’une renommée inattaquable, avait vu, à deux genoux devant elle, le souverain absolu du plus vaste empire du monde, et touché pour ainsi dire avec la main la couronne impériale, si ardemment ambitionnée.
… Mais, depuis, ses jours de gloire avaient fait place à des jours d’humiliation. L’altière coquette avait perdu, par excès d’amour-propre, cette réputation sans tache dont elle était si jalouse ; son royal esclave avait brisé ses chaînes, et son pied furtif qui gravissait déjà les premiers degrés du magnifique trône sur lequel elle comptait bientôt s’asseoir, son pied honteux s’était retiré précipitamment pour fuir, aux extrémités du monde, le mépris prêt à fondre sur sa tète coupable, et ce mépris l’avait poursuivie partout ; sa rare beauté ne lui permettant pas de se réfugier dans l’obscurité, on disait en tous lieux, à son aspect : — Cette ravissante femme est la maîtresse disgraciée de l’empereur de Russie ! puis le remords était venu joindre ses poignantes étreintes aux déceptions de son existence naguère si brillante ; les fantômes menaçants de Léon et de Sophie troublèrent son repos, et quand l’image d’Alexandrine, abandonnée à des soins mercenaires, morte peut-être chargée de la malédiction maternelle, vint se joindre à ces lugubres souvenirs, le châtiment de Mme de Narishkim fut complet.
Il devait cependant s’accroître de jour en jour, ce châtiment exemplaire ; et l’on eût dit, à voir les décevantes espérances qui glissaient de temps en temps, au milieu des inquiétudes maternelles, comme les brillants rayons du soleil à travers les nuages orageux, on eût dit que le ciel ne laissait à Antonie quelques instants de répit qu’ afin de lui rendre l’énergie morale dont elle aurait besoin plus tard pour supporter, sans mourir de douleur, les cruelles épreuves auxquelles il la condamnait.
Alexandrine était, en effet, pour la comtesse, une source de vives jouissances et de chagrin...
Table des matières
- INTRODUCTION — Vanité féminine.
- I — La Russie en 1807.
- II — La métamorphose.
- III — Pourquoi pas ?
- IV — La chasse.
- V — L’essai.
- VI — L’entrevue.
- VII — La fête de Louise.
- VIII — Friedland.
- IX — Les deux Empereurs.
- X — L’Ambassadeur.
- XI — La Visite Nocturne.
- XII — Il ne m’aime plus.
- XIII — Le Pavillon.
- XIV — Le Charme.
- XV — L’Amour ignoré.
- XVI — Galanterie de Napoléon.
- XVII — La Fête Française.
- XVIII — N’êtes-vous pas le Maître ?
- XIX — L’héritier
- XX — Moscou.
- XXI — L’incendie.
- XXII — La folle de Pirna.
- XXIII — Le colosse renversé.
- XXIV — Le prisme brisé.
- XXV — La mauvaise mère.
- XXVI — Le retour.
- XXVII — L’extase.
- XXVIII — Est-ce bien elle ?