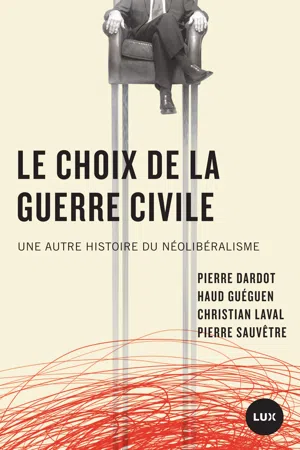![]()
Chapitre 1 Le Chili, première contre-révolution néolibérale
[E]t il y eut des grèves et un colonel d’un régiment de blindés tenta un coup d’État et un cameraman mourut en filmant sa propre mort, et ensuite on tua l’aide de camp naval d’Allende et il y eut des troubles, des insultes, les Chiliens blasphémèrent, inscrivirent des slogans sur les murs, puis presque un demi-million de personnes défila en soutien à Allende, ensuite ce fut le coup d’État, le soulèvement, le pronunciamento militaire, on bombarda le palais présidentiel de La Moneda et quand le bombardement cessa le président se suicida et ce fut tout.
Roberto BOLAÑO, Nocturne du Chili
Il s’agit d’une victoire stratégique de l’impérialisme qui permet, non seulement de revenir sur les nombreuses avancées sociales conquises durant ces mille jours, mais aussi de transformer le Chili en véritable laboratoire: celui d’un capitalisme néolibéral encore inconnu sous d’autres latitudes et dont ce petit pays du sud expérimente, le premier, les recettes, sous la coupe des «Chicago Boys». Les 17 années de dictature postérieures au 11 septembre 1973 sont celles de ce que Tomás Moulian ou Manuel Gárate nomment «révolution capitaliste», tant la société va être remodelée par la junte. Il s’agit, en fait, d’une contre-révolution, dans le sens le plus strict du terme.
Franck GAUDICHAUD, Chili 1970-1973
LE 11 SEPTEMBRE 1973, le coup d’État mené par le général Pinochet avec le soutien actif de Richard Nixon et de la Central Intelligence Agency (CIA) mettait fin à l’expérience de l’Unité populaire amorcée en 1970 par la victoire de Salvador Allende. Le 10 décembre 1974, un an et trois mois après, Hayek recevait le prix Nobel de sciences économiques. Le 11 février 1975, trois mois après cette réception, Thatcher rencontrait Hayek pour la première fois. Tout juste auréolée de sa victoire dans la bataille pour la direction du Parti conservateur, elle se rendit depuis le parlement jusqu’à Lord North Street aux bureaux de l’Institute of Economic Affairs (IEA), «le plus ancien et sans doute le plus influent des think tanks néolibéraux britanniques». Au dire de certains témoins, l’entretien dura moins de trente minutes. Dans l’attitude d’une humble écolière, Thatcher garda un silence inaccoutumé pendant dix minutes alors que Hayek déployait ses arguments. Quel lien établir entre ces trois événements?
Le général, le prix Nobel et la Dame de fer
Trois personnages jouent les rôles principaux dans ce qu’il faut bien appeler la scène primitive politique du néolibéralisme de gouvernement: le «général», en la personne du dictateur Augusto Pinochet, le «prix Nobel», en la personne de Friedrich Hayek, et la «Dame de fer», en la personne de Margaret Thatcher, laquelle ne recevra ce sobriquet que bien après, au terme de plusieurs années au pouvoir. Dans cette étrange scène, le second personnage a joué un rôle clé qui excède sa position de théoricien de l’économie et fut plus proche de celui d’un inspirateur politique.
Un incident dit bien, à sa manière, la façon dont fut très tôt perçue l’attitude politique adoptée par Hayek à l’égard de la junte chilienne. Ce dernier a partagé le «prix Nobel d’économie» avec Gunnar Myrdal, un rival dont les positions étaient aux antipodes des siennes, puisqu’il était keynésien. À vrai dire, ce prix Nobel n’en est pas vraiment un: il ne fut pas institué par Alfred Nobel et n’est pas géré par la fondation Nobel, mais fut créé par la Banque de Suède en 1969 sous le nom de «prix de sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel». Lors de la remise du prix à Stockholm, les deux économistes couronnés s’apprêtent à passer devant le roi de Suède, accompagnés de leurs épouses. Soudain, des mots fusent entre les deux femmes: «me first, shame on you, fascist, socialist, Pinochet…» Manifestement, ce fut Helene Hayek qui haussa le ton. Mais l’allusion à Pinochet lancée par Alva Myrdal prend un relief particulier: Hayek avait en effet refusé de condamner le coup d’État de Pinochet. Or, cela lui sera reproché par Gunnar Myrdal plus tard dans la nuit, du moins d’après la reconstitution conjecturale de leur conversation. À Hayek, qui pronostiquait cette nuit-là (on était au lendemain du sommet des Neuf de Paris, tenu les 9 et 10 décembre 1974) la transformation de l’Europe en «terre de servitude», Gunnar Myrdal rétorqua sèchement: «Pour ce qui est de la servitude, vos amis chiliens en imposent.»
Hayek lui-même ne se priva pas de donner en exemple ses «amis chiliens» à Margaret Thatcher. Une anecdote fameuse, rapportée par John Ranelagh, veut que, lors d’une réunion politique du Parti conservateur à la fin des années 1970, alors qu’un orateur commençait à plaider en faveur d’une voie pragmatique, Thatcher laissât tomber La constitution de la liberté de Hayek sur la table et déclarât aux membres de l’assemblée: «Voici ce en quoi nous croyons.» En août 1979, Hayek écrivit à Thatcher que le besoin de faire plier les syndicats était si urgent qu’il requerrait un référendum. Il pressa cette dernière de couper au plus vite dans les dépenses publiques et de rééquilibrer le budget en un an plutôt qu’en cinq. Il déplora aussi l’influence du monétarisme de Milton Friedman sur la pensée du gouvernement, estimant que les taux d’intérêt devaient être encore augmentés pour éliminer immédiatement l’inflation, quel que soit le prix à payer en termes de banqueroutes et de pertes d’emploi. Il lui enjoignit enfin de suivre plus étroitement l’exemple du Chili. Thatcher lui répondit que l’impact social d’un ajustement aussi rapide ne l’aurait pas rendu viable et que la nature démocratique du Royaume-Uni signifiait que l’exemple du Chili n’était pas directement transférable. Ce désaccord n’empêcha pas Thatcher de déclarer le 5 janvier 1981 à la Chambre des communes: «Je suis une grande admiratrice du professeur Hayek. Il serait bien que les honorables membres de cette Chambre lisent certains de ses livres, La constitution de la liberté, les trois volumes de Droit, législation et liberté.» Quelques mois après, en avril 1981, le «professeur Hayek» déclarait dans un entretien à El Mercurio, journal chilien ayant soutenu la dictature de Pinochet: «Comme vous le comprendrez, un dictateur peut gouverner d’une manière libérale. Et une démocratie peut aussi gouverner avec une totale absence de libéralisme. Personnellement, je préfère un dictateur libéral à un gouvernement démocratique manquant de libéralisme.» On voit avec ces quelques citations que le Chili de Pinochet constitue durant toutes ces années une référence politique constante, qu’elle soit de nature critique et polémique, comme dans la bouche d’Alva Myrdal en 1974, ou qu’elle vienne à l’appui d’une prise de position théorique, comme c’est le cas de la déclaration de Hayek au Mercurio en 1981. D’où lui vient une telle place? Quel rapport le coup d’État de 1973 entretient-il avec le néolibéralisme? Et avec quel néolibéralisme? Celui de Friedman plutôt que celui de Hayek, dont on a vu l’attitude critique à l’égard de l’orientation monétariste du premier? Au-delà des divergences entre ces deux théoriciens néolibéraux, faut-il renoncer à prêter une cohérence idéologique à la junte, tant les courants qui l’inspirent sont hétérogènes? À qui l’examine non à partir de ses conséquences mais ex ante, à la lumière de ses préparatifs et de l’idéologie qui anime ses instigateurs, rien ne laisse prévoir la direction prise plus tard en matière de politique économique et sociale. Le point de vue des acteurs et des témoins est à cet égard irremplaçable.
Le coup d’État, ses préparatifs et le rôle de l’impérialisme
Pour certains observateurs engagés, la victoire de l’Unité populaire sonnait comme le début d’un nouveau cycle en Amérique latine: elle avait mis un point final à l’expérience de la «voie continentale de guérilla» qui avait éduqué la nouvelle génération révolutionnaire en Europe. À la fin des années 1960, en effet, la stratégie du foyer de guérilla (foco) faisait encore figure de substitut pratique du réformisme qui privilégiait la voie électorale. Pour Maurice Najman, qui y avait séjourné en 1973, le Chili avait rebattu les cartes en renouant avec l’expérience de la révolution bolchevique d’octobre 1917, celle d’une «dualité de pouvoir»: d’un côté, le gouvernement légal d’Allende, de l’autre, les organes autonomes du pouvoir populaire. Une telle lecture, qui n’était pas alors isolée, surestimait le développement, resté embryonnaire, de ces organes en leur prêtant la capacité de commencer à résoudre «la question d’une direction politique alternative à l’Unité populaire». D’où une tendance à pronostiquer une prompte résistance armée au coup d’État, pronostic erroné dont on a pu dire qu’il procédait d’une «vision surdimensionnée de la force du pouvoir populaire». Qu’en fut-il en réalité?
Franck Gaudichaud distingue trois séquences, ce qu’il appelle «trois respirations saccadées» du pouvoir populaire chilien. La première va de l’élection d’Allende à la grève menée par l’opposition et le patronat en octobre 1972. Ce qui prédomine à cette étape, c’est une participation populaire institutionnalisée, c’est-à-dire «impulsée et dirigée depuis l’État». La deuxième commence avec la grève d’octobre 1972 pour finir en juin 1973. Le trait le plus marquant de cette séquence est le «surgissement d’organisations indépendantes de l’exécutif», telles que les Cordons industriels et les Commandos communaux. La troisième séquence va du putsch manqué du 29 juin 1973 (le tancazo) jusqu’au coup d’État du 11 septembre. Les Cordons industriels font la preuve de leur capacité de mobilisation, mais ils sont dépourvus de toute «organisation permanente démocratique basée sur des délégués élus en assemblée» et leur coordination demeure très insuffisante, dépassant rarement le niveau local. Il est donc parfaitement illusoire de voir en eux des «soviets à la chilienne».
En réalité, l’un des grands mensonges propagés par la dictature a été de faire croire que la gauche était très bien préparée militairement et prête à prendre elle-même l’initiative d’un coup d’État. Contrairement à ce qu’ont affirmé les éditoriaux d’El Mercurio ou le «livre blanc» du régime militaire, le thème d’une armée des Cordons industriels tient du mythe pur et simple. Le prétexte du coup d’État militaire est l’intention d’Allende d’annoncer le soir même du 11 septembre un plébiscite populaire en vue d’un changement constitutionnel destiné à stabiliser le gouvernement jusqu’aux présidentielles de 1976. Mais le véritable coup d’État, le seul réel, avait déjà fait l’objet d’une préparation minutieusement organisée. Lors de la grève des camionneurs de juillet 1973, mouvement de petits propriétaires instrumentalisé par l’opposition, les attentats et les sabotages se multiplient chaque jour. Les Cordons industriels sont une cible prioritaire. Pire, c’est le vote de la «loi sur le contrôle des armes» le 20 octobre 1972, avec l’appui de la gauche parlementaire, qui offre aux officiers l’occasion de commencer la répression: elle donne en effet à l’armée un droit élargi en matière de recherche d’armement illégal. On a ainsi affaire à «une sorte de guerre contre-révolutionnaire sui generis, menée à sens unique contre le pouvoir populaire avant même le coup d’État». Pourtant, jusqu’au 11 septembre à 8 heures du matin, Allende continue d’avoir confiance dans la loyauté du général Pinochet. Contrairement aux innombrables rumeurs qui circulent dans le monde tout de suite après, il n’y a pas eu d’opposition armée massive des ouvriers chiliens au coup d’État. En particulier, «malgré quelques réactions courageuses mais sporadiques, les Cordons industriels sont restés passifs ce 11 septembre 1973».
Ce qui frappe tout d’abord, c’est l’ampleur de la terreur d’État qui s’abat sur les militants de gauche et les dirigeants du mouvement syndical. Non content d’imposer la loi martiale, de fermer le Congrès, de suspendre la Constitution et d’interdire l’activité de tous les partis politiques, Pinochet donne peu à peu une dimension transnationale à la répression, en coordination avec les autres régimes militaires de la région et avec le soutien du gouvernement des États-Unis, grâce à la mise en œuvre de l’«opération Condor». Ce rôle joué par l’impérialisme constitue une «coordonnée majeure» de la tragédie chilienne, pour reprendre la formule de Franck Gaudichaud. Le coup d’État a été méthodiquement préparé par une campagne de déstabilisation menée par le gouvernement Nixon:
Plus de 8 millions de dollars ont été dépensés, en 3 ans, afin de financer des médias (notamment El Mercurio) et influencer l’opinion publique, des partis d’opposition (dont tout particulièrement la Démocratie chrétienne afin qu’elle refuse tout compromis avec Allende) et dans une moindre mesure des organisations corporatistes du secteur privé, hostiles à l’Unité populaire. Ceci sans compter la pression économique exercée contre le Chili, les contacts établis avec les militaires putschistes et l’appui logistique de la CIA: cette «secrète obscénité» de l’histoire récente doit faire partie de toute réflexion sur la fin de la «voie chilienne».
Les faits sont aujourd’hui bien établis et documentés. Cette politique de l’administration américaine s’inscrivait dans un contexte international encore fortement marqué par la guerre froide, où les interventions militaires directes étaient fréquentes (la guerre du Vietnam ne prendra fin qu’en 1975). Mais, pour décisif qu’il fût, ce rôle de l’impérialisme ne suffit pas à expliquer la direction prise par la junte à partir de 1975. Il faut donc déterminer ce qui a motivé ce changement d’orientation.
L’idéologie de la junte et la réorientation de 1975
La doctrine de la junte militaire, telle qu’elle est présentée dans un ouvrage collectif de 1976, Nuestro camino, repose sur trois courants de pensée qui se sont amalgamés en deux temps. En premier lieu, des sources philosophiques ultraconservatrices d’origine européenne, en particulier les philosophes français Joseph de Maistre et Louis de Bonald, monarchistes violemment opposés à la Révolution française, ou encore les Espagnols Juan Vázquez de Mella, fondateur du parti catholique traditionaliste en 1918, et Juan Donoso Cortés, écrivain et homme politique, qui compteront l’un et l’autre parmi les inspirateurs du franquisme. Ce courant de pensée ultraconservateur sera notamment incarné par Jaime Guzmán, membre de l’Opus Dei, conseiller du dictateur, créateur du parti «grémialiste» (de gremio, mot espagnol signifiant «corporation» ou «communauté professionnelle»). En deuxième lieu, la doctrine de la sécurité nationale est chargée de légitimer la concentration des pouvoirs entre les mains de la junte: le coup d’État est considéré comme une mesure de salut public devant la situation de guerre qu’affronte le pays du fait de l’action d’un ennemi mortel, invariablement désigné comme le «communisme» ou le «marxisme». Ces deux premiers courants furent actifs dès avant le coup d’État, dans la critique virulente du régime d’Allende. Enfin, un troisième courant, le néolibéralisme, vient s’adjoindre ultérieurement aux deux premiers. Il est porté par ceux que l’on nomme les Chicago Boys, formés au monétarisme de l’école de Chicag...