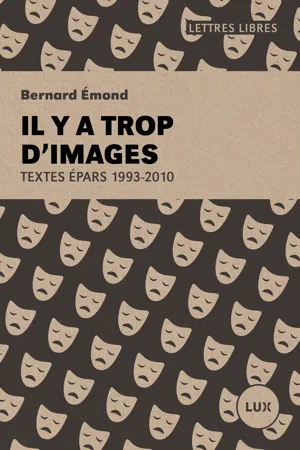
This is a test
- 128 pages
- French
- ePUB (adapté aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Détails du livre
Aperçu du livre
Table des matières
Citations
À propos de ce livre
Dans une vie encombrée de milliards d'images futiles et triviales, comment trouver la force de s'appliquer à voir, à voir derrière, à voir au-dessus des choses, à voir ce qui ne se voit pas du premier coup d'œil? Comment trouver le courage d'une juste colère, comment entretenir la volonté de s'approcher de la vérité, d'admirer la beauté, et comment, surtout, ne pas renoncer aux obligations qui fondent nos libertés? À ces questions, Bernard Émond offre des réponses qui opposent au vide qui nous menace l'irréductible présence des valeurs fondamentales de notre commune humanité.
Foire aux questions
Il vous suffit de vous rendre dans la section compte dans paramètres et de cliquer sur « Résilier l’abonnement ». C’est aussi simple que cela ! Une fois que vous aurez résilié votre abonnement, il restera actif pour le reste de la période pour laquelle vous avez payé. Découvrez-en plus ici.
Pour le moment, tous nos livres en format ePub adaptés aux mobiles peuvent être téléchargés via l’application. La plupart de nos PDF sont également disponibles en téléchargement et les autres seront téléchargeables très prochainement. Découvrez-en plus ici.
Les deux abonnements vous donnent un accès complet à la bibliothèque et à toutes les fonctionnalités de Perlego. Les seules différences sont les tarifs ainsi que la période d’abonnement : avec l’abonnement annuel, vous économiserez environ 30 % par rapport à 12 mois d’abonnement mensuel.
Nous sommes un service d’abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d’un seul livre par mois. Avec plus d’un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu’il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l’écouter. L’outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l’accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui, vous pouvez accéder à Il y a trop d'images par Bernard Émond en format PDF et/ou ePUB ainsi qu’à d’autres livres populaires dans Medios de comunicación y artes escénicas et Películas y vídeos. Nous disposons de plus d’un million d’ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Sous-sujet
Películas y vídeosPremière partie
Cinéma cinémas
20 h 17, RUE DARLING À CANNES
Texte lu avant la projection du film 20 h 17, rue Darling à la Semaine internationale de la critique du Festival de Cannes, le 20 mai 2003.
RÉSOLUMENT LOCAL, 20 h 17, rue Darling, est un film tourné sur dix rues d’un quartier de Montréal, avec des personnages profondément québécois et qui s’expriment dans la langue des quartiers ouvriers de Montréal. Je suis heureux qu’un film aussi local se retrouve à Cannes, dans le plus international des festivals.
Je précise qu’un cinéma qui se voudrait international ne m’intéresse pas. Ce sont les cinémas nationaux qui m’intéressent. Ils m’intéressent pour autant qu’ils sont français, chinois ou finlandais. Je suis de ceux qui pensent que faire un cinéma national est un acte de résistance nécessaire face à la barbarie qui se cache derrière la culture de masse américaine.
Je ne vous parlerai pas du film. Vous allez le voir. Mais j’aimerais vous parler de la langue du film.
Il y a deux ans, quand je suis venu montrer mon film La femme qui boit à la Semaine, une spectatrice m’a dit : « Votre film est tragique, je le sais, mais j’entends l’accent et ça me donne envie de rire. » Cela s’appelle du mépris.
La langue de ce film est une langue de pauvres. C’est la langue de gens dont les ancêtres se sont échinés pendant 300 ans sur des terres de misère à faire vivre des familles de 15 enfants. C’est la langue de gens dont les grands-parents sont montés à Montréal pour travailler à des salaires de famine dans des usines pour des patrons anglais qui les méprisaient. Cette langue a fait leur malheur et leur dignité. C’est la langue de ma mère et de mes grands-parents. Écoutez sa musique. C’est beau et triste comme un reel irlandais.
Aux spectateurs français, je demande une faveur : si vous ne goûtez pas la saveur de cette langue, reportez-vous aux sous-titres anglais et faites comme si le film était slovaque ou portugais.
LE SILENCE
Texte écrit en 2006 et publié avec le scénario de La neuvaine[3].
AU MOMENT où j’écris ces lignes, je me trouve à mi-parcours de ma trilogie sur les trois vertus théologales. Le film sur la foi (La neuvaine) est terminé, celui sur l’espérance (Contre toute espérance) est en montage, et celui sur la charité n’est pas encore écrit. À vrai dire, je ne sais pas encore comment terminer cette trilogie. Je me reprends : je ne sais pas encore comment cette trilogie se terminera. D’une certaine façon, cela s’écrit, cela se tourne, et j’ai bien plus l’impression de descendre en canot une rivière difficile que celle de conduire tranquillement un navire à bon port.
Il n’y a d’ailleurs jamais eu de projet de trilogie au sens strict ; il n’y a pas eu de moment où je me suis dit : « Voilà, je vais faire ces trois films. » Le scénario de La neuvaine a été conçu de façon indépendante, et c’est après l’avoir écrit (mais avant de tourner le film) que j’ai envisagé une suite thématique. Je reviendrai plus loin sur cette idée de trilogie. Mais il me faut d’abord parler de la genèse de La neuvaine.
À la fin des années 1990, j’ai tourné Le temps et le lieu, un documentaire sur Saint-Denis de Kamouraska, où je suivais les traces de l’anthropologue américain Horace Miner. Miner avait habité le village en 1936, avant d’écrire son livre St. Denis : A French-Canadian Parish, qui est devenu plus tard un classique de la sociologie québécoise. Comme à mon habitude, j’avais fait du travail de préparation du film une sorte de petit terrain ethnographique et j’avais à mon tour vécu dans le village pendant plusieurs mois, me liant avec plusieurs de ses habitants et fréquentant assidûment (en bon anthropologue) l’église. Au même moment, pour ma recherche, je redécouvrais la sociologie de la ruralité québécoise et la littérature du terroir, que je n’avais pas lue depuis l’adolescence. Dans Trente arpents, Le survenant, Marie-Didace, Vieilles choses, vieilles gens et Les rapaillages, c’est tout le vieux fonds culturel canadien-français, catholique et paysan, que je retrouvais avec une joie qui m’étonnait.
C’est dans cet état d’esprit que j’ai visité, un peu par hasard, en 1999, la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Rien ne m’avait préparé à l’intensité de l’émotion que j’ai ressentie alors. J’avais très exactement l’impression de rentrer chez moi, tout intellectuel non croyant que j’étais. La basilique, dans sa grandeur comme dans son kitsch, me ramenait à la foi de mon enfance et de mes ancêtres : voilà d’où je venais, voilà ce qui m’avait fait. C’était ma tribu, c’étaient mes rituels. Qu’on me comprenne bien : le choc que j’ai ressenti alors était plutôt d’ordre culturel que d’ordre religieux. Il s’y glissait pourtant une nostalgie (et j’utilise ici le mot en toute conscience) de la transcendance perdue.
Et puis, il y avait aussi ce qui entourait le sanctuaire : la beauté de la vieille rue Royale, du fleuve et de l’île d’Orléans, tout cela défiguré par le boulevard Sainte-Anne et son alignement de motels et de centres commerciaux. J’y voyais une sorte de métaphore du destin de la culture québécoise en Amérique du Nord. C’est à partir de ce moment-là que l’idée de faire un film à Sainte-Anne a commencé à me travailler. Je disais à mes proches : « Sainte-Anne est un lieu qui attend son film. » Mais la vie d’un cinéaste est discontinue. J’ai tourné La femme qui boit et écrit 20 h 17, rue Darling avant de pouvoir retourner à Sainte-Anne, au printemps 2001. J’étais allé manifester au Sommet des Amériques à Québec, et j’avais pris pour quelques jours une chambre de motel à Sainte-Anne. C’est là que j’ai découvert le quai du village, le Cyclorama de Jérusalem, le musée de Sainte-Anne et le chemin de croix dans la montagne (qui figurent tous dans La neuvaine). J’ai commencé à imaginer une sorte de film à sketches dans lequel, pendant les neuf jours d’une neuvaine, divers personnages s’entrecroisaient. Puis j’ai dû laisser le projet de côté pour tourner et monter 20 h 17, rue Darling.
Après le montage de 20 h 17 à l’été 2002, je savais que mon prochain film allait se tourner à Sainte-Anne, même si je ne savais rien de l’histoire et à peu près rien des personnages. Dès que j’ai pu, j’ai passé une semaine à errer dans le village et au sanctuaire pour me pénétrer des lieux (je suis incapable d’imaginer une histoire sans connaître le lieu où elle se déroule). Des quelques personnages que j’avais entrevus l’année précédente pour le projet, deux seulement avaient survécu au temps : une femme incroyante et suicidaire arrivée un peu par hasard au bout du quai de Sainte-Anne et un jeune homme venu faire une neuvaine au sanctuaire. J’imaginais de la femme qu’elle était médecin et qu’elle revenait d’Afrique où elle avait survécu à un massacre dans un camp de réfugiés. Quant au jeune homme, je l’imaginais simple et bon, venant de la campagne et un peu hors du temps (à l’époque, j’imaginais qu’il venait faire une neuvaine pour trouver un travail). Je sentais confusément qu’ils devaient se rencontrer et que leur rencontre devait être celle de la foi et de l’incroyance, de l’espérance et du désespoir. Mais ils n’avaient rien en commun et je ne savais pas comment les faire se rencontrer. Une promenade sur le quai dans le grand soleil de juillet a réglé ce problème : j’ai vu Jeanne et François comme s’ils y étaient. Et j’ai su que le film, basé sur la rencontre improbable de deux personnages totalement différents, allait être une sorte de fable. Tout de suite, aussi, j’ai su qu’Élise Guilbault (avec qui j’avais tourné La femme qui boit) et Patrick Drolet (le jeune maniaco-dépressif de 20 h 17, rue Darling) allaient porter les deux personnages.
La suite est plus difficile à expliquer. Le travail de scénarisation est pour moi quelque chose d’assez mystérieux, un mélange de bricolage et d’imagination, de contrôle et d’abandon, où les contraintes économiques de la production d’un film jouent un rôle important, où les impératifs de la construction d’une histoire sont parfois balayés par des personnages qui se mettent à vivre une vie indépendante (et parfois à me faire pleurer !), et où ça s’écrit autant que je l’écris.
Au bout du compte, il y a eu cette histoire dont je ne peux que constater (je ne vois pas comment le dire autrement) la structure, les symétries et les oppositions (ville/campagne, foi/incroyance, espérance/désespoir, simplicité/complexité). Le moteur du récit est sans doute l’opposition entre la mort « sensée » de la grand-mère de François et celles, « insensées », de la jeune mère et de son enfant. Jeanne, confrontée à l’absurdité de l’existence par le meurtre auquel elle a assisté et dont elle se croit responsable, est ramenée à la vie par l’expérience de la mort paisible de la grand-mère. Le mal, incarné par le mari violent, est d’une certaine manière compensé par le bien, que représente le personnage de François. À la fin du film, un équilibre incertain s’est rétabli : Jeanne décide de continuer à vivre.
Mais la fin du film est assez différente de celle du scénario. Dans le scénario, à la dernière séquence, Jeanne entre au bureau des bénédictions du sanctuaire et raconte son histoire au prêtre (on comprend alors que c’est le dialogue en voix hors champ qui parcourt le film), avant de lui demander de prier pour ses morts. Le prêtre la bénit et, avant qu’elle ne parte, lui demande ce qu’elle va faire. Jeanne répond : « Je vais rentrer chez nous. . . Je vais essayer de vivre. . . Je vais travailler. . . Mon travail est utile. . . Alors, je vais travailler. . . Tant que je vais pouvoir. . . Qu’est-ce qu’on peut faire d’autre ? » C’est une fin tchékhovienne, inspirée de la dernière réplique de Sonia dans Oncle Vania, une fin en demi-teintes, plutôt fataliste, assez différente de celle que nous avons fabriquée au montage. Pour toutes sortes de raisons, la scène telle que je l’avais tournée ne me satisfaisait pas. Avec ma monteuse, Louise Côté,...
Table des matières
- Couverture
- Faux-titre
- Page de titre
- Crédits
- Avant-propos
- I - Cinéma cinémas
- II - Ce qui importe
- Table
- Quatrième de couverture