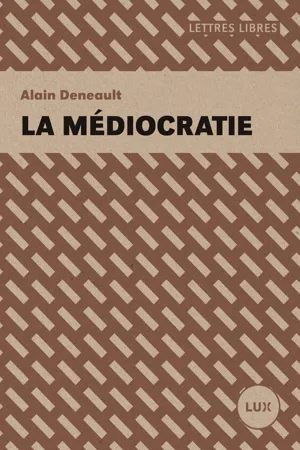
This is a test
- 306 pages
- French
- ePUB (adapté aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
La médiocratie
Détails du livre
Aperçu du livre
Table des matières
Citations
À propos de ce livre
« Rangez ces ouvrages compliqués, les livres comptables feront l'affaire. Ne soyez ni fier, ni spirituel, ni même à l'aise, vous risqueriez de paraître arrogant. Atténuez vos passions, elles font peur. Surtout, aucune "bonne idée", la déchiqueteuse en est pleine. Ce regard perçant qui inquiète, dilatez-le, et décontractez vos lèvres – il faut penser mou et le montrer, parler de son moi en le réduisant à peu de chose: on doit pouvoir vous caser. Les temps ont changé. Il n'y a eu aucune prise de la Bastille, rien de comparable à l'incendie du Reichstag, et l'Aurore n'a encore tiré aucun coup de feu. Pourtant, l'assaut a bel et bien été lancé et couronné de succès: les médiocres ont pris le pouvoir. »
Foire aux questions
Il vous suffit de vous rendre dans la section compte dans paramètres et de cliquer sur « Résilier l’abonnement ». C’est aussi simple que cela ! Une fois que vous aurez résilié votre abonnement, il restera actif pour le reste de la période pour laquelle vous avez payé. Découvrez-en plus ici.
Pour le moment, tous nos livres en format ePub adaptés aux mobiles peuvent être téléchargés via l’application. La plupart de nos PDF sont également disponibles en téléchargement et les autres seront téléchargeables très prochainement. Découvrez-en plus ici.
Les deux abonnements vous donnent un accès complet à la bibliothèque et à toutes les fonctionnalités de Perlego. Les seules différences sont les tarifs ainsi que la période d’abonnement : avec l’abonnement annuel, vous économiserez environ 30 % par rapport à 12 mois d’abonnement mensuel.
Nous sommes un service d’abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d’un seul livre par mois. Avec plus d’un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu’il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l’écouter. L’outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l’accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui, vous pouvez accéder à La médiocratie par Alain Deneault en format PDF et/ou ePUB ainsi qu’à d’autres livres populaires dans Politics & International Relations et Political History & Theory. Nous disposons de plus d’un million d’ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Sous-sujet
Political History & TheoryCHAPITRE 1
LE «SAVOIR» ET L’EXPERTISE
LE JOURNALISTE ÉTATS-UNIEN Chris Hedges y va sans détour: les universitaires sont responsables de nos maux historiques. Pour la plupart coupés du monde, spécialistes de sous-domaines infinitésimaux, devenus incapables de conscience critique, avalés par les tactiques d’avancement de carrière et enfermés dans une appartenance collégiale qui a les allures d’une «tribu», leur présence se découvre sitôt que l’on sonde les raisons de nos périls collectifs. La crise écologique en progression, les inégalités des revenus menant à des exclusions à une échelle nationale et mondiale, la dépendance aux énergies fossiles, la surconsommation et l’obsolescence programmée, le renversement de la culture en une industrie du divertissement, la colonisation de l’esprit par la publicité, la prédominance du système financier international sur l’économie ainsi que l’instabilité dudit système, par exemple, sont autant de problèmes qui trouvent leur cause dans des recherches et formations développées par les institutions universitaires. Les laboratoires, facultés et départements universitaires forment en effet «l’élite» en cause. N’est-ce pas en vertu de savoirs acquis ou développés à l’université, dont d’imposants diplômes rendent compte, que décideurs et personnel de pointe façonnent et modélisent le monde dans lequel nous vivons? Il y a lieu de s’en inquiéter, insiste Hedges dans L’empire de l’illusion, car «les universités d’élite ont renoncé à toute autocritique. Elles refusent de remettre en cause un système n’ayant que son maintien pour raison d’être. Dans ces institutions, il n’y a que l’organisation, la technologie, la promotion personnelle et les systèmes d’information qui comptent». L’université est devenue une composante du dispositif industriel, financier et idéologique contemporain, ni plus ni moins. C’est en ce sens qu’elle se réclame de «l’économie du savoir» à laquelle elle se targue de participer. Les entreprises voient alors l’université leur fournir le savoir de pointe et le personnel qu’elles requièrent, et ce, à partir de fonds publics. Pour 500 millions de dollars, l’Energy Biosciences Institute de l’université de Berkeley fournit à la pétrolière British Petroleum (BP) le travail de chercheurs et l’équipement. «British Petroleum pourra donc fermer un de ses centres privés et profiter de laboratoires financés par le secteur public», est amené à conclure Hedges. Aux États-Unis comme au Canada, jusqu’à ce qu’on trouve l’idée excellente en Europe, telle université se laissera baptiser Rockefeller, tel pavillon arborera le nom des Desmarais, telle chaire se présentera sous le sigle de GoldCorp, telle salle de classe perdra son numéro au profit de l’appellation PriceWaterhouseCoopers, telle bourse d’études se fera naturellement connaître par le nom indélébile de son commanditaire Bosch.
L’université a développé un rapport de subordination tel avec les clients qui achètent les cerveaux qu’elle produit en série, que Max Weber eut été incapable de l’imaginer. Lui-même pourtant dénonçait déjà il y a une centaine d’années la «médiocrité» dans laquelle l’université s’enfonçait en subordonnant son organisation aux rapports de séduction de nature commerciale qui y sévissaient. C’était, à l’époque, le contenu des cours qui passait pour de la marchandise, au profit de clients, qui se révélaient être les étudiants. Enseignants et professeurs se compromettaient pour attirer chez eux des étudiants tiraillés par la concurrence entre les institutions. Cela a tellement perverti les rapports avec la recherche que les choix institutionnels, aux yeux de Weber, se sont mis à relever carrément du «hasard». Le chercheur, mû par des passions impérieuses, des intuitions fortes, une imagination souveraine et le sens du travail, ne pouvait alors souhaiter réussir professionnellement que s’il affichait par ailleurs des dons tout autres lui permettant de manœuvrer dans les arcanes institutionnels. En rendant incontournables ces «conditions extérieures du métier de savant», comme Weber les décrit dans la Vocation/profession du savant en 1919, l’institution encourageait la médiocrité. «Il serait injuste d’imputer aux petits personnages des facultés ou des ministères la responsabilité d’une situation qui fait qu’un si grand nombre de médiocres jouent incontestablement un rôle considérable dans les universités. Il faut plutôt en chercher la raison dans les lois mêmes de l’action concertée des hommes, surtout dans celle de plusieurs organismes.»
On n’avait encore rien vu. Aujourd’hui, les étudiants ne sont plus ces consommateurs de l’enseignement et des diplômes offerts sur les campus, ils sont passés au rang de produits eux-mêmes. L’université vend ce qu’elle fait d’eux aux entreprises privées et autres institutions qui la financent, ses nouveaux clients, donc. Le recteur de l’Université de Montréal l’a affirmé sur le ton de l’évidence à l’automne 2011: «Les cerveaux doivent correspondre aux besoins des entreprises.» À même ses conseils décisionnels et comités d’influence, l’institution était alors gérée par des administrateurs issus des milieux bancaire (Banque Nationale), pharmaceutique (Jean Coutu), industriel (SCN-Lavalin), gazier (Gaz Métro) ou médiatique (Power Corporation et Transcontinental). L’Université de Montréal reste pourtant largement financée par l’État. Le plan d’affaires de cette maison du savoir s’apparentait soudainement aux visées d’une vulgaire télévision publique, d’aucuns comparant cette déclaration à celle de Patrick Le Lay, PDG de la télévision TF1, qui affirmait en 2004 que sa chaîne vendait «du temps de cerveau humain disponible» à Coca-Cola.
Libero Zuppiroli l’a observé en Suisse. Lorsque l’École polytechnique de Lausanne est devenue la Swiss Institute of Technology Lausanne, il a vu soudainement pousser des disciplines incongrues, au nom de l’innovation, de l’excellence et de la productivité. Elles étaient bien entendu entièrement consacrées aux intérêts du commerce, comme les théories nouvellement enseignées de la neurofinance, un nouveau secteur de la recherche qui a «pour ambition de mieux comprendre les mécanismes du raisonnement qui préludent aux opérations du négoce». Il en témoigne dans son livre de 2010, La bulle universitaire.
Les institutions qui évaluent les universités prennent alors en considération des éléments quantitatifs (nombre de publications des professeurs, nombre de diplômés, ratio de placement, etc.), fétichistes (revues scientifiques choisies, thèmes en vogue, appartenance à des réseaux, publications en anglais, etc.) et publicitaires (commandite, partenariats, présence dans les médias, etc.).
Cette «gouvernance» de l’université ne fait pas que tourner à vide, elle corrompt complètement l’institution. Comme l’illustrait en 2012 le sociologue québécois Gilles Gagné dans le quotidien Le Devoir, «si j’invente un procédé pour faire des tomates carrées et qu’une entreprise qui trouve ça génial me l’achète parce que ça rentre mieux dans son hamburger carré, est-ce que je contribue à la formation générale? Non. Je contribue à la formation du gars qui va aller travailler à faire des hamburgers carrés pour le compte de la compagnie qui a financé sa recherche de tomates».
PERDRE L’ESPRIT
La pensée se fait médiocre lorsque ses chercheurs ne se soucient pas de rendre spirituellement pertinentes les propositions qu’ils élaborent. Un autre penseur allemand du début du XXe siècle, Georg Simmel, prédisait un destin tragique aux chercheurs persistant dans cette attitude. C’est comme si, dans son embrigadement économique, la pensée traduisait dans sa pratique les tares de sa propre institution. Il lui faut produire coûte que coûte de la connaissance, peu importe l’écho qu’elle a dans le monde. C’est la théorie qui tend elle-même à devenir inflationniste. L’essai Le concept et la tragédie de la culture témoigne d’un impératif de production tel que l’esprit n’arrive plus à suivre, à se reconnaître, à se dire. La machine s’emballe et ne produit de valeur que pour satisfaire un productivisme d’appareil qui n’a plus rien à voir avec l’acte singulier de penser. D’abord parce que surabondent les éléments objectifs par lesquels la pensée se médiatise, à savoir les livres, les rapports, les œuvres qui elles-mêmes sont composées de théories, de concepts, de données factuelles. Il y a tant à considérer que l’esprit se découvre encombré dans le chemin qui doit le mener à élaborer à son tour une œuvre. Embourbé dans cette marée de productions scientifiques, il risque à son tour de ne rien faire de mieux que d’ajouter au lot un élément supplémentaire qui viendra à son tour accentuer le phénomène. On s’éloigne alors considérablement du processus de connaître, à savoir découvrir sa conscience et ce dont son esprit est capable dans «le bonheur que toute œuvre, grande ou minime, procure à son créateur». Celui-ci «comporte toujours – outre la libération des tensions internes, la démonstration de la force subjective et le contentement d’avoir rempli une exigence – vraisemblablement quelque satisfaction objective, du simple fait que cette œuvre existe et que l’univers des objets précieux à quelque titre est désormais plus riche de cette pièce-là». Le processus d’inspiration hégélienne que Simmel traduit n’est plus envisageable. Désormais, la cour est pleine, et engorgée la voie vers la réalisation de la pensée. Le productivisme et son processus d’accumulation en ont eu raison. La multiplication galopante des références obstrue l’esprit dans son travail d’assimilation lente et intime. La médiocrité s’installe alors. Tétanisé devant la montagne de références qui le précède et face à l’infinie petitesse de la question qu’on lui propose de creuser, le chercheur perd l’esprit. Il ne semble plus y avoir de sens à accomplir une œuvre supplémentaire dans le corpus de la culture en méditant ce que les anciens ont réalisé avant soi. Apparaissent plutôt en hordes des gratte-papier se satisfaisant de produire à leur tour du savoir en série, sans se soucier du sens profond que pourrait représenter leur démarche. Un philologue patenté, donné en exemple par Simmel, produira ainsi de la connaissance, massivement et sans perspective aucune.
La technique philologique par exemple s’est développée d’un côté jusqu’à atteindre une liberté insurpassable et une perfection méthodologique, mais de l’autre, le nombre des objets dont l’étude représente un intérêt véritable pour la culture intellectuelle ne s’accroît pas à la même cadence, ainsi les efforts de la philologie se muent en micrologie, en pédantisme et en travail sur l’inessentiel – comme une méthode qui tourne à vide, une norme objective continuant de fonctionner sur une voie indépendante qui ne rencontre plus celle de la culture comme accomplissement de la vie. Dans beaucoup de domaines scientifiques s’engendre ainsi ce que l’on peut appeler le savoir superflu [...]. Cette offre immense de forces jouissant également de faveurs de l’économie, toutes bien disposées, souvent même douées, pour la production intellectuelle, a conduit à l’auto-valorisation de n’importe quel travail scientifique dont la valeur, précisément, relève souvent d’une simple convention, même d’une conjuration de la caste des savants.
La recherche entre alors dans une phase tragique. Plus les institutions produisent, plus il semble impossible d’assimiler cette production aux fins d’une contribution sensée, et ainsi de suite. La production culturelle quitte alors les gonds subjectifs pour se soumettre aux impératifs autonomes de la recherche institutionnalisée.
DE SAVANTS FAISEURS D’OPINION
Dans cette «économie», il arrive aujourd’hui que l’université ne vende plus de résultats de recherche, mais seulement sa marque, celle qu’elle appose sur des rapports et dont elle détient les droits. Une firme de communication comme Edelman considère la chose acquise lorsqu’elle propose à sa partenaire, la société TransCanada, gestionnaire d’un oléoduc devant traverser le Québec, d’établir un plan de communication destiné à rendre son projet acceptable aux yeux de la population concernée. Les stratèges d’Edelman conseillent alors à TransCanada de financer une université québécoise afin que ses chercheurs qualifient le projet d’inoffensif d’un point de vue écologique. «Une campagne de financement majeure» est censée suffire pour obtenir de tels résultats, lui indiquent-ils, «cela pourrait aider à montrer le sérieux de TransCanada sur ces sujets et donner une meilleure image». Le document a été révélé par Radio-Canada en novembre 2014. Il ne s’est trouvé aucun professeur, gestionnaire ou administrateur pour dénoncer la situation et évoquer le caractère éventuellement fantaisiste de l’hypothèse. Les gestionnaires d’universités ne se sont pas sentis discrédités par ce document rendu public qui les présentait pourtant comme corrompus.
En s’arrimant sans réserve aux grandes entreprises ainsi qu’aux institutions de pouvoir, les institutions de recherche ne se sont pas contentées de vendre du savoir à leurs clientes. Elles se sont aussi faites les partenaires d’entreprises de manipulation. Les universités demeurent une carte maîtresse pour les firmes de lobbyisme, bien que leurs pratiques se révèlent hautement problématiques. C’est à tort qu’on réduit cette activité au seul démarchage auprès d’élus pour les inciter à voter dans un sens ou dans un autre. Ces spécialistes de l’opinion travaillent beaucoup plus largement à générer les conjonctures qui vont contraindre les élus, sans même qu’ils aient nécessairement à les interpeller, à orienter leurs choix dans un sens ou dans un autre. Pour travailler le réel lui-même, les lobbyistes cherchent à fabriquer un climat favorable à leurs intérêts, par exemple en mobilisant publiquement les «experts» que l’industrie finance. C’est un spectacle. Éric Eugène, lui-même lobbyiste de carrière, explique dans son livre témoignage de 2002 Le Lobbying est-il une imposture? que son métier consiste en mille moyens pour parvenir à une fin, se payer une décision de la part d’institutions autorisées, parmi lesquelles se trouvent la corruption, l’intimidation, la manipulation ou les enquêtes. Il est aisé, à son sens, de repérer un savant qui participe de ce manège. «D’où vient l’expert, quel est son plan de carrière? Travaille-t-il dans le secteur public et dans ce cas compte-t-il y terminer sa carrière ou envisage-t-il de rejoindre le privé? Qui finance le laboratoire (public ou non) dans lequel il travaille? Il est clair que l’expert n’est pas indépendant et que ses travaux sont forcément orientés par les modes de financement», écrit-il, repentant, dans son ouvrage.
En ce qui concerne l’enjeu du pipeline au Québec, Edelman a proposé à TransCanada de suivre en détective la trace des écologistes opposés à son projet, éventuellement de les discréditer au vu d’informations de nature financière ou judiciaire qu’elle découvrirait sur leur compte, tout en l’invitant à organiser de toutes pièces des manifestations populaires propétrole dont elle financerait directement les «militants». Elle a aussi avancé l’idée de rétribuer une horde d’internautes chargés d’investir les médias sociaux pour que son message y soit relayé. Des figures politiques soutenant le projet, comme Pierre Marc Johnson, Lucien Bouchard ou Monique Jérôme-Forget, auraient été également mises à contribution si le plan en question n’avait pas été éventé dans les médias. C’est dans un tel agencement que les universitaires devaient, comme si souvent, entrer en scène. Il leur suffit de jouer le jeu sans s’enquérir de l’entreprise générale à laquelle ils participent pour que les apparences restent sauves.
C’EST TERNE: C’EST SCIENTIFIQUE
La présomption des gestionnaires du savoir est toujours la même: jouer à celui qui domine la langue, faire comme si on maniait à sa guise les signaux auxquels on la réduit pour chercher par eux à persuader ses pairs de canaliser l’argent vers soi. On retirera de son formulaire tel mot qui est passé de mode, mais on misera sur telle référence qui est sur toutes les lèvres, bien qu’on ne la connaisse guère, puis on exécutera tout un slalom lexical dans la case au nombre de termes contingenté pour contenir pêle-mêle le chaud et le froid, l’ange et le démon, la vénalité et l’éthique, le consensus et la révolution. Enfin, la crânerie s’observera dans la promesse d’une tout autre attitude le jour ou on aura enfin constitué le proverbial trésor. Je ne crois pas un mot du baratin de ma demande de subvention, mais qu’on me donne l’argent et on verra de quel bois je me chauffe... Comme si on était plus fort que les mots avec lesquels on a pactisé, comme si on détenait le langage et non l’inverse. Qu’est-ce qu’on n’a pas lu Blanchot, qu’est-ce qu’on est passé outre Derrida, qu’est-ce qu’on méconnaît Lacan, qu’est-ce qu’on bafoue Kristeva! Sitôt récompensés pour leur couardise par les institutions de pouvoir, voici ces mercenaires du verbe devenir rêches et stériles, oublieux des concepts critiques dont ils se sont détournés, liés à leurs partenaires commerciaux comme à des bouées et déjà chargés de renvoyer l’ascenseur à leurs pairs en usant des mêmes idéologèmes dans leurs intitulés communs.
L’université travaille depuis de nombreuses décennies à se rendre manipulable par quiconque souhaite la financer, si ce n’est même en partie depuis sa fondation moderne. Le livre Médiocrité et folie de l’écrivain Hans Magnus Enzensberger rappelle la lointaine filiation du problème:
Le but que poursuivait l’alphabétisation de la population n’avait rien à voir avec la propagation des Lumières. Ses champions, les amis des hommes et les prêtres de la culture n’étaient que les hommes de main de l’industrie capitaliste, qui exigeait de l’État qu’il mît à sa disposition une main-d’œuvre qualifiée. [...] D’une tout autre nature, le progrès dont il était question consistait à domestiquer les analphabètes, ces «membres de la plus basse classe», à exorciser leur imagination et leur entêtement, pour exploiter désormais non plus seulement leur force musculaire et leur adresse, mais aussi leurs cerveaux.
L’habitus universitaire consiste à se laisser dominer. Ses professionnels étant en pleine déroute, seul l’argent semble donner de la consistance à leurs pratiques. La façon dont elle conçoit sa propre langue dans le travail de recherche découle de cette capitulation. Une règle implicite prévaut dans l’écriture universitaire – et on ne tarde pas à l’expliciter dès lors que quelqu’un y déroge –, à savoir qu’est digne de science une prose dont le ton est neutre, posé et calibré. Terne, si possible. Du point de vue du style, un propos affichant des prétentions au savoir doit osciller autour de l’axe du juste milieu. Si ce n’est pas le cas, un malaise s’installe. Un distingué professeur appréhendera une proposition dès lors qu’elle se trouve présentée autrement qu’en fonction des exigences de la pensée objective. Si l’art et la manière lui semblent impropres aux exigences du milieu, mais qu’il en reconnaît la pertinence, il se contentera éventuellement de la reprendre, mais sans s’y référer nommément. Car le ton est capital.
Le ton a d’abord à voir avec le choix des mots. Il sera préférable de recourir à des concepts d’apparence savante pour désigner une chose, ne serait-ce que pour suggérer qu’on n’inscrit pas in situ la pensée que l’on développe. Ne pas parler d’«argent», par exemple, mais seulement évoquer la «monnaie». Aussi, user de termes qui ne sont pas susceptibles d’être chargés d’émotion dans l’histoire: éviter ainsi de parler de «révoltes politiques», mais dire: la «résilience». Ne pas traiter des «classes», mais des «catégories» sociales. On a même déjà fait les fines bouches devant l’expression «justice fiscale», «trop politique».
Ensuite, ne pas accabler de termes crus des acteurs sociaux en vue, surtout s’ils sont puissants, par exemple des multinationales. On pourrait y lire une forme de ressentiment qui contredit l’appel à la neutralité axiologique, comprise selon une lecture étroite du sociologue Max Weber. Pour éviter de susciter d’aussi désagréables impressions, il vaut mieux éviter tout le lexique du droit pénal en faisant comme s’il était l’apanage des seuls juristes – le cas échéant évoquer des «actes douteux» et de la «mal gouvernance» plutôt que des «crimes» et des actes de «pillage». On accolera des termes issus du droit criminel exclusivement à des agissements qualifiés ainsi par des tribunaux – on pourra alors juger ouvertement «criminel» le comportement d’un Bernard Madoff, par exemple. On fera comm...
Table des matières
- Couverture
- Page de demi-titre
- Page titre
- Page de crédits
- Introduction: La médiocratie
- Chapitre 1: Le « savoir » et l’expertise
- Chapitre 2: Le commerce et la finance
- Chapitre 3: Culture et civilisation
- Chapitre 4: La révolution: rendre révolu ce qui nuit à la chose commune
- Remerciements
- Références
- Déjà parus dans la collection « Lettres libres »
- Page de marque