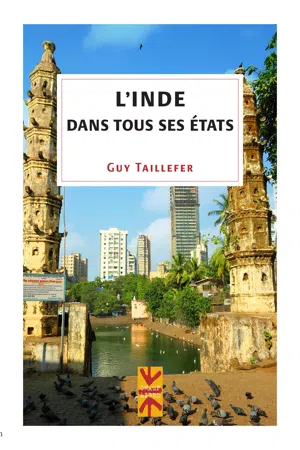![]()
Les champs de bataille
de la démocratie
«Je crois depuis longtemps que l’Inde est le pays le plus intéressant au monde. Je l’affirme dans un esprit impartial d’historien, pas dans l’esprit partisan du citoyen indien. L’Inde est peut-être le pays le plus exaspérant et le plus hiérarchisé au monde, ou le plus impitoyable socialement, mais quel que soit le qualificatif qu’on choisit, il demeure aussi le plus intéressant.»
Ramachandra Guha, Makers of Modern India
![]()
Ouestoxication
«L’Inde est un pays plus difficile à décrire qu’à expliquer, et plus facile à expliquer qu’à comprendre.» Mots d’Anand Giridharadas, chroniqueur au New York Times, repérés dans un essai sur la politique extérieure indienne publié en 2011 par le diplomate canadien David Malone.
Giridharadas est l’intellectuel globe-trotteur type. Malone aussi, en fait. Indo-Américain né à Cleveland de parents originaires de Mumbai (Bombay), Giridharadas est diplômé d’une université américaine en histoire de la pensée politique. A vécu à Paris. Est retourné un certain temps dans la métropole indienne pour y travailler comme consultant chez McKinsey. Avant de publier un livre intitulé India Calling: An Intimate Portrait of a Nation’s Remaking…
Le sujet interpelle un grand nombre d’intellectuels indiens: ils regardent la vie grouiller et s’emploient à la décortiquer, à la démonter comme une horloge – sans nécessairement chercher à défendre une thèse, pour la bonne raison que cette réalité est à l’heure actuelle trop changeante pour être mise en boîte. Ce qui n’exclut pas que, par atavisme, elle soit finement (ou ne faudrait-il pas plutôt dire brutalement?) organisée sous ses apparences de bazar absolu. Le spectacle de la vie indienne est un road-movie dont les chemins sont un dédale où il y a du bonheur à se perdre.
Au demeurant, les Indiens ne se privent pas de cultiver, dans la façon dont ils se projettent à l’extérieur de leurs frontières, cette perception que leur monde, leur société et leur civilisation tiennent de l’insondable. L’Occidental n’aime rien de mieux, bien souvent, que de jouer le jeu du mysticisme hindou. J’y vois aussi, mais ça n’est guère qu’une intuition, un trait de culture: les Indiens, qui sont curieux de l’extérieur en même temps que tournés sur eux-mêmes, ne sont pas des gens qui se dévoilent si facilement.
Dans quelle mesure, de toute façon, se connaissent-ils les uns les autres? Croisements mouvants et superposition déroutante de castes et de sous-castes, de grandes masses démographiques, d’identités ethniques et linguistiques, de pratiques religieuses, de conditions sociales… Les Indiens sont obéissants. L’œil incompétent ne voit pas qu’avant tout, les Indiens se jaugent avec une précision géométrique, cherchent moins à se connaître qu’à se situer verticalement et horizontalement l’un par rapport à l’autre dans la hiérarchie. Je tombe dans mes notes sur cette citation: «In India, you’re eternally a master and eternally a servant.»
Dans la voiture qui nous ramène d’une visite d’usine d’amiante-ciment dans le quartier industriel de Faridabad, sur la route d’Agra, je pose au cadre qui m’accompagne la question que je pose à un peu tout le monde: «L’Inde change-t-elle autant qu’on le dit?» Question à développements. Oh! que oui!, répond le monsieur. Et lui, très conservateur dans sa façon de voir les choses, de se désoler en particulier de toutes ces libertés que prennent maintenant les jeunes femmes, preuve que les traditions se perdent et que les valeurs «modernes et occidentales» – il utilise les deux adjectifs indifféremment – ont une sale influence…
L’impression m’est que l’Inde «indianise» cette influence autant, sinon davantage, que cette influence n’occidentalise la société indienne. On voit trop dans l’hégémonisme américain une force inéluctable. Dipankar Gupta, sociologue bien en vue à Delhi, a sur cette grande question une position provocante à l’égard des siens, pour ne pas dire méchante, dans un essai qu’il a écrit au début des années 2000, intitulé Mistaken Modernity. Il y a encore beaucoup d’hypocrisie, soutient-il, au sein des classes moyennes: elles cantonnent la modernité, une modernité «superficielle», au développement technologique et à l’accès à la consommation, sans véritablement modifier leurs attitudes et leurs comportements. Les ingénieurs de Bangalore sont à la fine pointe de la technologie indienne, mais pour la majorité d’entre eux, il ne saurait être question de faire un mariage hors de leur caste. Ces Indiens-là ne sont pas tant modernes, dit-il, que westoxicated – intoxiqués par l’Occident. «Ils utilisent leurs privilèges et leur accès à la richesse pour étaler leur distance d’avec le reste.» Le passé, estime-t-il, continue de s’accrocher avec ténacité au présent.
Bien entendu. Mais, justement, tout se joue sur plusieurs tableaux à la fois. Par exemple, ce petit groupe de femmes d’un village de l’Uttar Pradesh, situé dans une région tristement célèbre pour le nombre de «crimes d’honneur» qui y sont commis… Il y a des mois qu’elles se battent contre la décision des autorités locales, réactionnaires au possible, d’interdire aux femmes, spécialement les jeunes et les célibataires, d’utiliser un… téléphone cellulaire. Le road-movie indien est un peu beaucoup le récit de celles qui ont le courage de désobéir, de ne pas laisser le passé les intimider.
Je prends un café avec M. Gupta dans un Barista (version indienne du Starbucks) de Vasant Vihar, un beau quartier de South Delhi. Il m’apprend qu’il a étudié à Montréal, à l’Université McGill, à la fin des années 1970 (ce n’est pas que le monde est petit, c’est que nous sommes plusieurs à emprunter les mêmes circuits). Il parle avec enthousiasme de l’élection de René Lévesque en 1976. Même que sa mémoire des événements est plus complète que la mienne. J’avance que la société indienne est d’une complexité qui me dépasse. Il répond que toutes les sociétés sont complexes, laisse entendre qu’à sa façon, la québécoise ne l’est pas nécessairement moins que l’indienne. M. Gupta a l’esprit pétillant, on l’écoute même quand il dérape.
24 mai 2011
![]()
Le croquis
L’indépendance sitôt faite en 1947, il y eut consensus en Inde, y compris parmi ses grandes familles industrielles, pour donner au pays une orientation socialiste. «A socialistic pattern of society», disait le premier premier ministre indien Jawaharlal Nehru. «Pattern» non pas tant au sens de système que de modèle, de motif. L’État allait contrôler l’économie et ses plans quinquennaux allaient montrer le chemin au peuple; l’industrie lourde portée par une entreprise privée qui accepterait de bon gré d’être tenue en laisse allait devenir le moteur du développement. En temps et lieux, comme on sait, la mainmise du Parti du Congrès sur le pouvoir rendrait l’État beaucoup plus dirigiste – et concurremment plus corrompu – que ne l’avait rêvé l’idéaliste Nehru.
C’était dans l’air du temps. En Asie, impérialisme et capitalisme étaient des mots sales. Cette adéquation a été rompue – le premier l’est toujours, le second l’est beaucoup moins. En Inde, Nehru avait un biais favorable à l’URSS et à ses projets herculéens – un biais auquel il n’aura jamais vraiment réussi à renoncer malgré les dérapages de la dictature soviétique. Les principes de l’économie planifiée et les grands projets d’infrastructure, voulait-on croire, allaient être la garantie d’une plus grande justice sociale et un puissant antidote aux divisions de caste et de religion.
Du reste, il y avait un peu partout communauté d’esprit parmi les économistes occidentaux en faveur de l’État interventionniste. Malgré tout le mal qu’elles pensaient de l’empire américain, les élites indiennes en train de jeter les bases de l’Inde nouvelle voyaient un modèle à imiter dans le Tennessee Valley Authority, grand projet de développement économique intégré qui fut l’une des pierres angulaires du New Deal de Franklin Roosevelt dans les années 1930.
Fut rapidement établi que la modernisation du pays, fondée sur le souci très gandhien (et anticolonialiste) d’autosuffisance, passait au premier chef par la construction de grands barrages hydroélectriques et par la production d’acier. Les grands barrages, que Nehru appelait «les temples de l’Inde moderne», allaient faire d’une pierre trois coups: produire de l’électricité, prévenir les inondations et fournir de l’eau aux fins d’irrigation agricole et, ce faisant, libérer les paysans de la tyrannie de la mousson.
À l’indépendance, l’Inde ne dispose que de deux aciéries. Trois nouvelles entrent en opération à la fin des années 1950, l’une ayant été construite par les Allemands, les deux autres par les Britanniques et les Russes, au grand dam des Américains qui avaient participé à la course aux contrats. Ces ouvrages sont à l’époque motif parmi les Indiens, du moins parmi l’élite, de grande fierté nationale, relate dans sa brique intitulée India After Gandhi (2008) l’historien Ramachandra Guha. Preuve, se disaient-ils, qu’ils entraient dans la modernité et donc, écrit Guha, réfutation concrète de l’indécrottable préjugé voulant «que les Indiens soient improductifs et non scientifiques – en un mot, arriérés».
Le préjugé n’a jamais vraiment cessé de coller, malgré leur bombe atomique et l’extraordinaire percée qu’ils ont faite depuis une quinzaine d’années dans le domaine des technologies de l’information. Le plus frappant à lire cet historien – dont la mémoire tient compte par ailleurs des dissidents que l’enthousiasme ambiant n’emballait pas –, c’est de voir à quel point les élites indiennes paraissent éprouver toujours aussi vivement, un demi-siècle plus tard, le besoin de se prouver à elles-mêmes et de prouver aux autres, nommément occidentaux, qu’elles sont «modernes». Ces élites ont fondu de bonheur à entendre Barak Obama leur dire, lors de sa visite de novembre 2010, que l’Inde était «non pas une puissance émergente, mais une puissance émergée».
Ce qui est frappant, c’est aussi que la foi en l’avenir qui animait les Indiens dans les années 1950 n’a d’égale que celle qui les anime aujourd’hui encore – sur fond de recette économique autrement plus néolibérale que néhruvienne, même si le pays procède toujours par plans quinquennaux et que l’État indien demeure le financier principal de la croissance.
La grande industrie n’est pas encore devenue le moteur de développement qu’imaginaient les idéateurs de l’Union. Les Indiens sont aujourd’hui tout autant à l’urgence d’améliorer leurs infrastructures qu’ils ne l’étaient il y a soixante ans. L’agriculture reste le gagne-pain de la majorité de la population et l’irrigation des terres demeure une chimère pour de larges pans de la population, avec la notable exception du Pendjab. Soixante ans plus tard, l’Inde demeure à bien des égards une ébauche, une esquisse, un croquis.
22 août 2011
![]()
Sophisme
Il se trouve en général que la mémoire, pour peu qu’on la convoque, éclaire utilement l’actualité. On devrait la convoquer plus souvent. En 1991, Manmohan Singh, alors ministre des Finances, est auréolé pour avoir sauvé du désastre, grâce à une série de mesures de libéralisation, l’économie indienne mise K.O. par la mort de l’ami soviétique. L’année suivante, raconte l’historien Ramachandra Guha dans un papier sombrement intitulé Terminal Damage, M. Singh prononce un discours sur «l’environnement et les nouvelles politiques économiques» dans lequel il se déclare «convaincu» que la levée des contrôles bureaucratiques qui étouffent l’activité économique indienne va «puissamment» contribuer à réduire la pauvreté et à protéger l’environnement.
Les vingt dernières années ont amplement démontré qu’en matière d’environnement, c’était pur sophisme. «La libéralisation n’a pas amélioré notre situation environnementale, écrit Guha. Au contraire, les écosystèmes ont continué à se détériorer, pendant que les conflits sociaux ont augmenté. Les deux dernières décennies ont été témoins d’une destruction systématique de nos forêts, de nos rivières et de notre atmosphère, alors que les permis d’exploitation ont été distribués aux industries et aux minières sans le moindre égard pour notre avenir à long terme comme pays et comme civilisation.» S’était développé dans les années 1970 et 1980, rappelle-t-il, un dynamique mouvement environnementaliste indien qui avait réussi à faire adopter par le gouvernement une série d’importantes mesures de préservation. «Ces mécanismes de sauvegarde ont été complètement démantelés avec la libéralisation.»
Et ça continue! Le ministère de l’Environnement avait mandaté Mahdav Gadgil, écologiste renommé, pour produire une étude sur les Ghats occidentaux, cette chaîne de montagnes qui surplombe la côte ouest du sous-continent, de Mumbai à l’extrême sud du pays. Un écosystème qui abrite des centaines de millions de personnes. Le rapport, qui vient tout juste d’être déposé, défend avec précision, dit Guha, l’importance d’équilibrer de façon judicieuse développement économique et conservation et d’appliquer pour de vrai, et non pas seulement en façade, les mécanismes d’évaluation des projets et de consultation populaire prévus par la loi. Le rapport a été accueilli avec indifférence, sinon avec hostilité de la part du gouvernement.
Si un journaliste est un descripteur professionnel de la vie quotidienne, il est aussi un «je». D’où une inévitable zone grise. Or, «j»’observe tous les jours, depuis près de trois ans que je suis en Inde, que sa singulière démocratie tient bon, même si ce n’est parfois que par un fil, mais que, déplorablement, le pays croît économiquement à bon train sans s’attaquer aux racines de son gigantesque problème de pauvreté et d’injustice sociale. Difficile d’affirmer, dans l’ordre actuel des choses, que l’Inde est sur la bonne voie. L’année dernière, ou peut-être l’année d’avant, j’assistais à une table ronde sur le thème, justement, de la représentation – journalistique, analytique, poétique, ciné-documentaire… – de la société indienne. À la fin, le responsable d’un think tank canadien s’approche et me dit: «Je trouve vos textes noirs, très noirs.» Touché!
Mais il se trouve que la grande majorité des Indiens – à gauche, au centre, à droite – que je croise, que j’interviewe, que je lis considèrent que le pays est sur une pente dangereuse, au premier chef parce qu’ils trouvent que l’État et les élites politiques ont complètement perdu le nord. L’autre jour, mon dentiste en train de me réparer une molaire me prend gentiment à partie: «Ça m’embête beaucoup, cette tendance d’une certaine presse internationale à donner l’impression que l’Inde est indubitablement en marche vers la prospérité. Ça n’est pas vrai du tout. Nous avons de gros problèmes.» Mon dentiste est dans la soixantaine, possède un beau cabinet dans un beau quartier de Delhi. Il aurait les moyens de feindre l’indifférence.
Harsh Mander est un homme dans la cinquantaine qui dirige le Center for Equity Studies. Ses bureaux exigus sont situés au bout d’une étroite ruelle en cul-de-sac. Jusqu’à tout récemment, M. Mander faisait partie du National Advisory Council (NAC), un organisme qui, pour consultatif qu’il soit, a de l’ascendant en matière de politiques sociales, ayant été créé par Sonia Gandhi, la reine-mère du gouvernement de coalition du premier ministre Manmohan Singh (2004-2014). M. Mander vient de s’en voir doucement montré la porte, pour avoir souligné avec trop d’insistance les insuffisances d’un projet de loi sur la sécurité alimentaire. En même temps d’ailleurs que M. Gadgil, qui faisait aussi partie du NAC.
M. Mander entend parfois dire autour de lui que la démocratie indienne est une imposture, et trouve cela parfaitement exagéré. Reste, me disait-il en entrevue, qu’«on en arrive au point où le modèle capitaliste de marché est si prédominant dans l’esprit du gouvernement, des élites et même de la classe moyenne qu’il en vient à proscrire les débats sur les enjeux d’équité sociale». La démocratie indienne n’est pas une imposture, mais «le champ de cette démocratie se rétrécit».
30 juillet 2012
![]()
Les marcheurs et le marché
En 2007, 20 000 petits paysans avaient marché depuis la petite ville de Gwalior, dans le Madhya Pradesh, jusqu’à Delhi pour défendre leur pitance et dénoncer cette injustice croissante qui consiste en la saisie, manu militari, de terres agricoles à des fins de développement industriel. Une balade de 340 kilomètres. Les élections générales – qui allaient réélire en 2009 le Parti du Congrès pour un deuxième mandat consécutif – approchaient. Un comité avait été formé, avec promesses de justice et de réparation à la clé, comité que le premier ministre Manmohan Singh avait décidé de prendre personnellement en main. C’était dire, non?, combien le Congrès jugeait l’enjeu important… Sauf qu’en cinq ans, le comité n’a jamais siégé. Pas même une fois.
La politique, c’est l’art du possible… et celui de noyer le poisson.
C’est un militant gandhien, Rajagopal, qui avait organisé la marche des sans-terre en 2007. L’homme aujourd’hui âgé d’une soixantaine d’années se fait appeler par son prénom pour éviter qu’on l’identifie à sa caste. Façon de faire savoir que, si le pays veut progresser, il faudra bien un jour qu’il finisse par en finir avec ce système inique. Il a fondé en 1991 une organisation populaire qui regrouperait 200 000 membres, surtout des femmes, et qui s’attaque en particulier au très mauvais sort réservé aux adivasis, la minorité autochtone de l’Inde qui, pour minoritaire qu’elle soit, rassemble près de 70 millions de personnes. Sa technique de mobilisation privilégiée, c’est la padayatra (le voyage à pied), par laquelle le mahatma Gandhi a marqué l’histoire avec sa «marche du sel» en 1930. L’Inde urbaine et battante va, elle, en BMW. L’autre voyage léger.
Le poisson serait encore noyé si Rajagopal n’avait décidé de remettre ça. Le 2 octobre 2012, 35 000 personnes sont reparties de Gwalior, en direction de Delhi. Les marcheurs prévoyaient entrer dans la capitale vers la fin du mois, mais ils se sont arrêtés jeudi dernier à Agr...