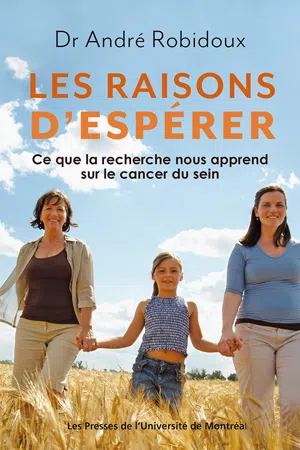
eBook - ePub
Les raisons d'espérer
Ce que la recherche nous apprend sur le cancer le sein
This is a test
- 262 pages
- French
- ePUB (adapté aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Détails du livre
Aperçu du livre
Table des matières
Citations
À propos de ce livre
Maladie sournoise, le cancer du sein touche plus de la moitié de la population, et pour ainsi dire toutes les familles. Mais, parce que c'est une maladie complexe, elle reste mal comprise et on a tendance à oublier les progrès énormes accomplis ces dernières années par la recherche scientifique. Le docteur André Robidoux, qui a dirigé des recherches impliquant des milliers de patientes, est bien placé pour expliquer au grand public la maladie dans toute sa diversité et les traitements les mieux adaptés qui permettent non seulement d'espérer, mais de sauver des vies dès maintenant.
Foire aux questions
Il vous suffit de vous rendre dans la section compte dans paramètres et de cliquer sur « Résilier l’abonnement ». C’est aussi simple que cela ! Une fois que vous aurez résilié votre abonnement, il restera actif pour le reste de la période pour laquelle vous avez payé. Découvrez-en plus ici.
Pour le moment, tous nos livres en format ePub adaptés aux mobiles peuvent être téléchargés via l’application. La plupart de nos PDF sont également disponibles en téléchargement et les autres seront téléchargeables très prochainement. Découvrez-en plus ici.
Les deux abonnements vous donnent un accès complet à la bibliothèque et à toutes les fonctionnalités de Perlego. Les seules différences sont les tarifs ainsi que la période d’abonnement : avec l’abonnement annuel, vous économiserez environ 30 % par rapport à 12 mois d’abonnement mensuel.
Nous sommes un service d’abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d’un seul livre par mois. Avec plus d’un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu’il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l’écouter. L’outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l’accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui, vous pouvez accéder à Les raisons d'espérer par André Robidoux en format PDF et/ou ePUB ainsi qu’à d’autres livres populaires dans Medizin et Onkologie. Nous disposons de plus d’un million d’ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
CHAPITRE 1
Mon parcours de chirurgien oncologue
UN MATIN DU MOIS DE JUILLET 1968 à Sorel, la petite ville où je suis né, ma vie a basculé quand j’ai reçu la lettre de l’Université de Montréal m’annonçant que j’étais accepté en médecine. Mon rêve était devenu réalité. Enfin j’allais me consacrer à ma passion. J’avais 18 ans.
Je suis de la génération de ceux qui ont suivi le cours classique au secondaire, qui conduisait au baccalauréat ès arts. On étudiait entre autres les éléments latins, la syntaxe, la méthode, la versification, les belles-lettres, la rhétorique et la philosophie. Intellectuel et curieux de nature – je m’intéressais à l’origine des choses, des mots, des idées –, je savais que je voulais faire des études supérieures. « Tu seras avocat, curé ou médecin », me disait-on. Par élimination et par goût pour les sciences, j’ai su très tôt que mon choix se porterait sur la médecine.
La naissance d’une vocation
Je suis issu d’une famille modeste, l’aîné d’une fratrie de sept enfants. Mon père est décédé à l’âge de 44 ans d’un cancer du poumon lorsque j’avais 18 ans, laissant son épouse seule avec sa marmaille. La cadette n’avait que quatre ans. Mon intérêt pour le cancer est né à cette époque-là.
Un après-midi du mois de mai 1967, ma mère a reçu un appel de l’hôpital de Sorel. Un homme hémiplégique – il ne pouvait plus bouger un de ses bras et il ne parlait plus – avait été trouvé immobile au bord de la rivière où il pêchait, c’était mon père. Il a rapidement été transféré à Montréal – signe que son cas était grave – où il a subi la batterie de tests et d’analyses habituels ; alors que rien ne l’annonçait, on a découvert qu’il était atteint d’un cancer au poumon et que des métastases s’étaient formées au cerveau.
Le cancer du poumon était déjà fréquent à l’époque ; on savait que fumer n’était pas bon pour la santé, mais le lien de cause à effet entre tabagisme et cancer pulmonaire n’était pas aussi clair qu’aujourd’hui. Depuis ce choc familial, la médecine et le cancer ont été au centre de mes préoccupations. Plus tard, ma mère est décédée d’un cancer du sein. Puis une belle-sœur. Si j’ai consacré ma vie entière à la cause du cancer du sein, une maladie par ailleurs fascinante à étudier, nul doute que cela soit lié à ces raisons personnelles.
Après le décès de mon père, ma mère a dû travailler avec beaucoup d’ardeur et de courage pour amener ses enfants à l’âge adulte, éduqués – nous avons tous fait des études supérieures – et armés pour affronter la vie. Elle a réussi. À 18 ans, j’ai trouvé mon premier emploi d’été – pas question de partir en vacances ; le curé de la paroisse m’avait déniché un travail dans une fonderie pour que je puisse payer mes études. C’était dur. L’usine ne fermait pas, on travaillait jour et nuit par rotation de 8 heures ; c’était souvent frustrant de partir travailler en fin d’après-midi alors que mes amis se retrouvaient au cinéma ou se préparaient pour aller danser. J’ai cependant travaillé dans cette fonderie tous les étés durant cinq ans. À la fin de mes études de médecine générale, j’avais déjà à mon actif une année d’expérience professionnelle à l’usine !
J’étais déterminé. Je dois à mes parents deux qualités qui me sont encore précieuses aujourd’hui, la persévérance, qui vient de ma mère, et la créativité, qui caractérisait mon père. Ma mère était une femme courageuse, tenace et qui ne ménageait pas sa peine. Elle avait le sens des priorités et des responsabilités. Quant à mon père, c’était un homme inventif, ingénieux et débrouillard. Il créait sans cesse toutes sortes de choses ; ce goût pour l’innovation a d’ailleurs prospéré dans la famille.
Mes débuts en chirurgie
Les premières fois où j’ai dû faire face au cancer, non plus d’un point de vue personnel mais professionnel, remontent à l’époque où j’étais externe en chirurgie à l’Hôpital Notre-Dame de Montréal. C’était en 1972. Je me souviens du cas d’une femme qui devait être opérée d’urgence car elle présentait une boule au sein. Le jeune étudiant que j’étais à l’époque n’avait jamais traité de cas de cancer du sein mais, malgré mon manque d’expérience, je reconnaissais tous les signes de la maladie. Dans les années 1970, le traitement du cancer du sein était peu raffiné, comme nous le verrons plus loin : lorsqu’une femme nous consultait pour une boule dure et froide dans son sein, on lui faisait une biopsie sous anesthésie générale dès le lendemain de sa visite ; si celle-ci montrait des traces de cellules cancéreuses, on lui retirait sur-le-champ le sein ainsi que les muscles pectoraux situés en dessous et les ganglions de l’aisselle ; on effectuait ensuite une greffe de peau prélevée sur sa cuisse pour recouvrir la plaie. Au début des années 1970, on pensait encore que les chances de survie étaient liées à la taille de la tumeur et que plus on retirait de chair, meilleures elles étaient. Amputer le plus largement possible, c’était la tradition qui perdurait depuis des siècles. Pour autant, cela ne me convenait pas, je trouvais ce traitement traumatisant pour les femmes. En 1973, alors que j’étais interne à l’Hôpital du Sacré-Cœur à Montréal, le même cas s’est présenté à moi : une femme est arrivée au bloc opératoire avec une boule suspecte au sein et en est ressortie amputée d’un sein, des muscles pectoraux et des ganglions.
Autant cette pratique de mastectomie radicale faisait l’unanimité auprès des chirurgiens, autant on ne savait pas très bien quels soins apporter à la suite de la chirurgie. Il faut dire que les spécialités médicales de l’oncologie n’existaient pas encore au Québec ; la seule spécialité qui était mise à contribution dans les soins postopératoires était la radiothérapie. Fallait-il faire de la radiothérapie sur le sein qui n’existait plus ? Sur les ganglions de l’aisselle ? C’était un grand débat qui animait la communauté scientifique et chacun avait son idée sur le sujet.
Un jour, un étudiant de notre département nous a présenté un article scientifique écrit par un chirurgien américain, un dénommé Bernard Fisher, qui remettait en question notre approche du traitement du cancer du sein. Il avançait dans son article que chaque praticien avait son opinion sur les meilleurs soins à donner aux patientes, mais que la plupart de ces opinions n’étaient pas fondées sur des données probantes. Aucune étude scientifique, en effet, ne permettait de trancher quant à la question de la valeur ajoutée de la radiothérapie ou quant au bénéfice de la mastectomie radicale. Bernard Fisher était l’un des premiers à écrire noir sur blanc que rien ne démontrait que l’ablation du sein, des muscles pectoraux et des ganglions augmentait les chances de survie de la patiente. Peut-être cette pratique était-elle inutile dans le cas de certains cancers. Un pavé dans la mare. Cet article a provoqué un véritable tollé dans notre communauté scientifique. Certains chirurgiens pensaient qu’effectivement nous devions nous remettre en question et d’autres arguaient qu’il était de notre devoir d’avoir une ligne de conduite ferme et de nous y tenir. La controverse était virulente. Pour moi, remettre en question l’enseignement de mes maîtres n’était pas chose facile. Je partageais cependant l’idée que nous pouvions nous tromper et qu’il fallait peut-être repenser notre pratique chirurgicale dans le traitement du cancer du sein.
Malgré tout, quand il m’a fallu choisir une spécialité après mes études de médecine générale, la chirurgie l’a emporté naturellement. Cela restait à mes yeux la discipline la plus efficace pour guérir les malades. Prenons l’exemple de l’appendicite aiguë : retirer la partie inflammatoire de l’intestin est effectivement le moyen le plus efficace pour éviter une infection généralisée. Quelle autre discipline permet d’obtenir un effet et un bénéfice aussi rapides chez le patient ? Je me souviens d’un cas clinique qui m’avait particulièrement frustré. J’avais rencontré à l’hôpital une personne hémiplégique qui venait de subir un accident cardiovasculaire au cerveau. Je lui avais fait passer tous les examens nécessaires pour connaître en détail la zone de son cerveau qui avait été touchée et voir quelle artère avait été endommagée. À l’issue des examens, j’avais un beau diagnostic. Mais que pouvais-je faire de plus ? Rien. Cela ne me plaisait pas. Ma vie de médecin allait-elle ainsi se résumer à faire de beaux diagnostics ? Comment pouvais-je agir de manière plus efficace ? Cela me tracassait. Dans le désir où j’étais de pouvoir agir et constater le bénéfice de mon action, la chirurgie s’est imposée à moi. Pour autant, je gardais un vif intérêt pour la médecine et je trouvais logique d’associer les traitements médical et chirurgical du cancer dans ma pratique.
La recherche universitaire
À l’issue de mes examens, j’ai dû à nouveau faire un choix : je pouvais pratiquer la chirurgie générale en région, comme de nombreux collègues l’ont fait, ou me diriger vers la recherche universitaire. J’ai opté pour cette dernière, qui me paraissait la voie la plus efficace pour faire avancer la qualité des traitements du cancer du sein. À cette fin, je devais suivre une formation complémentaire ; en effet, il ne suffisait pas d’être chirurgien, je devais apporter quelque chose de nouveau à la communauté scientifique. Pour cela, j’avais encore beaucoup à apprendre. J’avais certes opéré des patientes atteintes d’un cancer du sein, j’avais extrait des tumeurs cancéreuses, mais je ne connaissais rien à la cancérologie en général et, bien sûr, rien à la chimiothérapie ni à l’immunothérapie. On parlait déjà à l’époque de vaccins contre le cancer, mais j’ignorais tout du sujet. Je ne connaissais rien non plus aux essais cliniques ; je n’avais jamais conçu de protocole de recherche ni même participé à la mise sur pied de tels protocoles. J’avais opéré pendant quatre ans et c’était tout. Il m’arrivait quelquefois de revoir une patiente pour une récidive ou des métastases – comme quoi l’opération n’avait pas été efficace – et je l’opérais à nouveau quand cela était possible. Mon rôle s’arrêtait là. En fait, je ne guérissais pas toutes mes patientes par le bistouri.
Désireux à la fois de poursuivre ma formation et de m’initier à la recherche, j’ai finalement présenté, avec l’aide du Dr Jean Panet Fauteux, directeur du Département de chirurgie à l’Université de Montréal, ma candidature au MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas – le plus grand centre de recherche sur le cancer aux États-Unis –, pour travailler dans le département du Development Therapeutics auprès du Dr Emile Freireich. Le professeur a tout d’abord été perplexe, il ne comprenait pas pourquoi un jeune chirurgien comme moi s’intéressait à des approches non chirurgicales et se demandait si je ne m’étais pas trompé d’adresse. J’ai dû expliquer la raison pour laquelle je postulais et faire valoir le fait que, en tant que premier acteur dans le traitement du cancer du sein, le chirurgien devait avoir accès aux autres connaissances acquises dans le traitement du cancer et la recherche clinique pour enrichir son approche. J’ai finalement été accepté et ai reçu une bourse du Conseil de recherche médicale du Canada. Au MD Anderson Cancer Center, j’ai rencontré des étudiants hyper spécialisés qui venaient de la médecine pure ; comparé à eux, j’étais une sorte d’hybride, un chirurgien oncologue qui voulait devenir chercheur… un spécimen rare.
À cette époque – c’était à la fin des années 1970 –, le sujet de recherche à la mode dans le monde de la cancérologie était le système immunitaire. On pensait qu’en le stimulant, on pouvait augmenter la résistance du corps humain et ainsi éviter l’apparition du cancer. Au centre de recherche du Texas, on travaillait, entre autres, sur l’effet du BCG (un vaccin contre la tuberculose) sur le cancer du côlon ou du sein. La méthode consistait à vacciner un groupe de femmes et à les comparer avec d’autres qui n’avaient pas été vaccinées. On voulait savoir si la stimulation des défenses immunologiques générales avec des agents microbiens pouvait prémunir contre le cancer. Plus précisément, il s’agissait de savoir si, ce faisant, on stimulait l’immunité en général ou l’immunité bactérienne contre la tuberculose en particulier. Et jusqu’à quelle dose limite fallait-il stimuler l’organisme ? Quelle était la dose suffisante ? À force de stimuler l’organisme, ne risquait-on pas d’obtenir paradoxalement l’effet inverse de celui qui était recherché ? Toutes ces considérations propres à la recherche, je les ai découvertes au MD Anderson Cancer Center. À partir de cette période, ma vie a véritablement changé. J’ai pris conscience de la dimension multifactorielle du cancer, j’ai acquis des compétences, entre autres, en chimiothérapie, en immunothérapie, en évaluation des tests immunologiques du patient cancéreux et j’ai découvert le monde des essais cliniques. Bref, je me suis fabriqué ma boîte à outils.
Mon fellowship – stage de formation postdoctoral – au Texas a duré deux ans. Deux très belles années. J’étais jeune marié, j’avais fini mes examens, je terminais une formation qui me permettrait de partir travailler partout dans le monde, je rencontrais les plus grands spécialistes et, cerise sur le gâteau, je travaillais sur des sujets avant-gardistes où tout était à faire. Pourtant, mon intégration au Texas n’avait pas été facile. Canadien français, j’arrivais dans la culture américaine du « Deep South » et je me suis trouvé tout d’abord littéralement perdu ! L’accent, la langue américaine, les fusils de chasse dans les « pick-up trucks », les chapeaux et les bottes de cow-boy, tout cela m’était complètement étranger. J’ai mis six mois à me familiariser avec la culture américaine et les us et coutumes texans et à les apprécier. Grâce à un petit groupe d’amis canadiens-français comme moi, les Drs Jean Latreille, oncologue médical, et Louis Begin, pathologiste, nos fins de semaine étaient toujours très animées. On accueillait les nouveaux arrivants, des Québécois, des Canadiens, mais aussi des Japonais, des Indiens, des Européens ; c’était un bouillon de culture très riche.
De retour au pays
Le MD Anderson Cancer Center où j’avais travaillé était un centre particulier : il recevait des femmes atteintes d’un cancer pour les soigner mais aussi pour mener des recherches scientifiques sur les meilleurs traitements à leur apporter. Des protocoles de recherche clinique spécifiques étaient élaborés en fonction des problématiques particulières que présentaient les patientes. Il s’agissait donc de protocoles de recherche expérimentaux taillés sur mesure. Les patientes s’inscrivaient dans des programmes de recherche et suivaient un protocole rigoureux destiné à vérifier les bénéfices d’un traitement expérimental. Cette approche orientée à la fois vers la recherche et vers le traitement clinique a profondément marqué ma pratique professionnelle et a influencé toute ma carrière.
À mon retour à Montréal en 1980, j’ai vite compris que l’approche du traitement du cancer du sein n’était pas aussi audacieuse et ambitieuse au Québec qu’au centre du cancer Anderson au Texas. C’est compréhensible, la population du Québec était d’environ 7 millions d’habitants, soit à peine la population d’une grande ville américaine, mais distribuée sur un territoire trois fois plus grand que la France. Les médecins prescrivaient partout au pays des traitements standards – reconnus comme très imparfaits – et cela s’arrêtait là. Il y avait peu de place pour l’innovation comme pour la recherche clinique sur le cancer du sein. Je ne retrouvais nulle part l’équivalent de ce que j’avais connu au Texas. Il faut dire que mon expérience avait été vraiment unique et privilégiée. En effet, nous avions au centre de recherche des réunions scientifiques journalières au cours desquelles nous discutions des patientes et de leur traitement ; chaque problème médical était documenté, référencé, analysé. Un protocole de plusieurs pages était disponible pour la plupart des cas de cancer, des plus simples aux plus complexes. Un luxe comparé à ce que je découvrais au Québec où peu de gens s’intéressaient à la recherche sur le cancer du sein. L’attente aux urgences était déjà la priorité à l’époque. Cela n’a pas changé : nos centres universitaires hospitaliers sont encore évalués principalement sur les heures d’attente aux urgences et non sur leurs performances scientifiques.
Fort de mon expérience et de mon désir de fonder un centre de recherche clinique sur le cancer du sein, j’ai pris contact en 1980 avec les directeurs des hôpitaux Notre-Dame et Hôtel-Dieu à Montréal. L’hôpital Hôtel-D...
Table des matières
- Couverture
- Faux-titre
- Page de titre
- Crédits
- Préface
- Avant-propos
- Chapitre 1: Mon parcours de chirurgien oncologue
- Chapitre 2: Le choc du diagnostic
- Chapitre 3: Comprendre le cancer du sein
- Chapitre 4: La cure du cancer du sein à travers les siècles
- Chapitre 5: Les traitements actuels
- Chapitre 6: Les études prospectives randomisées
- Chapitre 7: La patiente au cœur de la recherche clinique
- Chapitre 8: La recherche clinique en question
- Chapitre 9: L’avenir des traitements et de la recherche
- Épilogue
- Glossaire
- Annexe - Liste de médicaments courants utilisés dans le traitement du cancer du sein
- Bibliographie
- Table des matières
- Quatrième de couverture