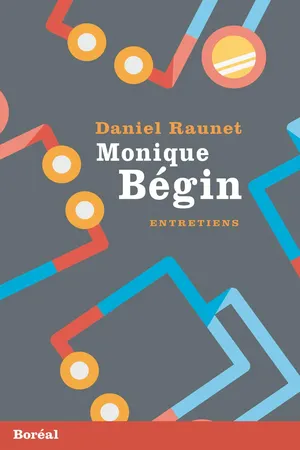Chapitre 1
La sociologie
Même si vous n’avez pas eu les moyens d’emprunter la voie royale des collèges classiques, vous êtes parvenue à entrer à l’université, où vous avez fait un choix déterminant pour la suite : la sociologie. J’ai toujours voulu étudier et aller à l’université ! Apprendre était un rêve depuis mon enfance. Étudier quoi ? Je ne le savais pas. Aller à l’université voulait d’abord dire obtenir un baccalauréat d’une façon ou d’une autre. Après avoir été enseignante puis secrétaire, et à nouveau enseignante de remplacement, de cours particuliers, et même préceptrice d’éléments latins, probablement la première laïque dans un collège classique de filles, j’ai fini par obtenir ce fameux baccalauréat ès arts.
Obligée de travailler à temps plein, je m’étais d’abord préparée par moi-même pour les examens de première française (l’équivalent de la rhétorique des collèges classiques du système québécois) au collège Marie-de-France, le collège français pour les filles à Montréal. Aucune inscription n’était requise pour passer les écrits et les oraux devant les professeurs de l’Université de Caen dépêchés au Canada pour ces examens. J’ai réussi très bien les écrits, assez bien les oraux, mais raté complètement la trigonométrie. J’ai été humiliée par ces oraux publics, alors inconnus au Québec, devant des jeunes qui s’en donnaient à cœur joie. Et les règlements ayant tout juste changé en France, je devais reprendre tous les examens une année plus tard !
Je n’allais certainement pas vivre ce cauchemar à nouveau. J’ai alors opté pour le « bac D », comme il s’appelait, ces cours du soir de l’Université de Montréal, de qualité inégale. C’était un bac pour adultes, pour enseignants voulant devenir directeurs d’école. Maurice Potvin, le directeur de ce programme, me reconnut 56 crédits sur les 100 exigés pour le baccalauréat et me permit de prendre les 44 crédits manquants en un an, avec cours tous les soirs, les samedis le jour et les étés 1957 et 1958 à plein temps. Je lui suis grandement redevable. À la fin d’août 1958, j’ai donc obtenu mon baccalauréat. Et en septembre, deux semaines après, j’étais inscrite en maîtrise de sociologie à l’Université de Montréal.
Il faut que je revienne à l’époque où j’étais secrétaire en service social, à la Faculté des sciences sociales. Même si nous relevions de services différents, nous, les secrétaires, travaillions toutes dans une même salle regroupant les départements d’alors : science politique, relations industrielles, service social, sociologie, économie, etc. J’avais appris ce que c’était que la sociologie en dactylographiant un ou deux textes du professeur Hubert Guindon. J’y découvrais un monde et une nouvelle façon d’en parler. J’aimais cette discipline parce que je voulais comprendre la société. Si l’anthropologie culturelle ou sociale avait existé comme département, j’aurais peut-être choisi l’anthropologie. La sociologie me permettait d’arriver à comprendre les classes sociales que j’avais si bien observées à Notre-Dame-de-Grâce. J’avais toujours été très sensible aux différences de statut social et à leur importance.
Dans les années qui avaient précédé, j’avais un peu songé à faire botanique ou médecine. La botanique parce que j’aime la nature et que j’avais monté des herbiers chez les guides, mais ce n’était pas une vraie vocation. La médecine m’est sortie de l’idée très vite ; le coût était prohibitif, ça réglait la question. Je n’ai jamais regretté. De son côté, le département de sociologie, en 1958, offrait une maîtrise de trois ans, avec thèse.
Vous venez de parler d’Hubert Guindon. D’après ce que j’ai lu de lui, c’est quelqu’un qui était très intéressé par les petites gens, par la réalité sociale, plutôt que par les grandes théories. Oui, il faisait de l’« observation participante » à sa manière, allant s’asseoir au Palais de justice et écoutant, observant, jasant avec ses voisins, ou dans un bar de l’est de la ville, et ainsi de suite : tous les théâtres sociaux l’intéressaient. Les grandes théories vides, quand elles n’étaient pas appuyées sur la vraie vie quotidienne, à quelque niveau que ce soit, du petit monde aux gens de pouvoir, l’exaspéraient.
Durant nos deux premières années de maîtrise en sociologie, nous avons eu une demi-douzaine d’excellents professeurs, dont Guindon, un Franco-Ontarien qui avait adopté Montréal et qui devint notre mentor. Il avait étudié aux États-Unis. Il était tout sauf un universitaire comme les autres : n’apportant aucun soin à son apparence, gouailleur, sarcastique, très humain et chaleureux avec nous, il était comme un courant d’air frais. Son autorité morale et intellectuelle naturelle masquait le fait qu’il était à peine plus âgé que nous. Il a beaucoup écrit, mais n’a guère publié ; ce sont ses anciens étudiants devenus universitaires qui l’ont fait. J’ai donc été son étudiante pendant les deux premières de mes trois années en socio. Nous sommes la classe qui aura vécu le passage de la Grande Noirceur à la Révolution tranquille. Il a beaucoup interprété pour nous l’actualité montréalaise et québécoise au quotidien.
Il nous enseignait aussi par l’analyse de la pensée de ses propres maîtres, à commencer par Everett Hughes, qui avait enseigné à l’Université McGill et connaissait le Québec, avait publié French Canada in Transition en 1943 et avait été le maître de C. Wright Mills à Chicago. Et de Léon Gérin, le premier sociologue québécois, ou encore d’Horace Miner. Nous baignions surtout dans la sociologie américaine, bien que Durkheim, père de la sociologie française, et Weber fussent discutés en profondeur dans nos classes. Nous avons aussi étudié Robert Merton avec intérêt. Côté grands théoriciens hermétiques pour le commun des mortels, tel Talcott Parsons, alors à la mode, Guindon s’en moquait sans se gêner. Notre manuel de sociologie était le classique américain très utilisé pendant plus de trente ans, celui de Leonard Bloom et Philip Selznick. Impossible pour moi de comparer notre formation à celle donnée ailleurs au Québec. Nous ne connaissions ni les professeurs ni les étudiants de sociologie de McGill ou de l’Université Laval, et encore moins leur curriculum. C’était l’époque.
Mais le sociologue dont l’influence marqua le plus profondément Hubert Guindon fut assurément C. Wright Mills, un public political intellectual. Voici ce qu’écrivait Guindon à son sujet : « C’est lui qui m’a insufflé la passion pour la sociologie. Il n’enseignait pas à Chicago [où étudiait Guindon], mais ses livres étaient beaucoup lus par les étudiants du département. Ce fut une influence intellectuelle marquante pour moi. Une formule résume bien la conception de Mills : “l’œil sociologique”. Si l’on considère ses études, on se rend compte qu’il s’agit d’une combinaison d’approches empiriques variées, parmi lesquelles l’entrevue occupe une place essentielle. Mills allait sur les lieux où vivaient les gens qu’il étudiait, prenait le temps de leur parler. » Faire de la sociologie, ce n’était pas faire des sondages ni des interviews par la poste. C’est le dépaysement qui nous force à ouvrir l’œil d’une manière différente. Cette école de pensée est devenue la mienne et celle de mes camarades de classe.
Dans nos cours, Guindon nous faisait nous pencher autant sur l’histoire du Québec que sur les changements sociaux déjà en marche, politiques bien sûr, mais aussi concernant le rôle, la place et les pouvoirs futurs de l’Église catholique au Québec, tels qu’il les sentait se forger. C’était un rebelle, contre toute autorité dogmatique. Il se méfiait comme de la peste des systèmes idéologiques fermés. Il avait du respect pour les sociologues qui vont sur le terrain. Il ne s’est jamais identifié aux élites, au contraire. Après qu’il eut racheté de l’ex-ministre péquiste Jacques Couture la petite maison de style traditionnel rue Sainte-Marguerite, en plein cœur de Saint-Henri, au début des années 1980, il s’est vraiment senti chez lui.
Quand vous êtes arrivée à l’Université de Montréal, c’étaient encore les ecclésiastiques qui étaient aux commandes. Oui, vous avez raison de rappeler l’atmosphère de l’époque. J’ai été en sociologie de septembre 1958 à juin 1961. Dans ma classe, nous n’étions que neuf ou dix étudiants, mais juste après, les effectifs sont montés à des centaines d’étudiants. Il y avait là la génération qui a produit les chefs de cabinet et les adjoints des ministres de la Révolution tranquille. C’est ma classe qui, de façon unique, a vécu le passage de ce qui s’est appelé la Grande Noirceur, que Gérard Pelletier a plutôt appelée « les années d’impatience », de 1950 à 1960, à la Révolution tranquille, de 1960 à 1966.
Est-ce que vous étiez consciente d’appartenir à cette génération charnière ? Très consciente. Nous vivions une période de changement social et de transformation de la démocratie. J’avais treize ans, en 1949, quand Mgr Charbonneau a demandé aux troupes guides de Montréal de quêter aux portes des églises les dimanches matin pour les grévistes de l’amiante d’Asbestos. C’est mon premier souvenir d’engagement social. J’ai fait la quête pendant des semaines à toutes les messes, tous les dimanches matin.
L’autre étape dans ma prise de conscience, c’est quand je suis arrivée à l’université, comme secrétaire du père Guillemette. Quand j’allais manger avec mes amis étudiants, je suivais toujours les débats du midi au Centre social, où défilaient les têtes d’affiche du moment, le maire Drapeau, Michel Chartrand, ce syndicaliste original, drôle et important, Thérèse Casgrain, la présidente de la Cooperative Commonwealth Federation (CCF) québécoise, ancêtre du NPD, Jean Marchand, le grand chef syndical, et bien d’autres. C’est aussi l’époque de l’épisode des « trois à Québec ». Trois étudiants, Jean-Pierre Goyer, Francine Laurendeau et Bruno Meloche, se sont rendus à Québec en mars 1958...