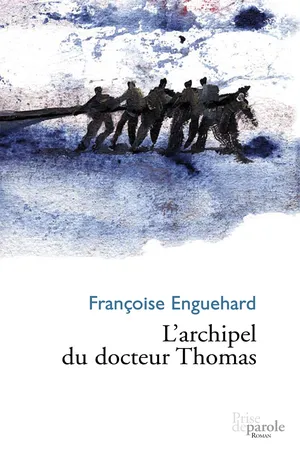Chapitre 1
Bien calé dans le fauteuil, dans l’accueillante maison de ses meilleurs amis d’enfance, un verre de scotch posé sur la table à côté de l’accoudoir, François soupira d’aise. Le radiateur du salon ronronnait, distribuant généreusement sa chaleur dans la pièce. On avait ouvert grand les portes pour accueillir la visite. Son manteau de drap trempé par le poudrin pendait au-dessus du radiateur de l’entrée et, à même la fonte brûlante, la maîtresse de maison avait étalé ses gants et son foulard. Ses bottes, qu’on avait posées sur le paillasson juste à côté, dégageraient une délicieuse chaleur au moment où il les enfileraient pour faire de nouveau face à la tempête.
Déchargé de ce pesant accoutrement, un bien-être profond s’installait progressivement en lui, qui devait tout autant à la proximité de ses amis qu’au confort de la maison.
— Six mois, cette fois-ci.
— Oui, c’est bien trop long, répondit-il en prenant une gorgée de scotch.
Voilà six mois que François n’était pas revenu dans ses îles, un record peu honorable à ses yeux. Force lui était d’admettre que, depuis quelques années, il trouvait de plus en plus difficile de «s’échapper» — c’était, selon lui, le mot qui convenait — pour revenir ici, à Saint-Pierre et Miquelon, archipel de son enfance.
Une carrière, qu’il avait réussie au-delà de ses espoirs de jeunesse, occupait toute sa vie. Loisirs, moments de repos, pensées même, avaient rendu les armes depuis qu’il s’était tout entier soumis à l’impérieuse nécessité de produire toujours plus, d’entreprendre sans cesse. Il tirait certes de son succès une fierté sans bornes. Pourtant, il suffisait que son esprit se porte un instant vers ses îles, qu’il consulte brièvement sa montre, calcule l’heure à Saint-Pierre, imagine sa mère sur le chemin de la poste — il est onze heures du matin, elle s’est arrêtée au coin d’une rue pour une partie de blague avec une amie —, pour qu’il sente l’odeur de marée, de varech et de vase qui monte du barachois. Il était alors foudroyé de l’envie de se transporter dans l’archipel, là où tout semblait si simple, si paisible, si facile.
Ainsi touchait-il régulièrement du doigt l’absence. François n’avait jamais pu s’habituer aux milliers de kilomètres qui le séparaient des siens, jamais accepté qu’il ne puisse, sur un coup de tête, se retrouver parmi eux. Il n’y avait pour lui qu’une seule manière de remédier à cette situation, traverser l’Atlantique le plus souvent possible; malheureusement, par une de ces ironies de la vie, au moment même où le succès lui offrait les moyens de voyager à sa guise, le temps lui faisait défaut.
Il sentait pourtant que, plus ses traversées de l’Atlantique s’espaçaient, plus elles devenaient vitales à ce qu’il y avait d’authentique en lui. Quelque part dans cet archipel de brumes résidait une parcelle de sa personnalité qu’il devait protéger à tout prix. Il n’était pas fervent d’introspection, mais, sans l’avoir vraiment formulé, il devinait que, sans le soin jaloux qu’il portait à sa provenance, il perdrait la profondeur et la fraîcheur de ce regard qui lui assurait réussite et fortune et sombrerait dans la médiocrité.
À Paris, dans son cabinet d’architecte, on ne disait mot — personne n’aurait osé — au sujet de ses voyages, toujours arrêtés de manière spontanée et qui contrariaient bien des plans. Ses collègues voyaient là des déplacements futiles, fruits de sautes d’humeur auxquelles ils se sentaient étrangers. Après tout, que pouvait-on demander de plus quand on avait atteint le sommet de la gloire à Paris? Et, surtout, que pouvait-on aller chercher à l’autre bout du monde, dans cet endroit perdu où quelques pauvres maisons de pêcheurs en bois s’agglutinaient autour d’affreux bâtiments gouvernementaux?
Si ses collègues avaient regardé de plus près, ils auraient constaté que «ce trou» — comme l’avait une fois baptisé un associé qui le croyait trop loin pour entendre — était la source même de son inspiration et de sa créativité.
François arrêta le cours de ses pensées et jeta un regard plein d’affection sur le couple assis en face de lui. L’amitié qui les unissait tous les trois était un superbe exemple des précieuses ressources de l’archipel auxquelles il venait régulièrement puiser. Ce lien, d’une force peu commune, avait survécu à des dizaines d’années de séparation et de changements. Peu importait la durée de l’absence, les trois se retrouvaient chaque fois comme s’ils s’étaient quittés la veille et reprenaient leur conversation comme s’ils l’avaient interrompue quelques minutes seulement.
Signe d’une amitié sereine, ses amis ne lui enviaient ni sa notoriété ni ses relations de la haute société française, dont les noms apparaissaient parfois, associés au sien, dans les magazines qui arrivaient — avec plusieurs semaines de retard — jusque dans l’archipel. Comme tout le monde, ses amis étaient fiers de le voir sur les pages glacées de Paris-Match, mais ils s’inquiétaient très vite s’il avait «mauvaise mine», ou «l’air fatigué». «Tiens, il me semble qu’il a encore maigri», commentaient-ils parfois, et ce bulletin de santé pesait plus lourd à leurs yeux que la poignée de main de untel ou l’accolade du sénateur.
En retour, François s’intéressait à leur vie, à leur métier, aux événements qui marquaient l’île; il suivait la politique locale, prenait part quand il le pouvait à l’ouverture de la chasse au chevreuil ou au lapin, préservant ainsi un lien ténu, mais essentiel, entre ses racines et une vie qu’il continuait à qualifier de «nouvelle», même après vingt ans. Ces retours étaient l’ancrage d’une existence réussie dans la capitale qu’il refusait encore de considérer chez lui.
Les trois amis se connaissaient depuis l’enfance. Ils avaient fréquenté la même école, eu les mêmes instituteurs et passé leur brevet la même année. À ce moment-là, ils avaient pris des chemins bien différents: ses amis avaient choisi de vivre ici, dans l’archipel et lui, en France. Son ambition dévorante ne lui avait pas laissé d’autre option.
À Saint-Pierre et Miquelon, les jeunes ont, très tôt, à prendre une décision qui les engage pour le reste de leur vie: rester ou partir. Pour sa génération, après le brevet, il fallait décider soit d’arrêter ses études et de rester à Saint-Pierre, ou de les continuer en France — en Métropole disait-on — là où les espoirs d’un adolescent pouvaient trouver à se réaliser.
Il était, curieusement, plus facile de quitter Saint-Pierre et Miquelon pour le Canada ou même les États-Unis. Malgré l’obstacle de la langue, on ne s’y sentait pas trop dépaysé. Parce que c’était plus proche, souvent on connaissait du monde. Et on avait plusieurs choses en commun avec nos voisins: les mêmes rigueurs de l’hiver qui obligeaient à construire de la même manière et à s’acheter des chasse-neige, le hockey, les grosses voitures, les catalogues des grands magasins — Sears, Eaton’s, Montgomery Ward — dans lesquels on commandait tout, des débarbouillettes aux draps Permapress, en passant par les meubles et les chaussures. Bref, les Saint-Pierrais partageaient le quotidien et la météo avec cet énorme continent. À Saint-Pierre et Miquelon, l’air sentait l’iode et le vent était tout aussi sauvage qu’à Terre-Neuve ou en Nouvelle-Écosse et les nuages d’hiver annonçaient le même poudrin que celui qui s’était abattu sur Montréal ou Québec.
S’en aller où que ce soit en Amérique du Nord, c’était en quelque sorte naviguer au petit cabotage. Beaucoup de jeunes de l’archipel avaient déjà eu l’occasion de se rendre au Canada: à Sydney pour voir le médecin ou à Terre-Neuve pour la pêche aux truites ou la chasse. Par contre, ceux qui avaient mis le pied en France pouvaient se compter sur les doigts de la main. Partir pour la France, c’était du long cours.
François avait pris sa décision très longtemps avant son brevet, et elle était sans appel. Tout petit, il avait su ce qu’il allait faire: construire. Il se souvenait, avec exactitude, du jour où il avait arrêté son choix. Il devait avoir six ans. En face de chez lui, on venait d’abattre une vieille maison et on entamait, en ce printemps précoce, une nouvelle construction. Il en avait vécu toutes les étapes comme une prodigieuse aventure. L’enfant curieux avait épié les magiciens qui avaient fait apparaître les fondations d’abord, puis toute la maison, là où, quelques mois plus tôt, il n’y avait qu’un petit lopin de terre et de cailloux.
Chaque matin, au premier coup de marteau des ouvriers, il s’était levé et avait couru s’installer à la fenêtre du salon, d’où on avait de la peine à l’arracher pour le faire déjeuner et le forcer à prendre le chemin de l’école. À l’arrivée des grandes vacances, cette année-là, il s’était consacré tout entier à cette passion dévorante. Sa mère en avait été bien soulagée, la fascination peu commune de son petit dernier lui laissant les coudées franches pour les multiples travaux qui occupaient sa journée de mère veuve, seule au foyer.
François vécut donc, à la fenêtre, la préparation du coffrage, la réalisation de la dalle et des fondations de béton, prétexte à un grand événement communautaire au cours duquel tous les forts-à-bras des environs venaient donner un coup de main pour couler. Ses oreilles résonnaient encore du bruit grinçant des pelles tournant et retournant le ciment avec le sable sur un carré de bois construit à cet effet, du bruit de l’eau qui y était ajoutée en un savant dosage, puis du ciment gris tombant, pelletée par pelletée, dans les coffrages. Il se souvenait du rythme envoûtant, lent et énergique à la fois, de cette symphonie dans laquelle chaque travailleur semblait avoir sa propre partition.
Petit à petit, il assista à la lente émergence de la charpente, observa la pose des montants qui laissaient deviner, il le comprit intuitivement, l’emplacement des murs intérieurs «comme ici», pensa-t-il, en comparant les murs du salon chez lui avec la charpente d’en face. Qu’il était amusant de deviner la disposition des différentes pièces, de les imaginer meublées, habitées, la place où s’élèverait l’escalier, de voir monter la cheminée de briques depuis la cave jusqu’au grenier et enfin d’assister, émerveillé, à la pose des murs extérieurs et du toit.
Un jour, il vit un des hommes clouer un petit sapin sur le faîte du toit.
— Qu’est-ce qu’il fait, le monsieur? demanda-t-il à sa mère.
— Quand une nouvelle maison est recouverte et à l’abri du mauvais temps, on cloue un petit arbre au-dessus de la porte. Comme ça, tous ceux qui ont donné un coup de main savent qu’ils sont invités à prendre un coup, répondit sa mère.
En effet, peu de temps après, un vendredi soir, il vit arriver les grands quinze-côtes qui avaient aidé à couler et à monter la charpente. Ils grimpèrent tant bien que mal à l’échelle de fortune collée le long du mur extérieur, afin d’atteindre le cadre de la porte d’entrée. Pendant quelques heures, il entendit leurs rires résonner dans la maison encore vide. Bientôt, se dit-il, il y aura les fêtes, les baptêmes, les communions et la maison vivra. Quelle magie.
Une fois l’extérieur terminé — on approchait de l’automne —, il ne restait plus grand-chose à voir, si ce n’est la pose du bardeau sur les murs extérieurs et du feutre sur le toit, deux tâches laborieuses exigeant une grande précision et qui le fascinèrent à un point tel que, un soir, alors que sa mère, pour faire son feu, l’avait envoyé chercher quelques morceaux de bardeau jetés à terre, il était resté piqué debout devant un mur partiellement fini, observant de près comment les plaques de bois étaient juxtaposées puis clouées à l’endroit le plus mince, de façon à produire une surface uniforme. Il avait observé longuement la dernière rangée de bardeaux, puis il s’était enhardi, avait caressé le bois, s’était penché pour observer leur alignement. Il reconnut tout de suite le principe qui permettait à des maisons comme la sienne d’être à l’abri de l’eau, du vent, de la neige. En fait, ce jour-là, il eut le sentiment de repasser tout simplement des leçons depuis longtemps apprises — sensation qui reviendrait souvent durant ses longues années d’études —, confirmation, s’il en fallait, que ce métier l’avait choisi et non l’inverse.
Une fois la construction terminée, il annonça que, lui aussi, quand il serait grand, il construirait des maisons. Personne n’y trouva à redire: le métier de charpentier était honorable et payait bien. On lui fournit alors des morceaux de bois et, cette année-là, à Noël, ses frères lui offrirent des outils à sa taille. On s’habitua à le voir, dans la cave, en train de scier et de clouer.
À l’école, quelques années plus tard, il découvrit dans les livres que, si à Saint-Pierre et à Miquelon on bâtissait à la manière traditionnelle — sans plans et selon des coutumes transmises de père en fils —, ailleurs des gens se chargeaient d’imaginer les bâtiments, les dessinaient, produisaient des instructions détaillées de toute la construction et laissaient le travail proprement dit à divers corps de métier.
Ce jour-là, presque dix ans après avoir annoncé qu’il construirait des maisons, il précisa sa pensée: il serait architecte. Sa famille resta médusée. Architecte? On n’avait jamais vu ça à Saint-Pierre. Les sourcils de sa mère se froncèrent d’inquiétude:
— Architecte? Ça doit coûter cher, comme études? Où est-ce qu’on va trouver les sous?
Excellent élève, premier de classe — il n’y avait guère que l’orthographe et la dictée pour lui poser problème —, «il avait tout pour réussir », selon l’expression consacrée. C’est donc tout naturellement que le directeur d’école, en lui remettant le prix du Gouverneur et celui du Conseil général, lui suggéra de demander une bourse pour faire des études en France.
Trois ans plus tard, boursier de la colonie, il quittait ses îles à la poursuite de son rêve. Ils étaient nombreux ce jour d’automne à s’exiler: médecin, banquier, avocat ou chercheur en devenir.
D’autres — comme ses amis en face de lui dans le salon — étaient restés dans l’archipel. Certains convoitaient «une place dans l’administration » ou dans l’enseignement, ou choisissaient la pêche ou la direction d’une entreprise familiale. Certains partiraient bientôt pour Saint-Mary’s, Halifax, St-Bond’s, ou Saint-Jean de Terre-Neuve, afin d’apprendre l’anglais avant de revenir brasser des affaires à Saint-Pierre.
À l’époque, François avait amèrement regretté que ses amis ne s’embarquent pas avec lui dans l’aventure métropolitaine. Sur le quai ce matin-là, juste à côté d’eux, il s’était senti très loin, déjà. Il aurait voulu leur crier qu’ils se trompaient, que l’ambition leur manquait et que l’avenir les attendait tous les trois en France. Il avait pourtant compris que ses amis étaient heureux de leur décision, ce qui l’avait blessé sur le coup. Au fil des jours, puis des mois, ces sentiments égoïstes l’avaient laissé, au point que, depuis quelque temps, il se demandait même si ses amis n’avaient pas choisi la meilleure part.
L’amitié, quant à elle, était demeurée au rendez-vous. À chaque retour, après avoir déposé ses bagages chez sa mère — elle vivait seule depuis que ses frères s’étaient mis en ménage —, pris une tasse de thé avec elle et écouté les derniers potins de Saint-Pierre, il filait chez ses amis. Il retrouvait sa place au salon, toujours la même, et c’était comme si le temps s’était arrêté.
— C’est du bien mauvais temps, commenta son amie en fermant les tentures du salon.
Il aurait voulu lui dire de ne pas tirer les rideaux, lui expliquer qu’il aimait être au chaud alors que dehors les éléments se déchaînaient, admirer, à travers le fin voilage des fenêtres, l’incomparable spectacle de la tempête, les volutes de poudrin s’élançant dans la lueur jaunâtre des lampadaires, entendre le crissement de la neige sous les pas de rares passants attardés, sentir la vibration des carreaux secoués par une bourrasque plus forte que les autres, mais il n’osa rien dire.
Il comprenait que ses amis veuillent s’isoler des éléments, se détacher d’un hiver interminable. «Facile pour moi d’aimer la tempête, pensa-t-il, dans quelques semaines le soleil sera de retour à Paris.» Ici, c’était autre chose: les mois de froid, de vent, et les coups de tabac qui lui plaisaient tant n’étaient, pour les habitants, que corvées de déblayage de la neige — une neige si abondante qu’il fallait parfois creuser des tunnels pour dégager les portes —, factures de mazout et d’électricité à défier l’entendement, et manque de soleil tel qu’il n’était pas rare de voir quelques personnes sombrer dans la déprime la plus totale. «Envisagée sous cet angle», selon l’expression favorite d’un de ses vieux oncles, sa demande aurait paru incongrue et peut-être même insultante.
Ces doubles rideaux tirés par-dessus le voilage et qui empêchaient de voir la pièce du dehors lui déplaisaient pourtant. Ils lui rappelaient les rideaux de fer des appartements parisiens et les volets de bois de la campagne française, qui transformaient quartier ou village en zone désertique et hantée. Ce soir, ils le privaient du spectaculaire contraste entre la tempête extérieure et la chaleur de la maison, de la jubilation de l’observateur, confortablement installé dans son fauteuil, qui sait qu’un simple châssis le sépare de la morsure du froid et du souffle mortel du poudrin.
Il se souvenait, il y avait des années de cela — à l’époque où il se ménageait encore des moments d’insouciance —, avoir passé quelques jours dans ce que sa tante appelait «la France profonde». Il avait dû acheter une pile électrique pour se diriger la nuit dans le petit village sans lumières, alors que tous les foyers avaient disparu derrière leurs volets, tels des repaires de termites. Il en avait ressenti un profond malaise, comme si horreurs intimes et drames familiaux se cachaient derrière ces remparts de bois et de ferraille, dans cette noirceur créée par l’homme. Ses édifices à lui ne comportaient ni volets ni rideaux de fer, ce qu’on lui reprochait souvent. Il se doutait bien, et feignait de l’ignorer, que de nombreux clients en rajoutaient une fois la construction terminée....