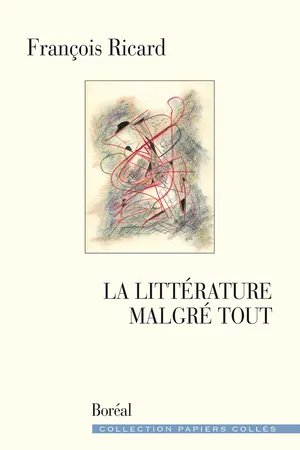![]()
LECTURES AU GRAND AIR
où l’auteur, errant de la Grèce à l’Amérique,
de la Pologne à l’Italie, de la France au Québec,
se trouve partout dans sa patrie
De quoi t’ennuies-tu, lecteur ?
(Georges Séféris)
L’été dernier, au cours de longues après-midi dans un jardin public de mon quartier, j’ai vécu dans l’œuvre du grand poète grec Georges Séféris (1900-1971). J’ai lu, en traduction française bien sûr, ses Poèmes, ses Pages de journal et ses Essais. Lecture que je devrai laisser décanter, cela va sans dire, mais dont je retiens déjà une sorte de nostalgie, le sentiment d’un manque ou d’une perte irréparable, mais de quoi au juste, je ne saurais encore le dire avec précision.
Il m’arrive de plus en plus souvent d’éprouver un sentiment de ce genre en présence de certaines œuvres dont la beauté et la force me saisissent d’admiration mais qui, en même temps, par le contraste cruel qu’elles font avec le monde où je vis, me plongent dans une humeur morose que j’ai parfois du mal à surmonter. Cette expérience ressemble un peu à celle que raconte Séféris lui-même dans son journal, après l’audition des Préludes de Debussy :
À quoi bon nos petites tentatives quand on sait qu’il y a eu de tels hommes ?… Ce que nous aimons se venge de nous, ce que nous admirons nous anéantit. Dès mes dix-huit ans, chaque fois que je me trouvais devant quelque chose qui me touchait très profondément et que je jugeais grand, j’éprouvais ensuite une irrépressible envie de me noyer.
Quelque temps plus tard, même impression au retour d’un concert Stravinski : « Comme chaque fois que je me trouve devant ce que j’accepte sans réserve, je me suis finalement senti brisé, plein de rancœur et de tristesse, petit comme un jouet cassé. »
Mais il y a une différence, je crois, entre ce sentiment et le mien. Ce qui « anéantit » Séféris au contact de ces grandes œuvres, c’est surtout l’image qu’elles lui renvoient de sa propre indignité d’artiste, de son imperfection, tandis que « la rancœur et la tristesse » dans lesquelles me laisse une œuvre telle que la sienne n’ont guère à voir avec quelque ambition artistique qui m’habiterait (après tout, j’ai le double de l’âge qu’avait Séféris quand il a noté ces impressions). Elles sont d’un ordre plus général, plus historique, disons. Lisant Séféris, c’est comme si je me trouvais transporté dans un monde tout autre que le mien, un monde étranger, lointain, mais qui serait en même temps plus profondément mien, plus réellement ma patrie que celui qui m’entoure et dont je fais partie, ici et maintenant. Si bien que, ayant posé le livre et le messager s’étant tu, je me sens envahi d’un immense ennui, au double sens de ce mot : lassitude devant ce qui est, regret ou désir de ce qui a été ou de ce qui n’est pas encore. Peut-être l’ennui ainsi entendu est-il, aujourd’hui, la seule forme encore possible du ravissement esthétique ou de ce qui s’appelait autrefois le sublime. « Ce que nous admirons nous anéantit », dit Séféris ; mais je dirais plutôt : ce que nous admirons nous expatrie de nous-mêmes et nous condamne à la mélancolie.
Ce serait mal comprendre l’effet intérieur que j’essaie de décrire que de l’attribuer au simple fait que Séféris est grec. Ce n’est pas sa « grécité », pas même son « hellénicité » (pour être plus fidèle à son langage), qui confère à cette œuvre son pouvoir distinctif. D’ailleurs, et bien que la culture populaire en soit l’une des sources les plus vives, presque à l’égal de la grande tradition antique, rien n’est plus éloigné de l’univers séférien que l’intention régionaliste ou nationale. Au contraire, l’une des forces qui l’animent est le rejet de toute forme de repli sur le local, de toute fixation provincialiste, tentation de la plupart des littératures nées, comme la grecque moderne (ou comme la québécoise), dans le contexte du xixe siècle romantique. Qui lirait les poèmes ou les proses de Séféris pour connaître (ou reconnaître) l’histoire, les paysages, la vie de la Grèce actuelle ou récente ne serait pas complètement déçu, sans doute, mais il raterait l’essentiel de ce que cette œuvre peut représenter pour nous aujourd’hui, et qui est son appartenance, par toutes les fibres qui la constituent, par la visée qui l’inspire de part en part, à un territoire ou à un âge de l’esprit et de la sensibilité dont nous n’avons plus guère l’idée aujourd’hui, sinon à travers un souvenir de plus en plus vague et que tout s’acharne à effacer définitivement de nos mémoires.
Ce territoire abandonné, cet âge révolu, plus personne parmi nous ne saurait le décrire, car nous en avons perdu la carte, désappris le langage. Il nous est devenu irrémédiablement étranger, et nous ne pouvons plus qu’en deviner confusément la grandeur à travers les échos que nous en renvoient quelques œuvres d’avant sa disparition, des œuvres qui, d’ailleurs, pressentaient cette disparition, c’est-à-dire le destin qui est à présent le nôtre. Parmi ces œuvres à la fois éclatantes et crépusculaires, celle de Séféris est certainement l’une des plus hautes et des plus graves, hantée qu’elle est, d’un côté, par le besoin de préserver l’héritage en se haussant jusqu’à lui à travers la création et la pensée la plus exigeante et la plus universelle qui soit, mais, d’un autre côté et du même souffle, par la vision de plus en plus nette de la fin, particulièrement dans les poèmes de Mythologie et dans le journal, où l’on peut lire par exemple ceci, en septembre 1938 :
Pour la première fois de ma vie, j’ai eu le sentiment d’avoir vieilli. J’ai compris qu’il était possible que je puisse ne pas comprendre de plus jeunes que moi et qu’ils pouvaient, eux, juger comme dépassées et sans valeur des choses auxquelles je crois. La solitude, je l’ai souvent vécue au présent, mais cette fois j’ai senti qu’elle touchait l’avenir, jusqu’à la consommation des siècles. Choc étrange que de comprendre que jamais plus je n’aurai de compagnons, [que] d’avoir été une vie entière au service d’un dieu et de s’apercevoir tout à coup que personne ne croit plus en ce dieu.
Idée qui revient moins d’un an plus tard, le 3 août 1939 : « Quand tu disais naguère que tu étais seul – et tu l’éprouvais sincèrement – tu l’étais beaucoup moins que tu ne l’es aujourd’hui. Que cela te préserve d’être surpris à l’avenir. Il y a toujours quelque chose de plus, jusqu’à ce que l’homme se brise. »
Lire Séféris, c’est assumer ce vieillissement, et c’est comprendre à quel point cette solitude, ou le souvenir de cette solitude, est tout ce qui nous reste de l’humanité ancienne, le dernier refuge, en nous, où celle-ci se terre avant d’être emportée à jamais. Bientôt, écrit Séféris en juillet 1940 (et il ne pense pas seulement au contexte de la guerre), « nous n’aurons plus rien d’autre à faire qu’à chercher notre pitance comme les chiens et les chats, avec cette seule différence que ce sera pire pour nous parce que nous charrierons avec nous les débris des hommes que nous aurons été ».
« Les hommes que nous aurons été. » Voilà qui résume parfaitement, à mes yeux, ce curieux « ennui » qu’une œuvre comme celle de Séféris dépose en nous tel un limon de lumière et de larmes.
L’épée de la liberté
(Franz Kafka)
Quoique le premier roman de Kafka se déroule tout entier en Amérique, il serait oiseux, selon la critique patentée, d’y chercher une évocation fidèle de la réalité américaine. L’auteur, en effet, n’est jamais allé aux États-Unis, et les commentateurs ont montré que la connaissance – toute livresque – qu’il avait de ce pays était très approximative, comme en témoignent les erreurs, omissions et déformations de toutes sortes qui abondent dans son roman. Ce titre même, Amerika, est posthume et n’a pas été choisi par Kafka. Il vaudrait donc mieux, dès le départ, renoncer à lire L’Amérique pour y découvrir quoi que ce soit de l’Amérique.
Toujours d’après la critique, cependant, l’ignorance de l’auteur n’est pas la seule raison qui empêche son discours d’avoir quelque rapport avec l’Amérique réelle. De façon plus décisive encore, ce qui disqualifie objectivement son propos, c’est qu’il appartient à la littérature. Kafka aurait eu beau séjourner longtemps aux États-Unis, visiter le pays de long en large, se documenter aux meilleures sources, la « fiabilité » de son Amérique fictive n’en aurait été nullement augmentée, puisque la connaissance ainsi accumulée, en passant par le roman, se serait par le fait même annulée, transformée en son contraire, c’est-à-dire en littérature. Pour cette critique, en effet, la littérature, le roman, ne peut pas tenir de propos valide sur le monde. Son discours est clos sur lui-même et, par rapport à quelque objet que ce soit, toujours oblique et arbitraire. Produit de déterminations extérieures (sociohistoriques, psychologiques ou idéologiques) qui parlent à travers elle, la littérature, elle, ne parle pas. Elle est « autonome », c’est-à-dire coupée de tout comme dans une prison…
Or, à ce postulat tacite de l’inanité de la littérature sur lequel, quoi qu’on en dise, repose la majeure partie de la critique officielle d’aujourd’hui, il est possible, sans revenir au simplisme de certaines conceptions anciennes ni gommer en rien la spécificité de la littérature, d’opposer un type de lecture moins tranquille, qui, au lieu d’esquiver le propos explicite de l’œuvre, se laisse ébranler, voire instruire par lui, et donc le considère comme un discours légitime sur le monde, capable de vraies découvertes auxquelles on ne pourrait pas parvenir autrement.
***
Un roman connaît son objet par et dans l’imagination, en l’y laissant jouer librement, de manière à saisir non tant sa réalité observable par n’importe qui que la fascination qu’il exerce dans une pensée singulière, où se répercutent les figures, les mythes et les valeurs dont il est chargé. Ce serait ignorer la richesse de cette relation que de la définir par le seul exercice de la subjectivité. Il s’agit plutôt d’une rencontre entre un objet et un sujet, permettant à celui-ci de s’exprimer, certes, mais à celui-là, en même temps, de révéler une dimension fondamentale de lui-même, son épaisseur humaine, partie intégrante de sa réalité.
Ainsi, il est certain que L’Amérique n’offre pas de l’Amérique un tableau « représentatif », et que sa valeur documentaire est à peu près nulle. Le roman de Kafka, d’ailleurs, n’a pas d’ambition de cet ordre ; il ne se présente d’aucune façon comme une œuvre réaliste, ni ne repose sur aucune enquête ou recherche quelconque. L’Amérique y est une Amérique purement rêvée, de loin, à partir de quelques bribes d’information plus ou moins insignifiantes. De là, pourtant, et surtout de son imagination, Kafka tire tout un pays et toute une histoire. Or, en l’occurrence, ce mode d’appréhension, cette approche distante, pourrait-on dire, est peut-être le mode le plus approprié qui soit, le plus conforme à ce que demande l’objet Amérique. En d’autres mots, la distance et même l’« ignorance » d’où écrit le romancier représenteraient ici une position privilégiée, car l’expérience la plus authentiquement américaine n’est-elle pas, d’abord et avant tout, de ne pas (encore) être allé en Amérique ?
Pour cette dernière, en effet, le statut d’objet rêvé n’est pas un attribut secondaire ou accidentel. Au contraire, c’est un trait primordial de sa définition que de ne pas appartenir vraiment à la réalité, de se présenter toujours et d’être vécue comme pure potentialité, pur projet, ouverture indéfinie, et d’être réfractaire par conséquent à toute forme de réalisation qui la fixerait et la limiterait fatalement. L’Amérique, comme objet de pensée, est toujours ailleurs, toujours plus loin dans le temps, dans l’espace, dans l’être même. Elle n’advient jamais, mais n’existe que rêvée, espérée, appelée par l’imagination et le désir.
Dire que l’Amérique de Kafka est une Amérique fictive, c’est donc, en ce sens, reconnaître son extrême pertinence. Et dire qu’il s’agit d’une Amérique d’Européen, c’est apprécier encore mieux la justesse de la vision de Kafka, dans la mesure où, effectivement, l’Amérique moderne est une idée nourrie avant tout par l’imaginaire européen et qui trouve dans son rapport dialectique avec l’Europe un autre de ses traits essentiels. « Toutes les fois que ma pensée se fait trop noire, et que je désespère de l’Europe, écrivait Valéry, je ne retrouve quelque espoir q...