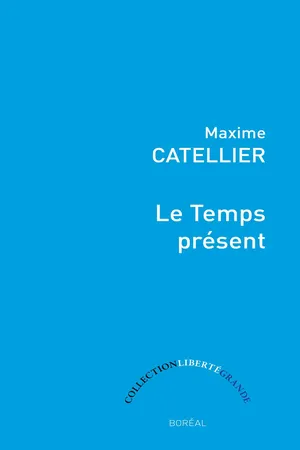
- 146 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Le Temps présent
À propos de ce livre
Se promenant dans les idées comme l'ont fait jadis tantôt un Fargue, tantôt un Straram, Maxime Catellier déambule en solitaire qui a des amis qui vieillissent, tout comme lui. Dans son présent fait de passé survécu, de futur appréhendé, de mille et une pensées sans âge, il arpente les quartiers qu'on n'a pas encore démolis, parcourt ses campagnes, les rurales et les pugnaces, avec pour compagnons Buies, Nelligan, Issenhuth, Rimbaud, Mallarmé et Dylan. Au menu des jours, espérance, destruction, dépaysement, disparition, critique, action et rêve, fiction et réel, terrorisme et pauvreté, liberté, désespérance.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informations
Sujet
LittératureLes mains libres
Je me suis souvent demandé pourquoi les trois quarts des journalistes canadiens ne renchaussaient pas des patates au lieu de tenir une plume. À force de les lire je suis arrivé à en découvrir la raison ; c’est que ces écrivains ne font pas la moindre différence entre une plume et une pioche.
Arthur Buies, 20 septembre 1872
Le boulevard Arthur-Buies, à Rimouski, a longtemps représenté pour moi une plaie urbaine où je détestais marcher et à laquelle j’ai toujours préféré, pour me rendre où que ce soit, les chemins qui n’y passaient pas. À cette hauteur, pour un enfant de mon âge, ce n’était même plus la ville. De mon âge, je ne dirai rien, tant le même sentiment m’anima encore à de nombreuses reprises, dont une longue marche hivernale qui me le fit traverser à partir du nouveau tronçon qui passe au beau milieu de ce que furent autrefois les champs des Sœurs du Saint-Rosaire, maintenant habités par des maisons identiquement laides et communes, à partir de la cité des achats où l’urbanisme a été mis à mort, comme souvent dans la triste histoire de cette ville, jusqu’à la montée Sainte-Odile dans les parages de laquelle ma mère habite aujourd’hui. Si Rimouski se résuma pendant longtemps à la paroisse Saint-Germain, dont le feu du 6 mai 1950 ravagea la majeure partie, ses ruines étincelantes et neuves font maintenant dos au fleuve pour se protéger du vent de la mer. Car nous appelons la mer ce que les étrangers prennent pour le fleuve. C’est devant elle que j’ai appris à oublier ce qu’on m’apprenait, que j’ai retenu ce qu’on ne voulait pas que je remarque. La contemplation de la mer doit nécessairement avoir fait naître en moi un désir d’absolu. Je ne connais pas de forteresse plus terrassante que la mer, telle qu’elle se présente dans le Bas-du-Fleuve à partir de La Pocatière, mais plus précisément devant l’île Verte, où la vieille route reprend ses droits.
Mon sentiment d’appartenance à ce coin de pays où je suis né est un réseau fragile de sensations très éloignées les unes des autres, comme si les souvenirs n’avaient pas la même charge quand ils tirent leur origine des battures de L’Isle-Verte ou des îles du Bic : chaque morceau dispersé aux quatre vents s’est retrouvé pris dans la toile d’une araignée qui dort, et j’observe de ma hune les couchers de soleil se défaire couleur après couleur dans la marée haute de mai, plus distante, quand la mer se retire pour laisser la grève se découdre dans le sel de la veille. Il arrivera que beaucoup plus vieux je pleurerai sans peine cette distance qui m’accable, la faillite que l’appartenance a découverte en mon âme ingrate, elle, fille du pays, elle à qui on a enseigné depuis l’aube des paroisses à aimer son église même vide, elle qui n’a toujours pas appris à revenir faire son lit dans la rivière qui la borde sous le pont qui vibre au-dessus de la chanson du dynamo. Je marche le long du boulevard Arthur-Buies jusqu’à la plaza du même nom, là où j’ai appris à voler, à plonger dans les ordures neuves des magasins à une piastre, à me cacher des gardiens et à fumer dans les toilettes les restants luisants de rouge à lèvres des cigarettes longues et dorées que les magasineuses laissaient dans le cendrier avant d’entrer dans les rayons de cochonneries véritables. J’ai grandi dans cet ennui plus réel que les beautés du paysage qui s’offraient alors à nous sans réussir à nous éblouir plus durablement qu’une bière volée au dépanneur.
Je dois à l’indigence de notre instruction publique le privilège d’avoir affiné mon ennui dans les livres que je déterrais des bibliothèques scolaires étrangement muettes sur le sort qui leur était fait, prenant la poussière de l’ignorance dans un racoin discret de l’immeuble. Je tenais les bibliothécaires pour mes plus fidèles alliées, toujours promptes à justifier mes absences et mes retards par l’application que je mettais à trouver sur les rayons des livres dont on ne m’avait jamais parlé. Je me souviens, par exemple, d’avoir cherché éperdument un livre écrit par Dionysos. Aussi, puisqu’elles étaient gardiennes des livres, j’ai toujours pensé que les femmes étaient les médiatrices de ce savoir infini qu’on gardait derrière les portes des bibliothèques. J’ai aussi développé, dans cette façon de fouiller toutes les bibliothèques qui se sont présentées à moi depuis ma tendre enfance, une indépendance dans la lecture que je conserve encore aujourd’hui. Il est rare que je m’adonne à un conseil de lecture, fût-il prodigué par mon meilleur ami. Je tiens encore le flânage dans les rayons comme le plus sûr moyen de trouver des ponts inédits entre notre ignorance et notre savoir, sans l’aide de personne.
J’aime avoir les mains libres, pour ainsi dire, quand il est question de culture. Et l’apanage de cette liberté, ce dont elle se nourrit, est le contraire de l’exil : c’est une identité confirmée par le regard de l’autre. Au moment où nous reconnaissons notre propre pensée dans celle d’un autre, dans cet instant d’intelligence où quelqu’un nous déshabille l’esprit, il y a une impudeur qui réjouit et une violence qui berce, ouvrant des voies de travers pour sortir des sillons de la culture qu’on nous inculque. En ce sens, il est nécessaire de partir pour aller à la rencontre de l’autre, de celui qu’on va devenir. Il est très rare que des esprits arrivent à se développer de manière originale en restant toute leur vie dans la même géographie intime, tout le monde a besoin un jour ou l’autre de sortir de chez soi. Pour certains, un simple changement de quartier fait l’affaire. Pour d’autres, il faut quitter le pays. Parfois, je me demande si les suicidés, au-delà du malaise de vivre, ne cherchent pas à quitter ce monde pour un autre. C’est une hypothèse que bien des spécialistes me reprocheraient, je me garderai donc d’en faire une véritable idée. Toujours est-il que les paysages du Bas-du-Fleuve, qui ont bercé mon enfance et mon adolescence, m’ont semblé tout d’un coup des murs qu’il fallait abattre. Bien des années plus tard, ce sentiment se transformera en nostalgie. Le temps aura fait son œuvre, en affinant ces paysages dans sa meule archaïque qui gruge les perspectives que nous entretenons avec nos propres souvenirs confrontés à l’expérience du réel.
L’écriture aura accompagné cet apprentissage du temps en me donnant peu à peu des signes à tracer dans le vide de cet air glacial qui soufflait du fleuve quand il gelait sous nos yeux. C’était là le fond de l’air, ce puits de science où l’on savait enfin quel temps il faisait, à quel moment précis il allait fendre nos os. Il est étrange que personne n’ait jamais cru bon de noter que le sentiment d’exister dans la durée se mêle aux intempéries de chaque jour, aux éclairs de chaque soir, aux tonnerres et aux catastrophes sans jamais altérer le cours des heures, tandis que bien des fois nous voudrions qu’il s’arrête pour définir la douleur qui nous assaille. C’est que le temps est structuré comme un langage, avec un début, un milieu et une fin, mais il avance dans la brume épaisse de sa propre incomplétude, comme quoi nul discours ne saura jamais venir à bout d’un mythe.
L’insuffisance de l’écriture comme outil de connaissance fut d’abord relevée par Platon dans le Phèdre, un dialogue dans lequel Socrate relate un mythe égyptien qui attribue la découverte de l’écriture à une divinité, Thot, dont l’emblème est ce bel oiseau à bec recourbé, l’ibis. Ce dieu associé à la lumière de la lune, à la première mesure du temps cyclique disponible à l’œil humain, arrache à la nuit cette inscription durable sans quoi l’histoire se désagrège à travers les différents récits des anciens. Devant ce remède à la mémoire, le pharaon répond :
Et voilà maintenant que toi, qui es le père de l’écriture, tu lui attribues, par complaisance, un pouvoir qui est le contraire de celui qu’elle possède. En effet, cet art produira l’oubli dans l’âme de ceux qui l’auront appris, parce qu’ils cesseront d’exercer leur mémoire : mettant, en effet, leur confiance dans l’écrit, c’est du dehors, grâce à des empreintes étrangères, et non du dedans, grâce à eux-mêmes, qu’ils feront acte de remémoration ; ce n’est donc pas de la mémoire, mais de la remémoration, que tu as trouvé le remède.
Les dangers de l’écriture se trouvent ici admirablement décrits, surtout s’agissant là d’une parole qu’on prétend rapporter par le remède qu’on dénonce : encore, l’interlocuteur de Socrate n’est pas dupe, il sait bien que le philosophe invente cette histoire de toutes pièces pour les besoins de sa démonstration. En faisant appel à l’origine de l’écriture, Socrate pose la question fondamentale de la transmission : à qui parle-t-on et dans quel but ? Si l’enseignement qu’on s’imagine aujourd’hui muet et lumineux dans le confort de l’écran sied à tout le monde, cette prétention de Socrate à condamner l’inanité de l’écriture pourrait bien s’avérer plus dramatique que jamais. L’illusion où nous maintient cette accessibilité du savoir est si forte que nous oublions ce qu’elle a traîné dans son sillage : un monde isolé et pervers, narcissique et futile, pour qui les faits ne sont que des mirages parmi d’autres. En l’absence de témoins, l’écriture devient le poison de la parole.
Jacques Derrida, dans La Pharmacie de Platon, oppose cette différence entre la parole et l’écriture à la manière d’un parricide, d’un fils indigne (l’écriture) qui échappe aux griffes de la voix paternelle. Dans sa théorie de la différance, par laquelle l’écriture est le supplément où remède et poison se confondent pour devenir le liquide qui se répand et fuit son origine, le sens se dissémine aux quatre coins du langage et rend caduque la temporalité qui est au cœur du questionnement socratique sur l’écriture. L’écriture laissée à elle-même, sans père ni mère, peut-elle se défendre ? Pour Derrida, l’écriture platonicienne n’a pas besoin de se défendre puisqu’elle est un simulacre destiné à imiter la parole, une manière de faire revivre le mort : « La magie de l’écriture et de la peinture est donc celle d’un fard qui dissimule le mort sous l’apparence du vif. » Ainsi met-il en scène le théâtre philosophique platonicien comme une résurrection de la parole socratique pour tenter de distinguer le bien du mal, le remède du poison, en l’absence du père. À la fin de cette réflexion fascinante de Derrida, on cogne à la porte. Platon vient de passer la nuit à chercher la formule qui lui permettrait de trouver la vérité dans l’écriture, mais doit se résoudre à brûler ses lettres. Il cherche aussi la pierre philosophale, l’or dissimulé dans l’esprit. Pour Socrate, qui n’a laissé aucune écriture derrière lui, on devine qu’il préférait léguer cette tâche aux soins de ceux qui auraient à défendre sa mémoire. Le temps fauche les écritures comme les blés ; elles survivent à la disparition et viennent nous parler d’un autre temps, pendant que ceux qui vivent sont mis à mort pour une prise de parole qui contrevient aux lois du présent.
Quoi qu’il en soit, l’écriture n’est pas plus un remède qu’un poison pour la mémoire, en cela Derrida avait vu juste. Cela dépend du sort qui lui est fait, de la justice qu’on lui rend, à cette écriture qui peut aussi bien mentir que révéler. Dans un monde où l’idée de justice n’a pas de réalité, où cette justice dépend des circonstances, la mémoire devient une sœur ambivalente du temps, parfois une ennemie qui lui dispute le sens du symbole qu’elle érige par l’écriture sans tenir compte de la fortune de son illustre géniteur, mort dans la disgrâce ou le reniement de ses convictions les plus profondes. Dans les pluies diluviennes du passé qui effacent toute trace à mesure qu’elle s’imprime, l’écriture met en danger celui qui l’utilise au service d’une critique du présent.
Arthur Buies, avant d’être le nom d’un boulevard déprimant, fut le plus valeureux esprit de son temps, une lanterne dotée d’une langue apprise à travers quatre échecs successifs au baccalauréat français et d’innombrables voyages qui l’ont mené de Rimouski, où il fut couvé par ses tantes seigneuresses Angèle et Luce, à Naples, d’où il a déserté de l’armée de Garibaldi après avoir combattu aux côtés de cette figure révolutionnaire, peut-être la plus éclatante de son siècle. Qu’on ose nommer un boulevard à sa mémoire tout en le gommant de notre histoire, du moins celle qu’on apprenait aux enfants à mon époque, est suffisant pour illustrer l’amnésie volontaire dans laquelle nous sommes engagés, à la fois bêtes et muets devant les plus remarquables déserteurs qui ont façonné les conquêtes de l’esprit, éprouvantes pour ces contempteurs du présent et gratifiantes pour les autorités passées et futures de nos institutions solennelles. Cette écriture indéfendable n’empêche pas la mémoire de façonner l’oubli dans lequel on laisse pourrir la parole. Bien sûr, des lettrés travaillent pour la mémoire d’Arthur Buies après un long purgatoire qui l’avait condamné au folklore des Belles Histoires des pays d’en haut, quand ce coquin de Claude-Henri Grignon en fit un personnage de fiction dont les traits effacèrent sa figure réelle et impénitente : c’est la thèse brillamment défendue par Jonathan Livernois dans un article intitulé « Le pouvoir démiurgique d’un critique ». Certainement, ce qui gênait Grignon chez Arthur Buies, c’était la beauté anarchique de sa plume devant le style poussif et ampoulé de ce prince conservateur de nos lettres, ce Valdombre aux idées étroites qui fulminait devant quiconque affichait un semblant de liberté dans sa vie comme dans ses phrases.
De retour au Canada après son épisode italien, Buies connut une vie mouvementée qui le fit passer de féroce athée défenseur des idées libérales à colonisateur de l’arrière-pays pour le compte du curé Labelle. Ce destin singulier, atypique pour un Canadien de son époque, traversant pour ainsi dire tout le spectre politique d’un peuple à la recherche d’une identité, voyageant sans relâche dans les paysages parfois inexplorés de ce territoire fascinant, en formation comme peuvent l’être les volcans, mais aiguisant sa plume sur le dos des dormances pr...
Table des matières
- Page couverture
- Les Éditions du Boréal
- Faux-titre
- Du même auteur
- Titre
- Crédits
- Exergue
- Préambule
- Les pommetiers de la place Albert-Duquesne
- Les mains libres
- Disparaître
- Les lendemains qui chantent
- Épilogue
- Note
- Bibliographie sélective
- Crédits et remerciements
- Fin
- Quatrième de couverture
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrir comment résilier votre abonnement
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Apprendre à télécharger des livres hors ligne
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 990 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! En savoir plus sur notre mission
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. En savoir plus sur la fonctionnalité Écouter
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS et Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application
Oui, vous pouvez accéder à Le Temps présent par Maxime Catellier en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Littérature et Dissertations littéraires. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.