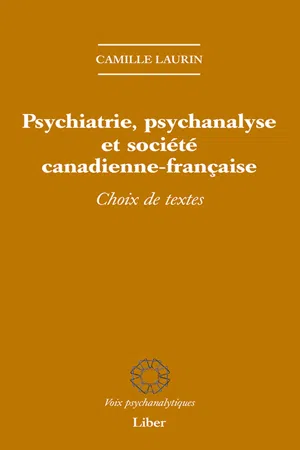
This is a test
- 326 pages
- French
- ePUB (adapté aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Détails du livre
Aperçu du livre
Table des matières
Citations
À propos de ce livre
«Avec le père Noël Mailloux, Clifford Scott, Julien Bigras, François Peraldi et quelques autres fondateurs, le docteur Camille Laurin (1922-1999) est l'un de ceux qui ont véritablement modelé le développement de la psychanalyse québécoise. Connu comme politicien et médecin psychiatre, il l'est toutefois beaucoup moins comme analyste. Pourtant, la discipline fondée par Freud et ses compagnons fut un des moteurs essentiels de sa conception de l'humain et du destin de la société québécoise, laquelle mariait le vieux nationalisme ecclésiastique et le nouvel indépendantisme laïque. Idéaliste, il gardera toujours un penchant socialiste chrétien» (extrait de la présentation).
Foire aux questions
Il vous suffit de vous rendre dans la section compte dans paramètres et de cliquer sur « Résilier l’abonnement ». C’est aussi simple que cela ! Une fois que vous aurez résilié votre abonnement, il restera actif pour le reste de la période pour laquelle vous avez payé. Découvrez-en plus ici.
Pour le moment, tous nos livres en format ePub adaptés aux mobiles peuvent être téléchargés via l’application. La plupart de nos PDF sont également disponibles en téléchargement et les autres seront téléchargeables très prochainement. Découvrez-en plus ici.
Les deux abonnements vous donnent un accès complet à la bibliothèque et à toutes les fonctionnalités de Perlego. Les seules différences sont les tarifs ainsi que la période d’abonnement : avec l’abonnement annuel, vous économiserez environ 30 % par rapport à 12 mois d’abonnement mensuel.
Nous sommes un service d’abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d’un seul livre par mois. Avec plus d’un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu’il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l’écouter. L’outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l’accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui, vous pouvez accéder à Psychiatrie, psychanalyse et société canadienne-française par Camille Laurin en format PDF et/ou ePUB ainsi qu’à d’autres livres populaires dans Médecine et Psychiatrie et santé mentale. Nous disposons de plus d’un million d’ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Sujet
MédecineSous-sujet
Psychiatrie et santé mentalePREMIÈRE PARTIE
Une science en devenir
Pour une histoire du malade
(1957)
L’histoire de la médecine constitue un roman passionnant1. Il est émouvant de voir se construire graduellement sous nos yeux cet immense et magnifique édifice qu’est devenue la médecine moderne. Vésale, Harvey, Ambroise Paré, Leeuwenhoek, Morgagni, Claude Bernard, Pasteur, Lister et Fleming sont des figures de proue qui excitent à bon droit l’admiration. Mais si dans les travaux de ces génies, il est profusément fait mention d’altérations tissulaires, il n’y est pour ainsi dire jamais question du malade lui-même, qui en est pourtant le lieu. Il a fallu attendre jusqu’au début de ce siècle pour que cette étrange omission fût remarquée et soulignée. Il reste encore à voir comment on peut l’expliquer.
Diverses questions se posent alors d’elles-mêmes. Les savants d’hier se doutaient-ils qu’il était aussi important d’étudier l’homme malade que la maladie elle-même ? Croyaient-ils qu’il leur revenait d’aborder ce domaine ? S’estimaient-ils capables de le faire ? Était-il plus facile d’étudier le corps que l’esprit ? Était-il dans la nature des choses que l’examen analytique de la mécanique corporelle précédât l’étude synthétique de l’organisme concret et total ? Jusqu’à quel point la pratique médicale a-t-elle reflété cette méconnaissance théorique de la personnalité et des réactions affectives du malade ?
Une réponse adéquate à toutes ces questions exigerait plus d’un volume. Il nous paraît donc préférable, en l’occurrence, de nous en tenir à quelques remarques d’ordre très général. L’orientation qu’a prise la recherche médicale au cours des vingt ou trente derniers siècles nous semble aussi bien l’effet du hasard que de la nécessité. Un historien n’a-t-il pas affirmé que si le nez de Cléopâtre avait été plus long, toute la face du monde en eût été changée ? N’a-t-on pas fait la même boutade à propos des indigestions du grand Louis xiv et de la petite taille de Napoléon ? Toutes les suppositions sont ainsi permises. La circulation du sang aurait parfaitement pu être découverte par Hippocrate ou un de ses disciples. Pourquoi Bacon n’est-il pas né au siècle de Périclès plutôt que durant cette Renaissance qui déclarait vouloir y prendre ses modèles ? Transplanté au dix-septième siècle, un esprit de la trempe de Freud eût-il été moins incapable de mettre au point la technique psychanalytique et d’élaborer sa théorie du développement psychique ? À considérer la lente construction de l’édifice médical au long des âges, on se sent pris parfois d’un mouvement d’impatience et de regret. De grandes figures se lèvent qui explorent des continents entiers. Puis suivent les haltes qui se prolongent durant des siècles. Pourquoi ces interminables césures entre un Hippocrate et un Harvey, entre un John Weyer et un Freud2 ? Pourquoi tout ce temps perdu alors que les malades continuent de se presser par milliers aux portes des savants ? Est-il donc vrai que le progrès ne procède que par bonds successifs, que le pauvre esprit humain doit prendre le temps d’épuiser le gibier qu’il vient de capturer avant de se remettre en chasse ?
Il semble en tout cas que les grandes découvertes retardent les développements subséquents3. Ainsi, il ne fait pas de doute que la Somme constitue un des plus hauts moments de la pensée humaine. Saint Thomas y distingue très clairement les uns des autres et les trois degrés du savoir4. Mais il subordonne à la philosophie et à la théologie les sciences de la nature et ce sont les deux premières disciplines qui retiennent presque toute son attention. Il ne néglige pas le corps. Mais il a hâte de laisser cette « matière première » pour en arriver à l’âme humaine, cette « forme substantielle » douée d’intelligence et de volonté. Il étudie à fond ces deux facultés et en déduit l’existence d’un être essentiellement vrai, beau et bon, le seul qui soit à leur mesure. Un pont est ainsi établi entre philosophie et théologie. Autre caractéristique essentielle : saint Thomas ne s’en remet qu’à la raison pure pour son travail de prospection. Il crée ce puissant instrument logique qu’est le syllogisme. La déduction bien faite lui apparaît supérieure à l’induction, plus capable que cette dernière d’atteindre à la vérité ultime de l’être, n’ayant nul besoin d’être contrôlée, vérifiée par l’expérience. Par la force de son génie, l’ampleur de ses découvertes, saint Thomas a hypnotisé ses disciples et leurs successeurs. Ils ne pouvaient que s’engager dans la voie qu’il venait d’ouvrir. Durant trois siècles, ils la creusèrent et la prolongèrent indéfiniment. Ils subissaient à ce point l’emprise du maître qu’ils auraient cru le trahir en s’en écartant. Mais n’ayant pas son génie ni sa force d’âme, ils ne tardèrent pas à faire de cette voie une ornière dans laquelle ils pataugèrent misérablement. On n’en veut pour preuve que ces absurdes discussions sur le sexe des anges et les thèses incongrues du nominaliste Occam. Une telle déchéance ne pouvait qu’amener une vigoureuse réaction.
Ce sont les humanistes et les savants de la Renaissance qui donnèrent le coup de barre décisif. Dans ce fatras qu’était devenue la scolastique, ils ne prirent pas le temps ni la peine de distinguer le bon grain de l’ivraie. Ils abandonnèrent tout simplement le terrain et allèrent planter leur tente ailleurs. Au lieu de se consacrer à la métaphysique et à la théologie, ils se tournèrent résolument vers les sciences de la nature. La matière, le corps de l’homme devinrent l’objet essentiel de leurs préoccupations scientifiques. Fait encore plus important, ils mirent au rancart le syllogisme et toute la logique thomiste. Cet instrument conceptuel ne leur paraissait pas en accord avec les buts qu’ils poursuivaient. Prenant la succession d’Hippocrate, ils élaborèrent cette méthodologie inductive, à laquelle Claude Bernard, près de trois siècles plus tard, devait donner, dans un livre fameux, sa forme définitive5. Des découvertes fondamentales venaient immédiatement sanctionner cette nouvelle orientation. Alors que les philosophes de l’École continuaient de piétiner, Francis Bacon écrivait son Instauratio Magna et son Novum Organum, Kepler et Galilée fondaient l’astronomie au rang de discipline scientifique.
Instant crucial dans l’histoire de la pensée. Il existait jusqu’alors une conception unitaire des sciences humaines. Il existait des esprits qui s’essayaient à comprendre l’homme dans son entier. Mais la gageure n’avait pas été tenue. La métaphysique avait fini par étouffer la science. L’étude de l’âme et de ses facultés avait par trop fait négliger celle du corps et de ses attributs. À ces excès, l’inévitable réaction répondit par des excès contraires. Le sort de la conception unitaire était dès lors scellé. Elle s’écroule, laissant en son lieu et place un royaume divisé contre lui-même.
Fascinés par leurs découvertes, éblouis par l’ampleur du travail à accomplir, sûrs de l’efficacité de leur méthode, anatomistes, histologistes, physiologistes s’engageaient à fond dans leurs disciplines respectives. Il serait plus exact de dire qu’ils s’y calfeutrèrent. Ils ne voulurent connaître rien d’autre qu’organes, tissus et cellules. S’occuper des émotions et des divers autres phénomènes de conscience, c’était pour eux faire de la philosophie, discipline qu’ils ne respectaient pas outre mesure, pour laquelle ils s’estimaient incompétents et qu’ils prétendaient ne pouvoir aider en aucune manière. Ainsi s’institua le régime de la chasse gardée et de la cloison étanche, pour ne pas dire du rideau de fer. Les hommes de science virent à ce que soit scrupuleusement respecté le principe de la division du travail. Les incursions des philosophes et des théologiens dans ce qu’ils estimaient être leur territoire furent de ce jour impitoyablement repoussées. Il n’empêche que, ce faisant, ils faisaient de la philosophie sans le savoir. La négation de la métaphysique est encore de la métaphysique. Chassée à grands coups de balai par la grande porte, l’intruse revenait ainsi par la petite. Mais elle se trouvait quand même réduite à la portion congrue.
S’il devenait possible au chercheur de laboratoire de découper l’homme en petits morceaux, le thérapeute, de son côté, n’avait pas la tâche si facile. Il se trouvait en face de malades qui étaient des êtres vivants, ayant chacun leur personnalité propre. Ils pouvaient certes n’en pas tenir compte et escamoter ainsi le problème. Il pouvait également ménager la chèvre et le chou, c’est-à-dire nier théoriquement l’importance du psychisme et recommander pratiquement à son malade un changement d’air ou d’occupation6. Mais s’il voulait aborder de front la difficulté, il devait se résoudre à une gymnastique compliquée. Comme personne encore ne parlait du malade en tant que tel, il devait retrouver l’homme derrière celui-ci, voir ce que disaient à son propos théologiens, philosophes, sociologues, moralistes et romanciers, choisir parmi ces affirmations celles qui lui semblaient s’appliquer à l’être souffrant qui se trouvait devant lui et tenter finalement d’harmoniser ces dernières avec les signes et symptômes cliniques. Quoi d’étonnant à ce qu’un tel héroïsme n’ait pas été monnaie courante ?
Comme nous l’avons dit plus haut, cette orientation de la médecine n’est pas sans devoir quelque chose au hasard. Mais à certains autres égards, elle était peut-être inévitable. La recherche expérimentale, telle que la concevaient les hommes de la Renaissance, exigeait déjà une instrumentation délicate. Que l’on songe aux maux de tête que causèrent à Leeuwenhoek ses lentilles de microscope. Or, pour fabriquer de bonnes lentilles, il faut de longues traditions artisanales et une organisation socioéconomique passablement évoluée. Il en va de même pour balances de précision et divers autres instruments d’observation et de mesure. Dans un autre ordre d’idées, l’esprit humain ne constitue pas un outil en tous points idéal pour la recherche. On a tout dit sur ses grandeurs. Mais il a aussi ses servitudes. Il peut être le jouet de passions autres que celle de la vérité. Lorsqu’il a trouvé un filon qu’il estime riche de promesses, il a tendance à le suivre jusqu’à épuisement, à la façon d’une taupe. Pour s’en dégager, pour embrasser du regard et pouvoir suivre l’ensemble des filons, il doit fournir un gigantesque effort. Bien peu d’hommes en sont capables. Il n’est même pas sûr qu’il s’en trouve un seul. D’où ces fractionnements de la science, ces périodes grasses suivies de périodes maigres, ces orientations parcellaires et zigzagantes de la pensée à travers les âges. Il est enfin plus facile d’étudier l’étendu que l’inétendu, la matière que l’esprit. Ce sont les sens de l’homme qui entrent d’abord en contact avec l’univers et ce sont les objets concrets qui d’abord les stimulent. L’esprit, pour sa part, est caché. Il est dans les choses ou, si l’on veut, derrière les choses. Il fallait donc peut-être explorer « ce qui tombe sous le sens » avant d’arriver à cet élément qui se dérobe, qui est à la fois partout et nulle part. Saint Thomas nous en avait prévenus lorsqu’il disait : Nihil in intellectu quod primus fuerit in sensu, ou encore Quod recipitur ad modum recipientis recipitur. L’homme est mal armé pour une pareille tâche. En l’occurrence, les instruments ne lui sont guère d’un grand secours. Il doit compter surtout sur ses propres facultés spirituelles et il connaît trop bien leurs faiblesses. Il doit de plus s’avancer sur un chemin où balises et garde-fous sont des plus difficiles à mettre en place. C’est ce qu’ont dû vaguement sentir les hommes de la Renaissance après l’échec relatif de la tentative thomiste. On comprend alors que dans un réflexe de sécurité, ils tournèrent le dos à ces régions inhospitalières et s’établirent dans un coin de pays qui, bien que difficile à aménager, leur parut de prime abord plus confortable. Quoi qu’il en soit de ces explications, les faits restent ce qu’ils sont. Si l’histoire de la maladie a été écrite, celle du malade ne l’est pas encore. Mais est-il bien sûr, diront certains, que le jeu en vaille la chandelle ? La question ne présente-t-elle pas, après tout, qu’un intérêt académique ? Rien ne semble moins sûr. En effet, à partir du moment où malade et maladie deviennent tous les deux objets de notre étude, c’est toute une conception de la médecine qui est remise en cause. Diagnostic, pathogénie, thérapeutique, recherches théoriques et cliniques seront envisagés différemment selon que l’on tiendra compte ou non de la personnalité et des réactions affectives du malade.
Cette hypothèse de départ une fois acceptée, il devient extrêmement important de scruter l’amas de connaissances, de demi-vérités, de préjugés et d’erreurs qu’à propos du malade ont pu nous léguer les siècles passés. Entre autres bénéfices, nous pourrions voir ainsi se révéler, avec toute la valeur d’enseignement qu’elle comporte, la logique interne qui préside au déroulement de cette histoire. Connaissant mieux ce qui reste de valable dans les travaux des Anciens, nous pourrions utiliser notre temps et nos forces à bon escient, évitant de nous attaquer à des problèmes déjà résolus. Il n’est pas jusqu’aux erreurs et aux préjugés qui ne pourraient nous servir, tellement il est vrai qu’en science comme en morale, omnia cooperantur in bona, etiam peccata. Une fois leurs causes bien mises en lumière, il devient plus facile d’en éviter la répétition.
Il nous reste à souhaiter que cette longue histoire soit écrite au plus tôt et le mieux possible. Mais avant que le maître se lève qui saura l’écrire, encore bien du temps peut s’écouler. Dans l’intervalle il faudrait susciter et savoir accueillir avec un intérêt bienveillant les modestes tentatives des seconds rôles, pour incomplètes et maladroites qu’elles soient. Ces tentatives ne leur sont après tout inspirées que par l’urgence de la tâche à accomplir.
Le malade aux temps anciens
(1957)
Un travailleur loyal doit toujours porter en lui ce que
l’on pourrait appeler la présence du passé.
René Leriche
l’on pourrait appeler la présence du passé.
René Leriche
S’il veut rester fidèle aux faits, l’historien de la médecine se doit de ne pas séparer ce que la nature a uni, c’est-à-dire le malade et la maladie qui l’afflige1. Il ne doit donc pas se contenter d’analyser la conception que l’on se faisait de la maladie à telle ou telle époque, mais pour chacune de ces époques, il doit nous dire également ce qu’on pensait de la personne du malade et comment on le traitait. De ce fait, le problème se trouve amplifié dans toutes ses dimensions. D’un point de vue chronologique, les peuplades primitives devront faire l’objet d’études plus soigneuses, car si leurs curieuses théories médicales n’ont pas une grande valeur scientifique, leur conception du malade et de la maladie reste intéressante à plus d’un titre. D’un point de vue méthodologique, l’historien ne pourra analyser parfaitement cette période, comme d’ailleurs celles qui suivront, que s’il possède de solides connaissances ethnologiques, sociologiques, psychologiques et philosophiques. Pour employer la formule heureuse de Pierre de Grandpré2, l’histoire de la médecine devient ainsi « une science de carrefour s’appuyant sur une foule de disciplines ».
Si le temps, le courage et la compétence nous manquent pour nous attaquer à ce grand œuvre, il ne nous est pas interdit d’en condenser à l’extrême les chapitres principaux. Nous essaierons maintenant de nous y employer.
Ère pré-hippocratique
Depuis Lévy-Bruhl bien des auteurs se sont attachés à scruter les arcanes de la mentalité primitive. Parmi les épigones de l’ethnologie et de l’anthropologie modernes, qu’il suffise de citer au hasard les noms de Margaret Mead, Ruth Benedict, Gez Roheim, Bronislaw Malinowski, Marcel Mauss, Claude Lévi-Strauss et Marcel Griaule. Il appert des multiples travaux de ces auteurs que la mentalité primitive n’est pas sans ressembler étrangement, sur beaucoup de points, à celle qui transparaît dans le rêve, le mot d’esprit et les actes manqués ou qui se manifeste chez l’enfant, le névrosé et le psychotique. Sigmund Freud, Karl Abraham, Jean Piaget et Marguerite Sechehaye nous ont apporté là-dessus des témoignages on ne peut plus probants3. Il vaut donc la peine de s’arrêter à ce qu’on pensait du malade et de la maladie aux premiers âges de l’humanité. Il est vraisemblable que nous pourrons retrouver des vestiges virulents de ces conceptions sous les opinions et attitudes « raisonnables » des hommes d’aujourd’hui.
S’il nous fallait caractériser laconiquement la manière d’être du primitif, nous pourrions lui appliquer les termes suivants : immaturité, insécurité, intolérance à la frustration, primat de l’affectivité sur la raison, primat du fanta...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Crédits
- Présentation
- I - Une science en devenir
- II - Politique de santé mentale et réorganisation de la pratique médicale
- III - Regards intimes
- Sources
- Collection
- Notes