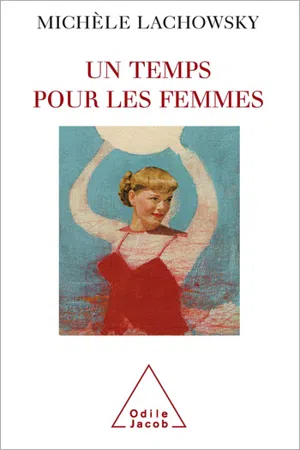
This is a test
- 240 pages
- French
- ePUB (adapté aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Un temps pour les femmes
Détails du livre
Aperçu du livre
Table des matières
Citations
À propos de ce livre
Qu'est-ce qu'être une femme aujourd'hui? Sans dogmatisme, mais en s'appuyant sur les témoignages, les confidences et les histoires de centaines de patientes venues la consulter, Michèle Lachowsky nous rapporte ici comment, dans le secret d'un cabinet médical pas comme les autres, les femmes parlent de leur féminité, comment elles la rêvent et, aussi, comment elles la vivent. Pour que chaque femme, à chaque grande étape de sa vie, puisse s'épanouir dans le respect de sa singularité et de ses choix. Gynécologue, consultante à l'hôpital Bichat, Michèle Lachowsky exerce à Paris.
Foire aux questions
Il vous suffit de vous rendre dans la section compte dans paramètres et de cliquer sur « Résilier l’abonnement ». C’est aussi simple que cela ! Une fois que vous aurez résilié votre abonnement, il restera actif pour le reste de la période pour laquelle vous avez payé. Découvrez-en plus ici.
Pour le moment, tous nos livres en format ePub adaptés aux mobiles peuvent être téléchargés via l’application. La plupart de nos PDF sont également disponibles en téléchargement et les autres seront téléchargeables très prochainement. Découvrez-en plus ici.
Les deux abonnements vous donnent un accès complet à la bibliothèque et à toutes les fonctionnalités de Perlego. Les seules différences sont les tarifs ainsi que la période d’abonnement : avec l’abonnement annuel, vous économiserez environ 30 % par rapport à 12 mois d’abonnement mensuel.
Nous sommes un service d’abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d’un seul livre par mois. Avec plus d’un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu’il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l’écouter. L’outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l’accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui, vous pouvez accéder à Un temps pour les femmes par Michèle Lachowsky en format PDF et/ou ePUB ainsi qu’à d’autres livres populaires dans Psychology et Human Sexuality in Psychology. Nous disposons de plus d’un million d’ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Sujet
PsychologySous-sujet
Human Sexuality in PsychologyVII
Les femmes et leurs hommes
« Prenons acte simplement de la naissance d’une irréductible volonté féminine de partager l’univers et les enfants avec l’homme. Et cette volonté-là changera sans doute la future condition humaine. »
Elisabeth BADINTER
Les femmes et les hommes ne veulent pas toujours les mêmes choses en même temps. En même temps ? Mais c’est exactement ce qu’ils n’ont pas et là est toute la différence. Bien entendu, le temps a toujours été le grand souci des êtres humains, le temps qui passe comme le temps qui reste, le temps qui efface comme celui qui marque. Mais voilà, au contraire de celui, linéaire et continu, des hommes, celui des femmes est rythmé, discontinu, scandé et surtout borné par le sang, sa présence et son absence. Ce cycle féminin n’a qu’un temps et c’est bien pour cela que les femmes n’ont pas le temps, elles n’ont pas le temps des hommes. Eux ont le temps, non pas celui de la longévité, mais celui de la reproduction, qui ne s’arrête qu’avec eux. Les femmes savent leur temps de maternité limité par la ménopause ; les hommes savent leur temps de paternité illimité, du moins dans l’absolu.
Les règles des femmes entre puberté et ménopause, autant de marqueurs de la féminité mais aussi de frontières à la maternité. La médecine a d’ailleurs mis une étiquette sur ces années de la vie féminine : c’est la « période de vie génitale active ». On peut s’interroger sur cette formulation : l’activité des femmes se résumerait-elle à celle de leurs ovaires ? Certes, personne n’oserait s’exprimer ainsi aujourd’hui, du moins je l’espère, mais si la ménopause garde encore son potentiel douloureux, n’est-ce pas aussi parce qu’elle marque la fin du pouvoir de procréation ? Ce terme inéluctable et inchangé de la fertilité féminine semble bien peu compatible avec la longévité sans cesse accrue des femmes et leur manière de considérer la vie, sans parler de leur apparence physique, elles qui sont, à la cinquantaine, tellement plus jeunes que leur grand-mère et même leur mère au même âge. Et que dire de leur quarantaine ? La femme de 40 ans a plus de la moitié de sa vie devant elle aujourd’hui et c’est souvent pour elle le temps de la maternité, un temps où sa fertilité est loin de ce qu’elle était cinq à dix ans plus tôt, temps où d’autres envies et d’autres nécessités l’habitaient.
Échelons à gravir, concours à passer et rage de vivre, mais aussi partenaires sans désir de paternité : autant de dragons à terrasser avant d’en arriver à la découverte de la joie de procréer… ou de sa difficulté. Partenaires sans désir de paternité, ou vaudrait-il mieux dire sans désir d’enfant ? Ce sont deux choses qui pourraient, elles aussi, être différentes, ne pas forcément coexister, être, sinon intellectuellement, du moins émotionnellement distinctes. En effet, fonder une famille, devenir père et s’insérer dans une lignée en prenant sa place aux deux niveaux de l’arbre généalogique est sans doute aussi inscrit au programme de la plupart des hommes, de façon un peu superficielle et sociale pour les uns, profonde et évidente pour les autres, totalement insupportable pour de multiples motifs conscients et inconscients enfin pour certains, plus rares tout de même. Mais le désir d’avoir un enfant, de le faire ici et maintenant avec la femme de sa vie à ce moment précis, voilà qui est différent. Engagement vis-à-vis de cette femme, de cet enfant, engagement et installation dans un autre mode de vie, « c’est un changement de vitesse risqué, comme le disait le compagnon d’une patiente, c’est passer de la première à la quatrième. Non, plutôt rétrograder trop brutalement, la boîte n’y résiste pas toujours », a-t-il ajouté avec un regard vers une compagne que cela n’amusait que modérément. Ce qui vaut pour la femme, la difficulté à sortir d’une vie à deux somme toute assez confortable, sans trop de rigueur ni d’obligations, avec parfois le sentiment d’enfin jouir de la vie, est encore plus important pour l’homme. S’installer dans une permanence, se sentir « rattrapé » par la famille et la société lui semble le faire vieillir brutalement. Ce qui, pour la femme, est un gain lui paraît une perte, une perte d’années, celles de sa jeunesse, de sa liberté, autrement dit de son temps d’homme.
Il y a un temps pour tout, dit l’Ecclésiaste, et les femmes le vivent dans leur corps, elles veulent y croire. L’homme, lui, aurait-il non pas « un » temps, mais « le » temps pour tout ? Sa physiologie le lui suggère, avec tout de même une grande inconnue, la dernière limite, celle de sa durée. Mais avec moins de repères, moins de signaux dans et sur leur corps, l’aune à laquelle ils mesurent leurs temps serait-elle autre ? Si mes patientes ne me semblent pas toujours réaliser que leurs ovaires vieillissent plus vite qu’elles, si elles ne sont pas toujours assez pressées, elles sont cependant, dans leur for intérieur, persuadées que rester femme, c’est devenir mère… un jour. Combien d’entre elles, en échecs répétés de FIV ou autres techniques, m’ont exprimé ce sentiment de marginalité, d’appartenance à un groupe hors norme, d’échec et surtout de n’être pas, ou plus, une « vraie » femme : maternité doit se conjuguer avec féminité pour la réaliser cette vraie femme, cette femme à part entière. D’ailleurs, sans parler des revendications de notre société où le droit à l’enfant semble parfois supplanter le devoir envers cet enfant, de cette société qui veut tout et tout de suite, et surtout tout ce qu’a le voisin, n’est-il pas étonnant que, pour la plupart des femmes d’aujourd’hui, les filles et les petites-filles de celles de 1968, ne pas être mère soit souvent vécu à la fois comme une exclusion et un échec, les empêchant d’être des femmes à part entière ? Effet pervers de nos progrès, comme cela arrive toujours, mais peut-être aussi réveil d’une autre manière de l’envisager, cette féminité qui, sans rien abdiquer, se parachève par la maternité. Si l’on a longtemps caché la femme derrière la mère, comme l’écrit Yvonne Knibiehler, historienne de la maternité, on cache aujourd’hui la mère derrière la femme, par peur, dit-elle, de deux catégories : les féministes et les hommes. Et pourtant, si les animaux mettent bas, les femmes mettent au monde, et les pères amènent les enfants au monde, différence de vocabulaire qui me paraît traduire des rôles, ou des positions, dissemblables.
Et la complétude de l’homme, se situe-t-elle plus dans sa puissance ? Réussite tant sexuelle que professionnelle, son pouvoir est là, affirmation, démonstration nécessaire et suffisante de sa masculinité sans besoin de la preuve par la procréation. Mais si ce pouvoir de reproduction considéré comme une certitude se révèle brutalement défectueux ou, pire, nul, le choc n’en est que plus rude, exposant le manque et la fragilité, érodant l’image et le temps. Pour quelques couples demandant d’office une étude des deux partenaires, des deux demandeurs, oserais-je dire, combien de patients et de patientes, de parents et de familles, convaincus de la « responsabilité » féminine dans l’infertilité ? Et j’emploie à dessein le terme de responsabilité.
C’est une histoire déjà ancienne, qui m’est revenue après avoir vu récemment un jeune couple affolé à l’idée d’une adoption, cette plongée dans l’inconnu comme ils la qualifiaient tous deux à l’unisson, choqués que j’aie pu considérer et proposer cette voie. Voilà donc quelques années que je n’ai plus revu Josefa. Aujourd’hui, elle revient seule, toujours aussi élégante et parfumée, mince brune d’origine sud-américaine. Elle prend son temps pour draper sur le dos du fauteuil son long châle dont les couleurs mettent en valeur l’éclat bleu acier de ses yeux, ses yeux qui m’ont toujours paru si durs, sauf peut-être quand elle regardait son mari. Elle a d’ailleurs tendance à se tourner vers le siège voisin, le droit, celui où, immanquablement, il s’asseyait.
Peu de mondanités, elle va droit au but.
« Vous vous souvenez, docteur, vous nous aviez adressé à Madeleine, pardon, je veux dire le Dr Madeleine X, pour une insémination avec sperme de donneur (ah oui, c’était son mari qui était stérile, cela me revient, car elle m’a à peine laissé le temps de jeter un coup d’œil à son dossier). On y est allés plusieurs fois, mais on a finalement mis en route un dossier d’adoption, je ne pouvais plus supporter les inséminations, ou plutôt l’idée de l’insémination. Cela ressemble tellement à ce qu’on fait pour les animaux, j’ai été élevée là-dedans, vous vous rappelez ( ?) et j’avais l’impression d’être une vache, une vache même pas menée au taureau. Et puis, on ne montrait que cela à la télévision, que des émissions sur la stérilité et les méthodes de PMA, mon mari avait le sentiment qu’on parlait tout le temps de nous !
« Au fond, pourquoi devrais-je avoir un enfant d’un autre homme ? L’ai-je assez dit, comme toutes les amoureuses sans doute, que je voulais un bébé qui lui ressemble ! Et imaginez, s’il naissait avec une anomalie ? Moi, je ne sais pas ce que je ferais dans ce cas, j’irais peut-être jusqu’à l’abandon. J’ai assez vu ce qu’a souffert ma sœur quand elle a eu le premier bébé des deux familles, un anormal, je ne sais plus comment ça s’appelle ce qu’elle a eu, mais toutes ces déceptions, toutes ces opérations, toutes ces craintes, les larmes de ma mère, celles de mon père, cet homme si fort, tout cela je m’en souviens. Maintenant la petite suit plus ou moins en classe, mais ce n’est pas un foudre de guerre, elle est difficile, avec tout ce qu’elle a subi, et la perspective d’autres interventions, esthétiques, en plus… Vous me voyez, imposant à nouveau cela à mes parents ? Et si c’était moi qui transmettais une chose pareille ? Non, franchement, l’adoption, c’est beaucoup mieux, n’est-ce pas, docteur ? »
Ma réponse n’est pas attendue, elle poursuit : « De toute façon, être enceinte ne m’a jamais fait envie. Adolescente déjà, je m’imaginais bien prenant par exemple dans la rue un bébé qui m’aurait plu et que j’aurais élevé. » J’ai un peu de mal à la suivre, mais elle continue à parler et à regarder plus le fauteuil du mari absent que celui où je ne sais quelle figure je fais.
« Je n’ai jamais eu de problèmes, même avec des enfants réputés difficiles, ceux que j’ai eus en colonie de vacances m’envoient encore des lettres où ils se rappellent qu’ils m’appelaient leur “vraie maman”. Mais je ne me vois vraiment pas avec un enfant dans mon corps. Quand un enfant me paraît mignon, j’ai toujours eu envie de le garder pour m’en occuper. Et quand je vois comme certaines femmes s’occupent, ou plutôt ne s’occupent pas, de leurs enfants… »
Je prends avantage de ce silence qui n’est qu’un soupir pour glisser :
« Et votre mari, que pense-t-il de tout cela ?
– Lui aussi, bien sûr, préfère l’adoption. Je crois qu’il ne pourrait pas tolérer que j’accouche de l’enfant d’un autre. En fait, ce qui est difficile, c’est la famille. On ne parle plus jamais de “ça” avec nos familles. Pas plus d’ailleurs avec nos amis. Mon mari est fils unique, vous vous rendez compte ! C’est sûr, le jour où nous leur expliquerons que nous avons des problèmes, ma belle-famille dira qu’elle se doutait depuis longtemps que, moi, j’avais des difficultés ! On ne pourra jamais leur dire que cela vient de mon mari, leur fils… dont l’andrologue dit qu’il aurait dû être opéré dans son enfance… Est-ce que vous croyez qu’en Suisse ou en Amérique, ils auraient des moyens de le soigner ? Dire que mes cousines viennent d’avoir des bébés, et la femme de mon frère aussi, des normaux, qu’il va bien falloir que j’aille voir. Et vous savez ce qu’on me dit au bureau : “Bien sûr, vous qui n’avez pas d’enfant, vous pouvez rentrer tard, et comme le directeur ne jure que par vous…” Certes, mais à la fête des mères ou à Noël, on ne vient pas me proposer de cadeaux. C’est vrai, au début de notre mariage, cette vie à deux nous plaisait bien, on voulait juste attendre un peu… mais pas si longtemps. Si on avait su… »
Elle ravale une larme, cherche un Kleenex au fond de son immense sac, je lui en donne un, tiré de la boîte de secours d’urgence qui est toujours sur mon bureau… en cas de rhume, bien entendu !
« Le pire, c’est qu’on nous répétait que l’insémination, il fallait en parler, à la famille mais, surtout, plus tard à l’enfant. Vous imaginez la tête de nos parents, des siens surtout. On a réfléchi : pour la même raison, on ne peut pas s’adresser aux organismes qui donnent des enfants étrangers, même si on m’a dit que des noirs ou des jaunes, on peut en avoir tant qu’on veut (ah bon ?) ; par contre, on se sent assez forts pour tout compenser, pour un enfant qui aurait déjà connu plusieurs familles d’accueil par exemple. On saura l’aimer. Et je suis contente, le dossier a été accepté, on nous a dit que l’année prochaine, à cette époque, on aura peut-être un enfant, notre enfant ! Mais je parle, je parle, en fait je suis venue pour mon frottis, cela fait deux ans que je n’ai vu personne !
– Allons-y, mais dites-moi, de quand datent vos dernières règles ?
– Voyons, docteur, comme elles n’ont plus aucun intérêt maintenant, vous ne voudriez pas que je m’en souvienne ! »
Mais je me souviens d’elle, et de la photo du petit garçon qu’elle m’a envoyée avec ses vœux un an plus tard.
On peut aussi voir dans le déroulement de cette histoire un inconscient hommage à la femme, la femme des mythes, et à son pouvoir aussi prestigieux que fabuleux. Allons plus loin de façon un peu téméraire. En donnant à Ève le rôle du fauteur de troubles dès l’origine, ne lui fait-on pas porter la responsabilité de la notion de temps, de sa mesure et de sa limite ?
Le téléphone sonne : « Allô ? Pardon de te déranger en pleine consultation, mais je voudrais que tu reçoives rapidement ma femme ; elle est enfin enceinte de nouveau ; veux-tu t’en occuper ? Mais peux-tu nous voir chez toi, à ton cabinet, plutôt qu’ici dans ton service ? » Ici, c’est cette clinique de province où je travaille deux fois par semaine, et mon interlocuteur si pressé est le directeur de la banque voisine. Nous convenons d’un soir où, après ma consultation, je disposerai d’un peu plus de temps et notamment, ai-je ajouté, celui de bavarder un peu ensemble, puisqu’il voulait accompagner sa femme.
Sa femme, je l’avais rencontrée une fois déjà, à son instigation aussi. Il pensait qu’un autre enfant lui rendrait la raison, ou plutôt une raison de vivre. Elle, elle répétait qu’on ne fait pas un enfant pour en remplacer un autre, surtout pas le petit Sébastien, et elle fondait en larmes alors que lui, un peu pâle, murmurait : « C’est vrai, le petit Sébastien, c’était quelqu’un ! »
Le téléphone raccroché, et malgré le joli temps de mai, j’ai retrouvé ma première consultation de la rentrée, un soir de septembre dernier, où j’avais été frappée par l’atmosphère inhabituelle, pesante, et comme chargée d’inquiétude. J’interrogeai mon infirmière qui me raconta : « Le petit Sébastien, vous savez bien, le fils du directeur de la banque ; eh bien, il est mort sur la route du retour des vacances, avec ses grands-parents maternels, cette dernière et si chaude semaine du mois d’août. Un accident de voiture ; peut-être un malaise dû à la chaleur ; le grand-père conduisait. Vous vous rendez compte, le petit garçon et les grands-parents sont morts ; la seule survivante, mais gravement atteinte, est une petite fille de 10 ans, née d’un premier mariage du directeur. »
La situation est d’autant plus douloureuse que le petit Sébastien – je n’en ai jamais entendu parler en d’autres termes – était l’unique enfant de cette femme de plus de 30 ans, dont la raison semblait chavirer comme avait chaviré brutalement son monde, un beau matin, après un coup de téléphone…
« Pensez donc, continue ma petite infirmière tout émue de participer à ce drame, le pauvre n’ose plus la laisser seule, car elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Quand il essaie d’aller travailler, elle l’appelle sans cesse, en larmes, tour à tour menaçante ou suppliante, lui reprochant de l’abandonner, seule, face à son malheur. Nous avons toutes cru qu’elle n’y survivrait pas : ses parents et son enfant ! »
De plus, elle ne supporte pas ses tourments à lui, au sujet de sa fillette, ni surtout son soulagement de la savoir vivante, quoique polytraumatisée. Elle en veut à cette autre mère dont la mort n’a pas pris l’enfant, à cet enfant vivant, à son mari, à ce père qui n’est pas aussi totalement amputé qu’elle.
Pas aussi amputé qu’elle ? Y a-t-il une mesure de malheurs, une comparaison possible, me direz-vous ? Non sans doute, mais pour cette femme, son mari est vécu comme celui qui n’a pas tout perdu, pas perdu la chair de sa chair, portée dans son ventre, et surtout qui ne peut se mettre à sa place. Ce qui est vrai, mais son sauvetage à lui, devant l’immensité de cette douleur, réside dans cette attitude de retrait que les femmes reprochent souvent aux hommes, à leurs hommes. Celui-ci est certes aussi attentionné que bien intentionné, peut-être trop : il est dans l’action, dans le « faire », il lui a « refait » un enfant, elle doit remonter le courant, se montrer à la hauteur. Comme m’a dit une de mes patientes en parlant de son compagnon, il fait des « phrases de jeune cadre » ! Mais ne nous y trompons pas, il souffre aussi… D’ailleurs, quand je le revois, lui, quelques jours après cette tragédie, je le trouve peut-être moins désespéré de la perte de son enfant qu’épouvanté par l’état de sa femme. J’ai d’ailleurs eu, à ce moment, la curieuse impression de me ranger dans le camp des mater dolorosa dont nul, et surtout pas un homme, ne peut ni comprendre ni partager la peine. Peut-être lui en ai-je voulu, obscurément, moi aussi…
À la suite du coup de fil, donc, nous nous sommes revus chez moi. Sa femme, avec un sourire qui n’engageait que sa bouche et jamais ses yeux, parlait peu, à peine plus dans mon cabinet seule avec moi qu’en présence de son mari ; elle ne m’a pas alors donné l’impression d’attendre un enfant ; on parlait présent, santé et grossesse, jamais bébé ni avenir. Je l’ai confiée à un accoucheur qu’elle a accepté sans discuter. J’avais l’impression que tout avait été décidé en dehors d’elle, « pour son bien », ou, du moins, c’est ainsi qu’elle semblait le ressentir – aussi bien la survenue de la grossesse que le choix des médecins –, et cela me mettait mal à l’aise. Je ne l’ai plus revue.
En septembre, à nouveau, un coup de fil de mon ami m’apprit l’arrêt dramatique de cette grossesse, vers quatre mois et demi environ, fin août, comme pour le petit Sébastien. Tout s’était passé dans le sang et la colère, de sombres dissentiments avec l’accoucheur venant encore obscurcir ce tableau. De nouveau, on sentait moins chez mon ami le chagrin que le ressentiment et même la peur, comme s’il se sentait le jouet de forces incompréhensibles. Il se plaignait plus de sa femme qu’il ne la plaignait, et j’avais là encore l’impression qu’il me fallait absolument choisir mon camp, sans très bien savoir si cela se passait au niveau humain, féminin, maternel ou médical. Et je lui en voulais de bousculer ainsi mes repères. Aussi avais-je essayé de limiter nos entrevues au plan strictement professionnel quand, un beau jour, nouveau coup de fil : « Je voudrais t’envoyer, me dit-il, mon beau-frère et sa femme ; ils souhaitent avoir un enfant ; ils ont fait toutes les consultations de stérilité, et commencent à en avoir assez, depuis trois ou quatre ans que cela dure. Peux-tu les recevoir rapidement ? Et plutôt chez toi, à ton cabinet, qu’à la clinique ? »
Cette conversation, je l’avais déjà entendue. En un éclair, j’ai pensé : « Non, je vais répondre non, je ne veux pas », et je me suis entendue dire que j’étais très prise, mais que… Là-dessus, il a ajouté qu’il s’agissait du « petit frère » de sa femme. « Tu sais bien, c’est tout ce qui lui reste de sa famille ; il est très différent, très dépendant d’elle parce que plus jeune et pas très très brillant intellectuellement ; d’ailleurs, c’est un petit mécanicien… » J’entendais le mépris pour le non-intellectuel, le manuel, le canard boiteux de la famille, confié en quelque sorte par les parents morts à sa sœur, pour qui il semblait une charge, sinon matérielle, du moins morale.
Peu après, le couple est venu à mon cabinet. La trentaine tous deux ; lui, en complet gris trois-pièces et cravate discrète ; elle, assez négligée et haute en couleur ; ils m’apportaient un dossier aussi complet que bien tenu, où tous les examens organiques avaient été pratiqués plutôt deux fois qu’une, jusqu’à la cœlioscopie. Ce dossier, matérialisé par une pile de documents bien classés qu’elle me tendait en guise de réponse à mes questions, ne montrait aucune anomalie. Quant à lui, le manuel marié à une enseignante, et le beau-frère d’un « banquier », il restait en retrait, parlait peu, mais avec intelligence et sensibilité.
À mon étonnement de le voir ainsi, j’ai mesuré combien les paroles de mon ami m’avaient prévenue contre lui, alors que je me croyais tout de même moins influençable, et plus dénuée de préjugés ! À mon corps défendant, je me laissais prendre dans les filets de l’amitié et du clan.
« On aimerait tant l’avoir, cet enfant ; croyez-vous qu’on y arrivera un jour, docteur ? (Et il ajoute, après un petit temps d’arrêt : ) Vous savez l’histoire du petit Sébastien, n’est-ce pas ? » « Oui », ai-je répondu tout simple...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Dédicace
- Avant-propos
- I - Le temps des femmes
- II - Intimité
- III - Mais que disent-elles, que veulent-elles ?
- IV - Et maintenant, le premier enfant ?
- V - Quarante ans, et après ?
- VI - La peur de vieillir
- VII - Les femmes et leurs hommes
- Épilogue
- Bibliographie