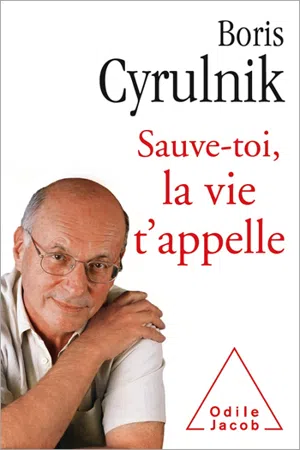Je suis né deux fois.
Lors de ma première naissance, je n’étais pas là. Mon corps est venu au monde le 26 juillet 1937 à Bordeaux. On me l’a dit. Je suis bien obligé d’y croire puisque je n’en ai aucun souvenir.
Ma seconde naissance, elle, est en pleine mémoire. Une nuit, j’ai été arrêté par des hommes armés qui entouraient mon lit. Ils venaient me chercher pour me mettre à mort. Mon histoire est née cette nuit-là.
L’arrestation
À 6 ans, le mot « mort » n’est pas encore adulte. Il faut attendre un an ou deux pour que la représentation du temps donne accès à l’idée d’un arrêt définitif, irréversible.
Quand Mme Farges a dit : « Si vous le laissez vivre, on ne lui dira pas qu’il est juif », j’ai été très intéressé. Ces hommes voulaient donc que je ne vive pas. Cette phrase me faisait comprendre pourquoi ils avaient dirigé leur revolver vers moi quand ils m’avaient réveillé : torche électrique dans une main, revolver dans l’autre, chapeau de feutre, lunettes noires, col de veste relevé, quel événement surprenant ! C’est donc ainsi qu’on s’habille quand on veut tuer un enfant.
J’étais intrigué par le comportement de Mme Farges : en chemise de nuit, elle entassait mes vêtements dans une petite valise. C’est alors qu’elle a dit : « Si vous le laissez vivre, on ne lui dira pas qu’il est juif. » Je ne savais pas ce que c’était qu’être juif, mais je venais d’entendre qu’il suffisait de ne pas le dire pour être autorisé à vivre. Facile !
Un homme qui paraissait le chef a répondu : « Il faut faire disparaître ces enfants, sinon ils vont devenir des ennemis d’Hitler. » J’étais donc condamné à mort pour un crime que j’allais commettre.
L’homme qui est né en moi cette nuit-là a été planté dans mon âme par cette mise en scène : des revolvers pour me tuer, des lunettes noires la nuit, des soldats allemands fusil à l’épaule dans le couloir et surtout cette phrase étrange qui révélait ma condition de futur criminel.
J’en ai aussitôt conclu que les adultes n’étaient pas sérieux et que la vie était passionnante.
Vous n’allez pas me croire quand je vous dirai que j’ai mis longtemps à découvrir que, lors de cette nuit impensable, j’étais âgé de 6 ans et demi. J’ai eu besoin de repères sociaux pour apprendre que l’événement avait eu lieu le 10 janvier 1944, date de la rafle des Juifs bordelais. Pour cette seconde naissance, il a fallu qu’on me fournisse des jalons extérieurs à ma mémoire1, afin de tenter de comprendre ce qui s’était passé.
L’année dernière, j’ai été invité à Bordeaux par RCF, une radio chrétienne, pour une émission littéraire. En m’accompagnant vers la sortie, la journaliste me dit : « Prenez la première rue à droite et vous verrez, au bout, la station de tramway qui vous mènera à la place des Quinconces, au cœur de la ville. »
Il faisait beau, l’émission avait été sympathique, je me sentais léger. Soudain, j’ai été surpris par un surgissement d’images qui s’imposaient à moi : la nuit, dans la rue, le barrage des soldats allemands en armes, les camions bâchés le long des trottoirs et la voiture noire dans laquelle on m’a poussé.
Il faisait beau, on m’attendait à la librairie Mollat pour une autre rencontre. Pourquoi, soudain, ce retour d’un passé lointain ?
En arrivant à la station j’ai lu, sculpté dans la pierre blanche d’un grand bâtiment : « Hôpital des Enfants malades ». Tout à coup m’est revenu l’interdit de Margot, la fille de Mme Farges : « Ne va pas dans la rue de l’hôpital des Enfants malades, il y a beaucoup de monde, on pourrait te dénoncer. »
Stupéfait, je reviens sur mes pas et découvre que je venais de traverser la rue Adrien-Baysselance. J’étais passé devant la maison de Mme Farges sans m’en rendre compte. Je ne l’avais pas revue depuis 1944, mais je crois qu’un indice, l’herbe entre les pavés disjoints ou le style des perrons, avait amorcé dans ma mémoire le retour du scénario de mon arrestation.
Même quand tout va bien, un indice suffit pour réveiller une trace du passé. La vie quotidienne, les rencontres, les projets enfouissent le drame dans la mémoire, mais à la moindre évocation, une herbe entre les pavés, un perron mal construit, un souvenir peut surgir. Rien ne s’efface, on croit avoir oublié, c’est tout.
Je ne savais pas, en janvier 1944, que j’aurais à faire ma vie avec cette histoire. D’accord, je ne suis pas le seul à avoir vécu l’imminence de la mort : « J’ai traversé la mort, elle est devenue une expérience de ma vie2… », mais, à 6 ans, tout fait trace. La mort s’inscrit dans la mémoire et devient un nouvel organisateur du développement.
Les souvenirs qui donnent sens
Le décès de mes parents n’a pas été un événement pour moi. Ils étaient là, et puis, ils n’ont plus été là. Je n’ai pas de trace de leur mort, mais j’ai reçu l’empreinte de leur disparition3. Comment vivre avec eux et puis soudain sans eux ? Il ne s’agit pas d’une souffrance ; on ne souffre pas dans le désert, on meurt, c’est tout.
J’ai des souvenirs très clairs de ma vie de famille avant la guerre. Je commençais à peine l’aventure de la parole puisque j’avais 2 ans, et pourtant je garde encore des souvenirs d’images. Je me souviens de mon père lisant le journal sur la table de la cuisine. Je me souviens du tas de charbon au milieu de la pièce. Je me souviens des voisins de palier chez qui j’allais admirer le rôti en train de cuire. Je me souviens de la flèche en caoutchouc que mon oncle Jacques, âgé de 14 ans, m’avait tirée en plein front.
Je me souviens que j’avais crié très fort afin de le faire punir. Je me souviens de la patience accablée de ma mère attendant que je mette mes chaussures tout seul. Je me souviens des grands bateaux sur les quais de Bordeaux. Je me souviens des hommes débarquant sur leur dos d’immenses régimes de bananes et je me souviens de mille autres saynètes sans paroles qui, aujourd’hui encore, charpentent ma représentation d’avant guerre.
Un jour, mon père est revenu en uniforme et j’ai été très fier. Les archives m’expliquent qu’il s’était engagé dans le « Régiment de marche des volontaires étrangers », troupe composée de Juifs étrangers et de républicains espagnols. Ils ont combattu à Soissons et ont subi des pertes énormes4. À cette époque, je ne pouvais pas savoir ça. Aujourd’hui, je dirais que j’étais fier d’avoir un père soldat, mais que je n’aimais pas son calot dont les deux pointes me paraissaient ridicules. J’avais 2 ans : ai-je vraiment ressenti cela ou l’ai-je vu sur une photo après la guerre ?
L’enchaînement des faits donne sens à l’événement.
Première saynète : l’armée allemande défile dans une grande avenue près de la rue de la Rousselle. Je trouve ça magnifique. La cadence des soldats frappant le sol tous ensemble dégage une impression de puissance qui me ravit. La musique ouvre la marche et de gros tambours sur chaque flanc d’un cheval donnent le rythme et provoquent une merveilleuse frayeur. Un cheval glisse et tombe, les soldats le relèvent, l’ordre est rétabli. C’est un drame magnifique. Je m’étonne qu’autour de moi quelques adultes pleurent.
Deuxième saynète : nous sommes à la poste avec ma mère. Les soldats allemands se promènent dans la ville par petits groupes, sans arme, sans calot et même sans ceinturon. Je leur trouve l’air moins guerrier. L’un d’eux fouille dans sa poche et me tend une poignée de bonbons. Ma mère me les prend brutalement et les rend au soldat en l’injuriant. J’admire ma mère et regrette les bonbons. Elle me dit : « Il ne faut jamais parler à un Allemand. »
Troisième saynète : mon père est en permission. On se promène sur les quais de la Garonne. Mes parents s’assoient sur un banc, je joue avec une balle qui roule vers un autre banc où sont assis deux soldats. L’un ramasse la balle et me la tend. Je refuse d’abord, mais, comme il est souriant, j’accepte.
Peu après, mon père repart à l’armée. Ma mère ne le reverra jamais. Ma mémoire s’engourdit.
Mes souvenirs reviendront plus tard, quand Margot viendra me chercher à l’Assistance. Mes parents ont disparu. Je me rappelle alors que j’ai parlé à ces soldats malgré l’interdiction, et cet enchaînement de souvenirs me fait penser que, si mes parents sont morts, c’est parce que, sans le faire exprès, j’ai dû donner notre adresse en parlant.
Comment un enfant peut-il expliquer la disparition de ses parents quand il ne sait pas qu’existent des lois antijuives et que la seule cause possible est la transgression de l’interdit : « Il ne faut pas parler aux Allemands. » C’est l’enchaînement de ces fragments de mémoire qui donne cohérence à la représentation du passé. En agençant quelques souvenirs épars, j’en ai conclu qu’ils étaient morts à cause de moi.
Dans une chimère, tout est vrai : le ventre est d’un taureau, les ailes d’un aigle et la tête d’un lion. Pourtant, un tel animal n’existe pas. Ou, plutôt, il n’existe que dans la représentation. Toutes les images mises en mémoire sont vraies. C’est la recomposition qui arrange les souvenirs pour en faire une histoire. Chaque événement inscrit dans la mémoire constitue un élément de la chimère de soi.
Je n’engrangeais de souvenirs que lorsqu’il y avait de la vie autour de moi. Ma mémoire s’est éteinte quand ma mère s’est éteinte. Or à l’école maternelle de la rue du Pas-Saint-Georges on vivait intensément. Margot Farges, l’institutrice, mettait en scène avec ses petits comédiens âgés de 3 ans la fable du Corbeau et le Renard. Je me souviens encore de la perplexité dans laquelle m’avait plongé le vers : « Maître Corbeau, sur un arbre perché… » Je me demandais comment on pouvait percher un arbre et y mettre un corbeau, mais ça ne m’empêchait pas d’adhérer pleinement à mon rôle de Maître Renard.
J’étais particulièrement indigné parce que deux petites filles s’appelaient « Françoise ». Chaque enfant, pensais-je, doit être désigné par un prénom à nul autre pareil. J’estimais qu’en donnant un même prénom à plusieurs petites filles on déconsidérait leur personnalité. Je commençais déjà ma formation psychanalytique !
S’appeler Jean Bordes (ou Laborde ?)
À la maison, une non-vie engourdissait nos âmes. À cette époque, quand les hommes s’engageaient dans l’armée, les femmes ne pouvaient compter que sur la famille. Pas d’aide sociale en 1940. Or la famille parisienne de ma mère disparaissait. Une petite sœur, Jeannette, âgée de 15 ans, a disparu ainsi. Pas de traces d’arrestation, pas de rafle, rien, soudain elle n’était plus là. « Disparue » est le mot.
Pas de possibilité de travailler non plus, c’était interdit. J’ai le vague souvenir de ma mère vendant les objets de la maison, sur un banc, dans la rue.
Énorme trou de mémoire entre 1940 et 1942. J’ignorais les dates et j’ai gardé pendant longtemps un chaos de la représentation du temps. « J’avais 2 ans quand j’ai été arrêté… non, c’est impossible, je devais avoir 8 ans… mais non, la guerre était finie. » Quelques images d’une précision étonnante persistaient dans ma mémoire incapable de les situer dans le temps.
Récemment, on m’a appris que ma mère m’avait placé à l’Assistance publique, la veille de son arrestation, le 18 juillet 1942. Je n’ai pas envie de vérifier. Quelqu’un a dû la prévenir. Je n’ai jamais pensé qu’elle m’avait abandonné. Elle m’a mis là pour me sauver. Puis elle est rentrée chez elle, seule, dans un logement vide, sans mari, sans enfant. Elle a été arrêtée au petit matin. Je n’ai pas envie d’y réfléchir.
J’ai dû rester un an à l’Assistance, je ne sais pas. Aucun souvenir. Ma mémoire est revenue le jour où Margot est venue me chercher. Pour m’apprivoiser, elle avait apporté une boîte de morceaux de sucre et m’en donnait régulièrement, jusqu’au moment où elle a refusé en disant : « C’est fini. » C’était, je crois, dans un wagon qui venait de je ne sais où pour aller à Bordeaux.
Dans la famille de Margot, ma mémoire est redevenue vive. M. Farges, inspecteur d’académie, menaçait de « se fâcher tout rouge ». Je faisais semblant d’être impressionné. Mme Farges reprochait à sa fille : « Tu aurais pu nous prévenir que tu allais chercher cet enfant à l’Assistance. »
Suzanne, la sœur de Margot, enseignante à Bayonne, m’apprenait à lire les heures sur la grosse pendule du salon, et à manger comme un chat, me disait-elle, à petits coups de langue et non pas comme un chien qui avale tout d’un coup. Je crois lui avoir dit que je n’étais pas d’accord.
Les Farges avaient des réunions étranges autour d’un gros poste où l’on entendait : « Les raisins sont trop verts… je répète… les raisins sont trop verts » ou : « Le petit ours a envoyé un cadeau au papillon… je répète… » Un bruit de crécelle couvrait ces paroles parfois difficiles à entendre. Je ne savais pas qu’on appelait ça Radio-Londres, mais je trouvais que ce n’était pas sérieux de se grouper autour d’un poste pour écouter gravement des phrases rigolotes.
On m’avait donné quelques missions dans cette famille : entretenir un petit bout de jardin, aider au nettoyage du poulailler et aller chercher le lait qui était distribué dans une porte cochère, près de l’hôpital des Enfants malades. Je remplissais mes journées avec ça, lorsqu’un jour, Mme Farges a dit : « À partir d’aujourd’hui tu t’appelleras Jean Bordes. Répète ! »
J’ai probablement répété, mais je ne comprenais pas pourquoi il fallait changer mon nom. Une dame qui venait parfois aider Mme Farges pour les travaux de la maison m’a expliqué gentiment : « Si tu dis ton nom, tu mourras. Et ceux qui t’aiment mourront à cause de toi. »
Le dimanche, Camille, le frère de Margot, venait s’ajouter à la table familiale. Tout le monde riait dès qu’il apparaissait. Un jour, il est venu habillé en scout avec un jeune camarade. Cet ami, poli, réservé, frisé comme un mouton, se tenait en arrière et souriait quand Camille faisait rire son monde en m’appelant « le petit j’aborde » et en me demandant : « Qu’est-ce que tu abordes, Jean ? »
Je n’ai jamais pu me souvenir du nom qui me cachait : Bordes ?… Laborde ? Je n’ai jamais su. Bien plus tard, quand j’ai été interne en neurochirurgie à l’hôpital de La Pitié, à Paris, une jeune médecin s’appelait Bordes. J’ai failli lui dire qu’elle portait le nom sous lequel on m’avait caché pendant la guerre. Et puis, je me suis tu. J’ai pensé : « C’est peut-être Laborde ? » Et puis, il aurait fallu donner tant d’explications !
Deux ans après la Libération, quand on m’a redonné mon nom à l’école, j’ai eu la preuve que la guerre était finie.
Ma tante Dora, la sœur de ma mère, m’avait recueilli. Le pays était en fête. Les Américains donnaient le ton. Ils étaient jeunes et minces, et, dès qu’ils apparaissaient, la gaieté entrait dans les maisons avec eux. Leurs éclats de rire, leur accent amusant, leurs histoires de voyages, leurs projets d’existence m’enchantaient. Ces hommes distribuaient du chewing-gum et organisaient des orchestres de jazz. Les femmes attachaient beaucoup d’importance aux bas nylon sans couture et aux cigarettes Lucky Strike. Un jeune Américain qui portait de petites lunettes rondes décida que Boris n’était pas un prénom convenable, cela faisait trop russe. Il me baptisa Bob. Ce prénom prenait la lumière, il signifiait « retour à la liberté ». Tout le monde a applaudi, je l’ai accepté sans plaisir.
Ce n’est que lorsque je suis devenu étudiant en médecine que je me suis fait appeler Boris. À ce moment, j’ai eu l’impression que ce prénom pouvait être prononcé loin des oreilles de Dora, sans risque de la blesser. Pour elle, c’était encore le prénom du danger, alors que Bob était celui de la renaissance, de la fête avec les Américains, nos libérateurs. Dans les lambeaux de ma famille je restais encore caché, mais loin d’eux, je pouvais devenir moi-même et me faire représenter tel que j’étais, par mon vra...