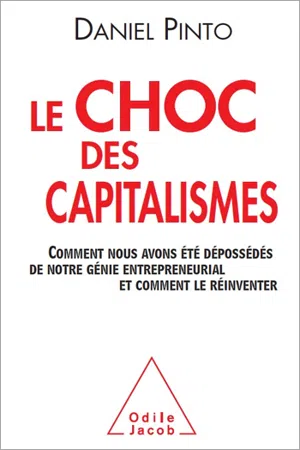Deux modèles de conquête, un seul horizon
Pendant que nos politiques promettent tardivement de la sueur et des larmes à des populations qui préfèrent entendre parler de lendemains qui chantent, que les dirigeants de nos grands groupes agissent en gardiens du statu quo alors qu’il y a péril en la demeure et que nos financiers continuent de s’agiter, les puissances émergentes poursuivent leur marche inexorable. À notre capitalisme spontané basé sur l’espoir que la main invisible nous amènera toujours in fine la prospérité collective, ces puissances émergentes opposent un capitalisme prémédité ne laissant rien ou pas grand-chose au hasard. Tandis que le capitalisme spontané agit dans l’instant, le capitalisme prémédité planifie et reste entre les mains d’acteurs économiques capables de prendre des risques financiers considérables pour aboutir à leurs fins.
Deux modèles sont au cœur du succès des puissances émergentes aujourd’hui : le capitalisme étatico-entrepreneurial et le capitalisme familial. Le premier, basé sur une coopération étroite entre l’État, pierre angulaire du système, et les entreprises publiques ou privées, a permis à la Chine et à la Russie de devenir des moteurs de la croissance mondiale et des puissances incontournables sur l’échiquier géopolitique. Ces deux pays ont chacun adopté leur propre version de ce capitalisme étatico-entrepreneurial, mettant plus ou moins d’emphase sur le rôle de l’État. La Chine a opté pour une ouverture graduelle et planifiée au capitalisme, le Parti communiste gardant la haute main sur les entreprises d’État dans pratiquement tous les secteurs, mais cautionnant également l’émergence de champions nationaux à capitaux privés. Le processus fut beaucoup plus chaotique en Russie. Après avoir plongé dans le capitalisme sauvage sous Eltsine, le pays opéra un virage à 180 degrés. Le Kremlin de Poutine reprit directement ou indirectement le contrôle des plus grandes entreprises dans les secteurs clés de l’énergie, des mines, de la défense et de la banque. Malgré des différences notables aussi bien dans l’histoire de leur capitalisme que dans leurs modes opératoires, la Chine et la Russie ont en commun d’avoir parié que c’est cette forme d’organisation hybride de leur économie qui leur permettrait d’accélérer aussi bien leur développement que la conquête des marchés extérieurs. L’histoire semble pour le moment leur donner raison.
Le second modèle, organisé autour de grandes familles entrepreneuriales à la fois propriétaires et managers de leurs groupes, a propulsé l’Inde et le Brésil aux toutes premières places mondiales dans de nombreux secteurs de l’industrie et des services. Dans ces pays aussi les entreprises privées coopèrent avec des pouvoirs publics restés puissants sur le plan économique, mais – à la différence du premier modèle – l’initiative reste malgré tout largement entre les mains du secteur privé. En Inde, les groupes familiaux tendent à être des conglomérats existant souvent depuis plusieurs générations. Au Brésil en revanche, les sociétés familiales sont généralement un peu moins diversifiées et cohabitent avec un grand nombre de concurrents cotés dont l’actionnaire minoritaire est souvent l’État brésilien à travers sa banque de développement, la BNDES. Ce capitalisme familial, de nature plus entrepreneuriale que dynastique, est également au cœur de la croissance remarquable d’économies comme le Mexique ou la Turquie. Ces deux pays représenteront une part du PIB mondial plus importante que la plupart des pays européens au cours des deux prochaines décennies.
Pour ceux d’entre nous qui avons vécu la plus grande partie de notre vie dans un système capitaliste libéral ancré dans une philosophie d’inspiration reagano-thatchérienne, l’ascension fulgurante de ces deux modèles est une surprise qui nous a pris de court aussi bien pratiquement qu’idéologiquement. Nous percevons l’existence même de ce capitalisme étatico-entrepreneurial aujourd’hui comme un véritable anachronisme. Après la chute du mur de Berlin, il semblait en effet évident que l’État et l’entreprise ne feraient jamais bon ménage et qu’il était important de laisser les forces du marché jouer leur rôle sans obstruction des pouvoirs publics. Même en France, après les expérimentations économiques des premières années de Mitterrand, le réalisme avait pris le dessus. Les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, n’ont jamais plus remis en cause la nécessité de privatiser les entreprises publiques et de laisser le secteur privé vivre sa vie. Certes, la tentation de l’interventionnisme politique en matière économique n’a jamais totalement disparu, mais il a semblé préférable à tous qu’elle s’exprime de façon informelle plutôt qu’officielle.
Notre surprise devant la percée de la Chine en particulier est double. Tout d’abord, le fait que des entreprises en majorité détenues par l’État puissent être compétitives à l’échelle internationale bouleverse nos a priori. Aujourd’hui, la liste des cinq cents plus grandes entreprises mondiales (Fortune 500) compte soixante et une entreprises chinoises, le troisième plus gros contingent derrière les États-Unis et le Japon. Les deux tiers de ces entreprises sont des entreprises d’État. Trois des dix plus grands groupes mondiaux en termes de chiffres d’affaires sont des entreprises d’État chinoises : Sinopec, géant de la pétrochimie, China National Petroleum Corporation (CNOOC), « major » du pétrole, et State Grid Corporation of China, la compagnie d’électricité. Ces sociétés réalisent des chiffres d’affaires de plusieurs centaines de milliards de dollars et rivalisent en termes de taille avec des géants occidentaux comme Walmart, BP ou Nestlé. Leurs marges n’ont également rien à envier avec celles des principaux concurrents de leur secteur.
L’autre surprise est qu’un secteur public fort puisse cohabiter, voire coopérer étroitement, avec le secteur privé. Si l’on compte les entreprises d’État et les entreprises dans lesquelles l’État est l’actionnaire de référence sans être pour autant majoritaire, le secteur public représente de 40 à 50 % du PIB chinois contre plus de 70 % à la fin des années 1990. Les progrès du secteur privé ont donc été considérables, mais contrairement à ce que l’on imagine en Occident, ces progrès ont eu lieu non pas malgré l’État mais en partie grâce à lui.
Le succès du capitalisme familial à travers le monde a également remis en cause nos préjugés. Depuis près de vingt ans, nous sommes habitués en Occident à voir reculer les grands actionnaires familiaux au profit des institutionnels, un mouvement que nous avons appris à considérer comme naturel et inéluctable. L’image même du capitalisme familial s’est ringardisée au fil des années. Les experts en management qui enseignent dans nos plus prestigieuses universités expliquent généralement que l’actionnariat familial ne peut par définition être qu’une phase transitoire dans la vie d’une entreprise car à mesure que l’entreprise grandit, elle ne peut financer sa croissance qu’en ayant recours à des sources externes de capitaux la poussant in fine à s’introduire en Bourse. Le problème de la succession est aussi généralement mentionné comme un obstacle insurmontable, car il serait impossible de reproduire le génie du fondateur de génération en génération. Les nouvelles générations sont censées avoir perdu leur faim de réussite et être plus intéressées par leurs collections d’art ou leurs œuvres caritatives que par le compte de résultat de l’entreprise dont ils ont hérité.
Nous sommes également habitués à considérer que les conglomérats sont des reliques du passé, par définition destructeurs de valeurs. À l’exception du groupe américain GE qui inspire toujours le respect, le dogme managérial occidental voudrait qu’une entreprise ne puisse maintenir son excellence et développer des synergies entre des activités trop disparates.
L’expérience des grandes sociétés indiennes, brésiliennes, mexicaines ou turques – non seulement chez elles mais aussi sur les marchés internationaux – infirme ces analyses. Des groupes indiens comme Tata ou Reliance Industries de la famille Ambani n’ont pas manqué de capitaux pour se développer aussi bien sur leurs activités traditionnelles que sur de nouveaux métiers. C’est même l’inverse qui s’est produit. Souvent, ces groupes n’ont pas hésité à investir plusieurs milliards de dollars pour lancer avec succès de nouvelles activités là où les managers professionnels de sociétés américaines ou européennes cotées auraient trouvé une diversification inappropriée ou beaucoup trop risquée. Par ailleurs, même si le souci de la succession est toujours présent dans ces groupes, nombreux sont ceux qui ont réussi à combiner leur souhait de préserver leurs racines familiales avec la nécessité de promouvoir une culture managériale basée sur l’excellence et le mérite.
La question clé pour nous aujourd’hui est de comprendre ce que ces deux formes de capitalisme ont en commun et qui puisse expliquer leurs avancées par rapport à notre capitalisme occidental. La plus grande force aussi bien du capitalisme étatico-entrepreneurial que du capitalisme familial est de pouvoir compter sur un actionnariat stable qui donne aux entreprises le loisir de construire. Les dirigeants occidentaux ont le sentiment qu’on leur demande, implicitement ou explicitement, de décider pour demain, pas pour après-demain. L’actionnaire étatique ou familial réfléchit bien entendu différemment.
La seconde différence tient à la perception du couple rentabilité/risques. Dans la mentalité occidentale, l’objectif du dirigeant est avant tout de se focaliser sur des projets susceptibles d’offrir la rentabilité la plus élevée pour le risque le plus faible. On exclura donc sans trop d’hésitation des projets offrant une rentabilité tout à fait honorable mais jugée insuffisante au regard des risques associés. L’hypothèse sous-jacente est que le capital est rare et que s’il est alloué à un projet « non optimal », l’entreprise ne sera pas en mesure de l’utiliser pour financer des investissements qui en vaudraient réellement la peine. L’argument semble a priori logique sauf qu’il n’est absolument pas vérifié dans les faits. Les entreprises occidentales ont certes mis un frein à leurs investissements, mais elles ont dans le même temps accumulé ces dernières années des montagnes de liquidités offrant une rentabilité quasi nulle. Elles préfèrent racheter leurs actions ou payer un dividende exceptionnel plutôt que d’engager leurs capitaux dans des projets qui, en apparence, ne généreraient pas assez rapidement une rentabilité sur capitaux investis d’au moins 15 %, seuil magique qui s’est mystérieusement imposé dans la plupart des salles de conseils. Le problème, avec cette approche, est que ces groupes occidentaux laissent filer de nombreux projets qui n’ont pas franchi cette barre auto-imposée de rentabilité, par ailleurs tout à fait discutable, et qui pourtant auraient pu s’avérer rémunérateurs sur le long terme.
Cela n’a évidemment pas échappé aux concurrents des pays émergents qui s’engouffrent dans la brèche. Leur attitude est en effet complètement différente, tant pour ce qui est de la perception du risque que des attentes de rentabilité. Habituées à vivre dans un environnement économique et politique où les aléas sont nombreux, ces entreprises sont généralement prêtes à prendre des risques bien plus élevés que leurs concurrents occidentaux. Ils ne les vivent pas comme tels, mais c’est néanmoins une réalité objective. Pour ce qui est des attentes de rentabilité, ces entreprises et leurs actionnaires, qu’ils soient publics ou privés, réfléchissent beaucoup moins en termes de coût d’opportunités que leurs concurrents occidentaux. L’expérience a montré en Chine et en Russie que l’État actionnaire qui poursuit des objectifs stratégiques est prêt à sacrifier la rentabilité pendant quelques années pour arriver à ses fins. Quant aux grandes familles actionnaires en Inde, au Brésil et ailleurs, elles ont tendance à laisser la plus grande partie de leurs capitaux dans l’entreprise. La question d’un usage alternatif du capital ou d’un rachat d’actions ne se pose donc pas, même quand l’entreprise est cotée. Si le taux d’intérêt offert par les banques sur les dépôts est de 5 % et que l’entrepreneur a le sentiment qu’un nouveau projet est susceptible de générer plus, la probabilité est qu’il ira de l’avant sur le nouveau projet. Pas de seuils arbitraires, pas de calculs pseudo-scientifiques pour assigner des probabilités de succès, l’entrepreneur fera ce qu’il fait de mieux depuis la nuit des temps : utiliser son savoir-faire, mais aussi ses réseaux et son instinct pour maximiser les chances de succès de son projet.
Ce sont ces attributs différents, mais convergents sur l’essentiel – l’horizon temps –, qui ont permis aussi bien au capitalisme étatico-entrepreneurial qu’au capitalisme familial de gagner du terrain ces dernières années. Il est à la mode depuis quelque temps de douter de la pérennité des modèles de croissance des nouvelles puissances émergentes. L’affaissement des taux de croissance en Chine mais aussi dans des pays comme l’Inde ou le Brésil est souvent interprété par les commentateurs occidentaux comme la preuve tant attendue de leur fragilité intrinsèque et d’un possible renversement de tendance. Que l’on se détrompe. Les trous d’air conjoncturels ne vont pas fondamentalement changer la trajectoire ascendante de ces grandes nations. La piètre consolation que nous pouvons en tirer est que leurs succès incontestables dans la compétition internationale au cours des dernières décennies semblent d’abord avoir été le reflet de nos propres faiblesses. Il nous est donc encore possible d’éviter la marginalisation et de changer le cours des choses.
Les secrets du capitalisme étatico-entrepreneurial
Le nouvel empire du milieu
Depuis les années 1990, le régime communiste a mis en place un système économique complètement inédit qui a brisé les schémas que nous avions en tête. Partisan d’une migration graduelle plutôt que brutale vers l’économie de marché, l’État communiste est resté au cœur du système, mais a permis l’émergence d’entreprises d’État très efficaces, souvent cotées en Bourse, et qui sont devenues leaders dans leurs secteurs. Le régime a en même temps encouragé et soutenu la création de milliers d’entreprises privées dans lesquelles il ne joue pas un rôle direct mais qui évoluent néanmoins en symbiose avec le secteur public. Alors qu’en 1978 l’entrepreneur capitaliste était désigné comme l’« ennemi de classe », en 2001 les entrepreneurs ont obtenu officiellement l’autorisation de devenir membres à part entière du Parti communiste. Certains y sont même devenus des cadres importants.
On ne peut pas comprendre le succès de la Chine aujourd’hui sans analyser d’abord le mode opératoire très complexe, mais extrêmement efficace, de son immense secteur public. C’est ce secteur public qui lui permet de gouverner de façon étonnamment ordonnée une nation de 1,3 milliard d’habitants dont l’économie a crû à un rythme de 10 % par an.
Le secteur public chinois, qui représente encore aujourd’hui à peu près la moitié du PIB du pays, est organisé autour de dizaines de milliers d’entreprises d’État1 réparties sur l’ensemble du territoire et qui dépendent d’autorités centrales, régionales ou locales. En 2003, le Conseil des affaires de l’État de la République populaire2 – organe exécutif suprême du pays – entérina la création des SASAC (State-owned Assets Aupervision and Administration Commission of the State Council), qui jouent le rôle de holdings détenant les actions des entreprises autrefois directement détenues par l’État.
Les cent vingt et une plus grandes entreprises d’État sont sous la tutelle directe de la SASAC centrale tandis que les autres sont sous la tutelle de SASAC régionales ou locales. La SASAC centrale et le Parti communiste gardent la haute main sur l’ensemble du système à travers leur pouvoir de nomination, de promotion ou de mutation aux postes de dirigeants et cadres des principales entreprises d’État. Aux côtés des SASAC, le Département d’organisation centrale du Parti communiste3 joue le rôle d’un gigantesque département des ressources humaines qui détermine la trajectoire professionnelle des principaux dirigeants, tant au sein de la galaxie des entreprises d’État que du Parti. Mais ce qui étonne dans le contexte d’un système dominé par le Parti communiste, c’est que ces dirigeants sont maintenant promus et récompensés financièrement en fonction de la profitabilité des entreprises dont ils ont la charge. Avec un salaire moyen de 88 0004 dollars, ces patrons de sociétés réalisant des chiffres d’affaires de plusieurs dizaines de milliards de dollars gagnent toujours moins qu’un analyste débutant dans une banque d’affaires anglo-saxonne, mais ils n’en sont pas moins devenus au fil des années de redoutables managers. S’ils réussissent, ils ont la perspective de poursuivre leur progression au sein de la sphère publique, mais ils ont aussi la possibilité d’emprunter les multiples passerelles qui existent avec les entreprises privées. Ceux qui choisissent la seconde voie peuvent évidemment espérer bâtir de véritables fortunes.
L’efficacité de l’économie publique chinoise tient à son exceptionnelle capillarité. Les entreprises d’État centrales ont toutes créé des « groupes d’affaires5 » enregistrés officiellement comme tels auprès des autorités et incluant quelques composantes clés. Au cœur du groupe se trouve bien sûr l’entreprise d’État elle-même, contrôlée directement par la SASAC. Elle détient souvent des participations majoritaires dans une ou plusieurs sociétés cotées en Chine ou à l’étranger. Ces sociétés cotées constituent le visage public du groupe, mais on oublie souvent qu’elles n’en sont que ...