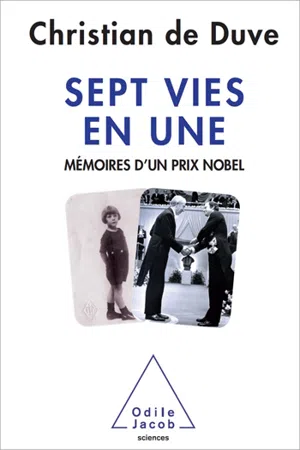Mon kot, un choix déterminant
Comme il seyait pour un membre de ma famille, je m’étais inscrit à l’Université catholique de Louvain. Pour subvenir à mes frais d’études, j’avais obtenu sans peine deux bourses, l’une de la Fondation universitaire, l’autre, remboursable, de la Ligue des familles nombreuses. Entré dans les mœurs aujourd’hui, cet appui extérieur qui aurait dû faire ma fierté était pour moi une gêne que je m’efforçais de cacher, car il trahissait l’échec professionnel de mon père. À cette époque, il était de règle pour un étudiant de vivre aux crochets de ses parents. Reconnaître que ceux-ci n’en avaient pas les moyens était embarrassant. La tradition pour les étudiants de tous milieux de subvenir à une partie de leurs besoins par des jobs n’existait pas encore. Les bourgeois que nous étions se seraient sentis déshonorés.
L’université de ma jeunesse était une institution vénérable, vieille de plus de cinq siècles, située dans une petite ville flamande dont chaque pierre rappelait, malgré les lourds dégâts infligés par la Première Guerre mondiale, le passé glorieux de l’institution qui en était le cœur et le cerveau. De mon temps, la plupart des étudiants dont les familles n’habitaient pas Louvain ou ses environs immédiats kotaient en ville (kot veut dire « cagibi » en flamand). Du moins en semaine, car, à l’exception des étudiants étrangers, tout le monde rentrait dans sa famille les week-ends.
C’est ainsi que, guidé par mon père, qui en avait fait l’expérience trente-cinq ans plus tôt, j’avais parcouru la ville un jour d’été 1934 à la recherche d’un kot convenable. Le hasard a fait que notre choix, influencé par la disponibilité d’une salle de bains (sur demande et moyennant finances), luxe rarissime pour l’époque dans une maison ouvrière, s’est arrêté sur un petit appartement (un « quartier » dans le jargon local) dans une maison sise au 69 de la Brabançonnestraat, en face de l’Institut de physiologie de l’université, qui occupait, au coin de cette rue, le 6 de la Dekenstraat (rue des Doyens). De mon bureau, je pouvais contempler les murs de cette imposante bâtisse. Sans le savoir, je venais de prendre une décision qui devait avoir une influence déterminante sur mon avenir.
L’hébergement des étudiants était une des principales industries de la ville universitaire, le moyen pour beaucoup d’habitants de se payer le luxe d’être propriétaires. Les bazins (« patronnes » en flamand) étaient des personnages redoutables. Beaucoup, soudoyées par l’université, surveillaient les fréquentations de « leurs » étudiants, interdisant rigoureusement, sous peine d’être mises à l’index, toute visite féminine. (Les étudiantes ne pouvaient pas koter et étaient obligatoirement consignées dans des maisons, appelées « pédagogies », tenues par des religieuses). Restaient les « bazinettes », sources de tentations qui n’étaient pas toujours découragées, car voir leur fille épouser un étudiant était l’ambition de beaucoup de mères louvanistes. En période d’examens, les bazins souffraient autant que leur pensionnaire. Si ce dernier réussissait, elles arboraient fièrement le drapeau. Si leur façade restait nue, elles se sentaient déconsidérées dans tout leur quartier.
Contrairement à mes craintes, je me suis adapté sans peine à mes nouvelles matières et leur ai même trouvé un certain intérêt. La biologie et la chimie, notamment, m’ont ouvert de nouveaux horizons. Mais je restais rétif à la physique, dont je n’arrivais pas à concilier les aspects abstraits et concrets. L’électricité et l’optique, en particulier, étaient mes bêtes noires. Le problème était en grande partie d’ordre didactique. Le professeur de physique était trop éminent pour ses élèves et manquait de l’imagination nécessaire pour se mettre à leur niveau. Plus tard, un maître mieux doué pour l’enseignement m’a fait apprécier l’élégance des équations et des modèles qui rendent compte quantitativement du déroulement des phénomènes naturels. Malgré ces difficultés, ma méthode d’étude habituelle m’a mené sans trop d’effort à une « grande distinction », ce qui ne manqua pas de surprendre beaucoup de mes camarades de cours qui ne me connaissaient pas comme ce que nous appelions dans notre jargon estudiantin un « manche-à-balles », terme de dérision qui désignait les étudiants excessivement zélés. Encore plus étonnée fut ma bazin lorsque je lui dis qu’elle pouvait sortir son drapeau. Ma désinvolture n’avait pas manqué de lui inspirer de sérieuses inquiétudes.
Pour beaucoup d’étudiants, le brusque passage du strict encadrement familial et scolaire à l’indépendance presque totale était une épreuve périlleuse, dont ils ne sortaient pas toujours indemnes. Habitué très jeune à l’autonomie, je n’ai pas eu ce problème. Mais je souffrais d’avoir trop de temps libre. Les cours théoriques, qui n’occupaient qu’une douzaine d’heures par semaine, remplissaient à peine les matinées, auxquelles s’ajoutaient les rares après-midi consacrées à des travaux pratiques. Pour le reste, on étudiait et mettait à jour ses notes de cours, on essayait de tirer parti des conférences et autres manifestations culturelles offertes par l’université et, s’il restait du temps, ce qui était mon cas, on cherchait à se distraire. N’étant pas attiré par les beuveries bruyantes traditionnellement associées à la Studentenleben, j’ai trouvé un autre dérivatif, qui a manqué causer ma perte : le jeu. C’était avant tout le bridge, jeu de cartes subtil qui me ravissait par ses problématiques toujours renouvelées et dont j’ai gardé le goût jusqu’à ce jour. Mais ce furent aussi des jeux plus dangereux, tels le poker et un jeu de hasard pur qui s’appelait la « banque russe ». Comme je perdais plus souvent que je ne gagnais et que mes ressources étaient strictement limitées, je me suis trouvé une ou deux fois dans des situations assez scabreuses, dont je ne sortis qu’avec l’aide de quelques fidèles amis.
Heureusement pour moi, ma deuxième année d’université a vu un événement qui allait transformer mon existence. Il était d’usage, à la faculté de médecine, que les « bons » étudiants entrassent comme apprentis bénévoles dans un laboratoire de recherche. C’est ce que l’on appelait « faire du laboratoire ». Pour les professeurs, cette main-d’œuvre gratuite était un appoint précieux, car les crédits de recherche étaient pratiquement inexistants. Quant aux étudiants, ils y trouvaient leur compte en s’initiant à la recherche scientifique et en participant à des travaux auxquels leur nom était associé. Parfois, avec l’aide du professeur, ils rédigeaient une thèse qui leur permettait de concourir pour l’octroi d’une bourse de voyage. Quelques rares privilégiés allaient encore plus loin et continuaient jusqu’à l’obtention du diplôme d’agrégé de l’enseignement supérieur, la porte d’entrée à une carrière académique.
J’ai été introduit à cette tradition par des amis anversois, plus âgés que moi, que j’avais connus par le scoutisme. L’un d’entre eux travaillait dans le laboratoire de physiologie, situé, comme on l’a vu, en face de mon kot. N’ayant pas de préférence particulière, je me suis présenté avec la recommandation de mon ami auprès du directeur de ce laboratoire, plus pour des raisons de facilité personnelle que par véritable intérêt pour la physiologie. Un pur hasard m’a ainsi introduit, sans que je m’en rende compte, dans le meilleur laboratoire de recherche de la faculté, le seul, à peu de chose près, qui pouvait se targuer d’un certain rayonnement international. Son directeur, le professeur Joseph Prosper Bouckaert, était un personnage remarquable. Pour expliquer tout ce que j’ai gagné à travailler sous sa tutelle, je dois rappeler ce qu’était l’Université catholique de Louvain à l’époque où je la fréquentais. Le tableau en est tellement différent de ce que l’on connaît à présent que son existence, il n’y a pas quatre-vingts ans, est presque inimaginable.
En bref, Louvain, comme on appelait familièrement l’université, était un bastion de la bourgeoisie catholique conservatrice francophone, assailli, mais encore peu entamé, par les deux courants qui allaient devenir prépondérants dans les décennies qui suivirent : la démocratie chrétienne et le mouvement flamand. Ce dernier avait déjà conquis le dédoublement linguistique de la majorité des cours ; mais la langue véhiculaire des facultés bilingues restait le français. L’université était dirigée par des ecclésiastiques et entièrement inféodée à l’Église, encore que ses facultés de théologie et de philosophie eussent la réputation d’être plutôt frondeuses à l’égard de Rome.
On était encore en pleine guerre scolaire, et l’Université catholique, pas plus que les écoles confessionnelles, ne recevait un subside quelconque de l’État. C’était le cas aussi de l’Université libre de Bruxelles, fondée en 1834 avec l’aide de la franc-maçonnerie libérale en vue de défendre la libre-pensée contre le dogmatisme religieux de Louvain. Profondément divisées par leurs différences idéologiques, les deux universités libres n’avaient pas encore uni leurs forces, comme elles le firent plus tard, pour réclamer de l’État une aide comparable à celle que ce dernier accordait aux universités officielles de Liège et de Gand. Chacune cherchait dans les milieux privés les moyens de subsister. Pour Louvain, le budget était assuré en majeure partie par des collectes qui se faisaient deux fois par an dans toutes les églises du pays, avec la collaboration tiède des curés, qui auraient préféré voir cet argent alimenter les caisses de leurs paroisses, par les dons de riches familles bien-pensantes et par le minerval des étudiants.
Tout cela permettait à peine de payer les professeurs, dont le nombre était strictement limité, d’entretenir les bâtiments et de subvenir aux frais de fonctionnement incompressibles. Les salaires des professeurs étaient d’ailleurs plus symboliques que réels. Il était même de bon ton de les restituer à l’université. À cette époque, la charge de professeur d’université était avant tout honorifique, comme l’étaient celles de magistrat ou de diplomate. On pouvait y accéder si l’on disposait de revenus personnels suffisants ou si l’on exerçait une activité lucrative à côté. Dans ce dernier cas, le professorat était un titre envié qui donnait droit à des honoraires plantureux. Ainsi, à la faculté de médecine, les professeurs cliniciens menaient grand train. Il en était de même, dans d’autres facultés, de juristes qui dirigeaient de riches cabinets d’avocat ou de certains ingénieurs et scientifiques travaillant au service de grosses industries. Les rares professeurs, tel mon maître Bouckaert, qui ne disposaient pas de tels avantages – et qui n’étaient pas ecclésiastiques, astreints, par définition, à la frugalité –, augmentaient leurs rentrées en assumant de lourdes charges de cours. Chaque heure au-dessus du minimum de six heures par semaine donnait droit à un supplément de traitement, auquel s’ajoutaient les indemnités d’examens, comptées au nombre d’étudiants interrogés. Une autre source de revenus était la vente aux étudiants de syllabus rédigés par le professeur.
On comprend que, dans ces conditions, la recherche scientifique ne fût pas très développée à l’université. Une exception était le laboratoire de physiologie, dont le professeur Bouckaert avait réussi à faire un centre florissant, malgré des charges écrasantes. Titulaire de tous les cours de physiologie dans les deux langues, il avait pu s’entourer d’un petit staff qui l’assistait dans l’enseignement et participait également à la recherche. S’y ajoutait occasionnellement l’un ou l’autre chercheur payé par le Fonds national de la recherche scientifique (FNRS), créé en 1927 à l’aide de donations récoltées suite à un discours célèbre prononcé dans la ville de Seraing par le roi Albert Ier. Cet organisme subventionnait parfois aussi l’achat d’instruments, mais n’accordait pas de crédits de recherches proprement dits. J’ignore comment Bouckaert subvenait au fonctionnement de son laboratoire, mais je soupçonne que les étudiants y contribuaient sans le savoir par la redevance qu’ils payaient pour couvrir les frais des travaux pratiques. Une gestion frugale de ce budget laissait un excédent qu’il paraissait légitime d’utiliser pour la recherche.
Le professeur Bouckaert avait deux intérêts : l’énergétique musculaire, à laquelle il s’était initié dans le laboratoire londonien du célèbre physiologiste Archibald Vivian Hill, lauréat du prix Nobel de médecine 1922 ; et le métabolisme, en relation plus particulièrement avec le diabète et l’action de l’insuline, spécialité de son prédécesseur, le Néerlandais A. K. Noyons. On devait à ce dernier la construction de l’Institut de physiologie, un bâtiment remarquable où enseignement et recherche pouvaient se conjuguer dans un décor en même temps noble et fonctionnel. L’instrument de prédilection de Noyons était un calorimètre différentiel de sa conception, dont il existait plusieurs modèles de taille différente, adaptés à des sujets qui allaient de souris à des humains adultes et servant à mesurer la déperdition de chaleur des sujets dans des conditions physiques précises. En plus de ces deux domaines, on étudiait encore au laboratoire la fonction cardiaque – Bouckaert était un expert de la nouvelle technique d’électrocardiographie, dont il assurait le service pour les hôpitaux universitaires –, l’excrétion rénale d’ions, la sécrétion gastrique, l’électrophysiologie du cerveau et même la psychologie expérimentale.
Le but, dans l’esprit du patron, était d’illustrer par la recherche chacun des principaux chapitres de son cours. Trop absorbé par ses charges d’enseignement, y compris la rédaction de notes de cours, il ne participait pas personnellement aux recherches, mais il les supervisait de près. Lorsqu’un étudiant était accepté au laboratoire, il pouvait choisir le domaine où il désirait travailler et était placé sous la direction du senior correspondant. C’est ainsi que, âgé de 18 ans à peine, je me suis trouvé engagé dans une équipe dirigée par le chef de travaux de Bouckaert, le docteur Pierre-Paul De Nayer, qui étudiait l’action de l’insuline, l’hormone dont la déficience provoque le diabète.
L’insuline, mon premier amour
Bouckaert s’était intéressé à l’insuline dès la découverte de cette hormone, en 1922, par les Canadiens Frederick Banting et Charles Best, qui devait révolutionner le traitement du diabète. Cette maladie est caractérisée par une teneur élevée de glucose dans le sang (hyperglycémie), accompagnée de polyurie et de glycosurie, c’est-à-dire d’une émission excessive d’urine contenant du sucre, et menant progressivement au dépérissement et à la mort. On savait depuis longtemps que cette affection résulte du défaut d’une hormone élaborée par des îlots (insula, en latin, d’où le nom d’insuline donné à l’hormone) cellulaires présents dans le pancréas, une glande digestive, et portant le nom de leur découvreur, le pathologiste allemand Langerhans. Mais cette hormone, une protéine, avait résisté à toutes les tentatives de purification jusqu’au jour où elle a été isolée et utilisée cliniquement pour la première fois par les chercheurs canadiens.
La propriété la plus évidente de l’insuline, lorsqu’elle est fournie par injection, est de provoquer une chute du taux de glucose sanguin, ou hypoglycémie. Cet effet est salutaire chez le diabétique, mais il peut être dangereux et même mortel chez l’individu normal. Des mécanismes compensateurs, dont, en particulier, une décharge d’adrénaline, sont déclenchés chez ce dernier lorsque la glycémie tombe sous un seuil critique.
Dans ses premières recherches sur l’insuline, Bouckaert avait, contrairement à d’autres chercheurs de l’époque, décidé d’emblée de corriger la chute du taux de glucose sanguin provoquée par l’administration de l’hormone et d’éviter les réactions antagonistes à l’hypoglycémie en fournissant aux animaux insulinisés une injection intraveineuse continue de glucose, ajustée par essai et erreur de manière à maintenir la glycémie à un taux normal. La méthode était laborieuse, mais elle se rapprochait beaucoup plus des conditions dans lesquelles l’hormone agit physiologiquement. Elle avait, de plus, l’énorme avantage de permettre une mesure quantitative de l’action de l’insuline injectée aux animaux, la dose de glucose nécessaire pour maintenir la glycémie dans des limites normales (dose de compensation) correspondant, à peu de chose près, à l’excès de glucose utilisé sous l’effet de l’hormone.
Dans une première application de cette méthode, effectuée en collaboration avec De Nayer, qui venait d’entrer au laboratoire, et avec un jeune élève, R. Krekels, Bouckaert avait étudié l’influence de la quantité d’insuline injectée sur la dose de compensation. Le résultat observé se traduisait par une courbe de saturation typique, révélatrice avant la lettre de l’existence d’un récepteur saturable à l’insuline. Ce travail a permis, en outre, dans des expériences ultérieures, d’éviter les variations dues à la dose d’insuline fournie et à la sécrétion endogène d’hormone en administrant systématiquement des quantités supramaximales d’insuline aux animaux d’expérience. Cette stratégie une fois mise au point, avec une patience et une rigueur exemplaires, la voie était ouverte pour l’étude de l’influence de divers facteurs sur l’action de l’insuline. Parmi ces facteurs, le rôle du foie avait particulièrement retenu l’attention des chercheurs.
Il s’agissait d’un problème majeur qui opposait les experts depuis des décennies, selon qu’ils attribuaient l’hyperglycémie caractéristique du diabète à un défaut de l’utilisation du glucose sanguin par les muscles et les autres tissus consommateurs de ce sucre ou à un excès de sa production par le foie.
Pour comprendre ces théories, on doit se rappeler que le foie est interposé comme un filtre sur le trajet de retour du sang des viscères vers la circulation générale et joue un rôle de tampon régulateur pour amortir les fluctuations causées par le caractère discontinu des repas. Au cours des périodes de digestion, les produits de celle-ci, dont le glucose formé dans l’intestin à partir des féculents, sont absorbés dans le sang qui irrigue les viscères et transitent à travers le foie par la circulation porte avant d’atteindre les autres régions de l’organisme. À ce moment, l’apport alimentaire de glucose dépasse les besoins des tissus et l’excès est mis en réserve dans le foie, principalement sous la forme d’une substance analogue à l’amidon, appelée glycogène par son découvreur, Claude Bernard. Au cours du jeûne qui suit, cette réserve est mobilisée pour couvrir les besoins des autres tissus. La glycémie est l’agent modulateur principal de cette régulation. L’hyperglycémie qui suit l’apport alimentaire de glucose favorise le stockage hépatique de l’excès de sucre, tandis que l’hypoglycémie qui accompagne le jeûne favorise la mobilisation de cette réserve. On pouvait donc expliquer l’hyperglycémie diabétique par un défaut de l’utilisation périphérique du glucose ou par une surproduction de ce sucre par le foie, ou encore par une combinaison des deux facteurs. De même, on pouvait attribuer l’hypoglycémie insulinique à une consommation périphérique accrue du glucose sanguin ou à une inhibition de sa production pour le foie, allant peut-être jusqu’à une mise en réserve excessive, ou encore à une combinaison de ces facteurs. À l’époque dont je parle, la controverse battait son plein, avec, cependant, une majorité en faveur de la périphérie.
Bouckaert avait décidé d’attaquer le problème de front en étudiant l’influence de l’absence du foie sur la dose de compensation de quantités supramaximales de l’hormone. Ce n’était pas chose facile. Comme on vient de le voir, le foie est situé sur le trajet de retour du sang des viscères vers le cœur. Il faut donc, pour pouvoir l’extirper, ou bien enlever la totalité des viscères en même temps que le foie, ce qui est nettement plus facile mais ne permet pas de distinguer le rôle des deux tissus, ou bien détourner la circulation porte vers la veine cave avant d’extirper le foie, de manière à permettre au sang de passer directement des viscères au cœur. Il existait heureusement pour effectuer cette opération délicate une technique anticipant sur la chirurgie vasculaire d’aujourd’hui, mise au point à l’Université de Gand par son futur recteur, le professeur Jean Bouckaert, frère cadet du nôtre et collaborateur principal de Corneille Heymans dans les recherches qui valurent à ce dernier le prix Nobel de médecine 1938. Dans ce procédé, la circulation portale était détournée vers la veine cave inférieure par abouchement de la veine porte à la veine rénale gauche au moyen d’un tronçon de jugulaire. Au moment critique d’interruption de la circulation mésentérique, qui ne pouvait pas durer plus d’une ou deux minutes, trois paires de mains plongées dans le ventre largement ouvert de l’animal procédaient aussi rapidement que possible à la jonction des vaisseaux. Puis, chacun retenant son souffle, on rétablissait le passage du sang. Si tout s’était bien passé, les viscères congestionnés d’un sang devenu presque noir par perte d’oxygène reprenaient leur coloration normale. Dans le cas contraire, c’était l’hémorragie brutale et fatale.
Il se fait que ce spectacle avait rencontré mon regard au moment où je franchissais pour la première fois les portes du laboratoire pour me présenter. De Nayer, l’opération terminée, m’a tendu un coude et m’a expliqué ce qu’il venait de faire. Il ne fa...