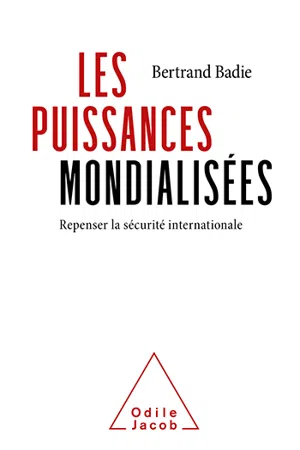En quoi les vieilles puissances persistent-elles dans leur être, dans ce monde nouveau, au prix souvent d’escamoter les défis inédits ? Une puissance qui n’est pas au goût du jour est source d’échecs, voire de drames : or comment ne pas rappeler, à ce propos, que l’idée classique de puissance a été forgée conformément au principe multiséculaire de sécurité nationale ? Le lien intime qui s’est alors institué entre la compétition interétatique et l’instrument militaire a solidement rattaché cette vertu d’antan à la capacité d’assurer la sécurité du territoire et la promotion des intérêts nationaux. Certes, de tels impératifs n’ont pas disparu, mais ils sont aujourd’hui surclassés par d’autres, plus complexes et irréductibles aux données de jadis. Voilà qui permet d’entrevoir le début du hiatus, l’incompatibilité potentielle qui risque de séparer les gladiateurs d’autrefois de la mondialisation contemporaine, et de consacrer leur inaptitude à faire durablement bon ménage ensemble. Les premiers ont pu longtemps donner le change, d’autant qu’ils ont largement participé à l’éclosion de cette grande mutation.
Aujourd’hui, de telles illusions ne résistent plus à l’analyse et guère davantage à la pratique, comme peuvent l’illustrer les embarras du trumpisme, ou même les hésitations de la nouvelle administration américaine, sans oublier l’actuelle tétanie européenne. Trois grandes césures marquent, de ce point de vue, le jeu international postbipolaire. La puissance d’autrefois appelait à une vision hiérarchique et oligarchique du monde, là où la mondialisation consacre un monde pluriel en quête de différences affichées et d’égalité revendiquée ; elle suppose une compétition infinie entre États gladiateurs, conduisant à une politique active d’intervention militaire, là où s’installe progressivement une dynamique d’autonomie locale et de régionalisation de l’espace mondial, rendant cet usage pour le moins scabreux ; elle engage à une conception « géopolitique » du monde, là où les tendances nouvelles sont au libre cours donné aux dynamiques sociales. En restant dans les vieux schémas, les grands d’hier ne gagnent plus, au moment même où les « puissances mondialisées » sont à la recherche de nouveaux équilibres qui leur permettront peut-être de transcender progressivement ces impasses.
Les pièges de la hiérarchie
La puissance classique implique évidemment la hiérarchie (Lake, 2009 ; Barnett, Duvall, 2005). Quantifiable selon des critères militaires, économiques ou technologiques, de surcroît compétitive et performative, elle est indissociable d’un classement dont les indices restent cependant incertains (Hart, 1976, p. 289 et sq), mais qui, de façon explicite ou implicite, dépeint le monde sous forme d’un palmarès permanent. Celui-ci n’a pas seulement ni principalement une vertu de spectacle, sorte de jeu olympique d’une géopolitique illusoire : il structure, envers et contre tout, les politiques étrangères et leur réputation, faisant d’un bon positionnement une fin ultime imposée à celles-ci. Instrumentale dans son essence, la puissance affirmée devient très vite un but en soi. Le normatif se construit alors dans l’affirmation de principe illustrée par la fameuse phrase du général de Gaulle : « La France ne peut être la France sans la grandeur. » La classe politique française, quasi unanime, fait sienne cette obsession du rang, sans jamais chercher à la justifier en termes éthiques ou simplement utilitaires, à l’instar d’Emmanuel Macron devant la conférence des ambassadeurs tenue en août 2019 : « Nous sommes une grande puissance économique […], nous sommes en passe de devenir la première armée européenne […], nous restons une grande puissance diplomatique » (27 août 2019). Les rares modulations restent prudentes mais périlleuses : Valéry Giscard d’Estaing – qui cherchait à sortir de l’orthodoxie gaulliste – s’y était hasardé avec retenue, décrivant la France comme « une grande puissance moyenne de rayonnement mondial ». Le qualificatif de « moyen » passa pourtant pour blasphématoire aux yeux de bien de ses compatriotes. En fait, le mystère demeure : quand d’aucuns essayent de finaliser cette puissance, de lui trouver une raison d’être, leur réponse se rapproche de la tautologie. Dans son discours d’Athènes, Emmanuel Macron garde ainsi l’idée de leadership comme finalité ultime, même au prix de la transférer telle quelle et sans aménagements à un grand ensemble régional : « La France doit permettre à l’Europe de devenir leader du monde libre » (7 septembre 2017). Mais quelles sont donc aujourd’hui, dans un monde interdépendant, la légitimité du rang et sa réelle fonction ? La logique hiérarchique reste-t-elle pertinente et fait-elle-même sens ? Faut-il encore faire mieux que le voisin ou s’agit-il, plus modestement, de faire bien dans un monde global ?
Cette posture, comme cette rhétorique, se retrouve autant parmi les puissances traditionnelles que parmi ceux des États qui aspirent à rejoindre le club ou à y revenir alors qu’ils en avaient été écartés. Dans le premier de ces cas, les États-Unis de Donald Trump tendaient à se distinguer : la fameuse formule « Make America great again » est de ce point de vue des plus significatives ; elle s’associe alors à l’idée de restauration présentée à nouveau comme fin en soi. Le nationalisme qui s’affiche au sein des pays du Sud aspirant activement à une forte visibilité internationale débouche sur cette même recherche d’absolu, traduisant en outre une aspiration ou un mimétisme de revanche. Dans ses vœux au peuple turc, le 31 décembre 2019, Recep Tayyep Erdoğan ne manque pas de proclamer : « Nous travaillons jour et nuit pour approcher davantage notre pays de l’objectif d’une Turquie grande et puissante », illustrant l’éclat de cette puissance par l’image du nouvel aéroport d’Istanbul qui venait d’être inauguré, ayant pour caractéristique d’être « l’un des plus grands du monde ». La même idée de la « puissance pour la puissance » domine par ailleurs le discours de Vladimir Poutine qui, à l’occasion du 74e anniversaire de la victoire sur le nazisme, affiche comme de coutume ses forces armées pour proclamer haut et fort : « Les leçons de la dernière guerre sont valables une fois encore. Nous avons fait et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour garantir les hautes capacités de nos forces armées ». Le général François Lecointre, alors chef d’état-major des armées françaises, souligne, à sa manière, l’importance symbolique du défilé militaire – par lequel la France se distingue chaque 14 Juillet – en des termes qui ne trompent pas : « C’est aussi la France qui, de façon assumée, montre sa puissance, la volonté de défendre ses intérêts et les causes qu’elle porte » (interview au Monde, 14-15 juillet 2020, p. 3). Et si les intérêts bien pensés passaient désormais par d’autres voies que celles de la puissance d’hier ? Où est-il montré que celle-ci peut encore tout résoudre et se révéler tout aussi utile face aux nouveaux défis globaux ? Toujours est-il que de tels propos martiaux seraient aujourd’hui inimaginables en Allemagne ou dans n’importe quel autre pays voisin de l’Hexagone. Ils évoquent aussi, en parfait contrepoint, ceux de Kofi Annan, apôtre s’il en est de la sécurité globale, qui, en recevant le prix Nobel décerné en 2001, remarquait : « La paix ne jouit d’aucun défilé, d’aucun panthéon vainqueur. »
Cette obligation hiérarchique peut paraître en soi paradoxale, puisqu’elle bouscule la base même du credo « réaliste » qui reste dominant dans les relations internationales, présentant celles-ci comme intrinsèquement anarchiques : mais c’est précisément parce que cette anarchie est source d’insécurité permanente que les États, au moins ceux qui le peuvent, font assaut de puissance dans le but obsessionnel de se protéger, voire, si la fortune se présente, de prendre l’avantage. Cette conduite hiérarchique inspire, selon le politiste américain David Lake, trois pratiques récurrentes parmi les adeptes de la puissance d’antan : produire des ordres qui prétendent servir l’intérêt de leur propre camp, sanctionner ceux qui s’en détournent, s’engager aussi à ne pas abuser de leurs propres capacités de manière à ne pas nuire au sacro-saint équilibre puissances (Lake, 2009, ch. 4). Le modèle ainsi conçu se veut des plus fonctionnels, même si la dialectique de la puissance est par nature peu compatible avec la retenue : dans une vision fidèle à Hobbes, on doit admettre que le jeu du gladiateur ne connaît spontanément aucune mesure, on doit convenir que l’ordre suit d’abord l’intérêt conçu par celui qui le produit, que la sanction est comme instinctive, jusqu’à atteindre une dimension optimale, et que la pondération cède devant la volonté permanente de démontrer ce que l’on est et de ne pas être dépassé par l’autre. C’est ici et pour cela que la puissance est en décalage, du moins dans son aménagement classique, avec les impératifs nouveaux de la sécurité globale. Deux de ses manifestations présentes et familières sont là pour le montrer : sanctions et interventions militaires perdent aujourd’hui une grande part de leur efficacité, notamment en contredisant les propriétés nouvelles de la mondialisation.
La naïveté des sanctions
L’exemple des sanctions est en effet symptomatique des aléas croissants de la vieille puissance. En avril 2020, les statistiques produites par l’Université Stanford établissaient que les États-Unis ne sanctionnaient alors pas moins de trente-deux pays, de manière globale ou ciblée. Le constat est d’autant plus remarquable que cette pratique est longtemps restée extérieure à l’histoire diplomatique américaine. Wilson fut le premier président à s’en saisir, tout en prétendant en faire une compétence exclusive de la SDN. Les États-Unis n’ayant finalement pas adhéré à celle-ci, Washington resta encore un temps en dehors de tels usages, refusant par exemple de se joindre aux sanctions internationales frappant l’Italie après l’invasion de l’Éthiopie. Le recours à cette pratique se répandit, en revanche, très vite avec la Seconde Guerre mondiale, visant d’abord le Japon, pour connaître un essor fulgurant lors de la guerre froide. Le jeu vint même à se dédoubler, la puissance états-unienne pénalisant d’un même mouvement ceux qui refusaient de faire leurs les sanctions décidées par Washington. Cette « extraterritorialité » de la sanction apparaît comme la quintessence même d’une construction hiérarchique de la puissance, l’expression absolue de la volonté de décider seul qui doit être puni par le reste du monde. Tel fut bien le principe des lois d’Amato-Kennedy puis Helms-Burton, adoptées en 1996, prétendant réprimer tout pays qui ne respecterait pas le protocole d’interdiction édicté contre la Libye et l’Iran, pour la première, et Cuba pour la seconde. Cette logique a, à son tour, trouvé une autre forme d’aboutissement, vingt-quatre ans plus tard, dans la décision américaine de punir la procureure générale auprès de la CPI, Fatou Bom Bensouda, ainsi que le directeur de la division compétente de la Cour, à la suite de l’ouverture d’une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité accomplis par l’armée états-unienne en Afghanistan, et pour crimes de guerre commis par Israël en Cisjordanie et à Gaza. Les éventuels avoirs des deux personnalités furent bloqués sur le sol des États-Unis, et celles-ci se virent interdire d’accéder au système financier américain. En faisant cette annonce, le 2 septembre 2020, le Secrétaire d’État Mike Pompeo a même élargi la perspective en annonçant que « tout individu qui continuera à assister matériellement ces individus s’exposera également à des sanctions (sic) ».
C’est dire que le jeu relève d’une spirale sans fin qui tire directement sa détermination des principes mêmes de la logique de puissance, au sens le plus classique du terme. C’est admettre aussi qu’il épouse toutes les caractéristiques de celle-ci : hiérarchie, unilatéralisme, émancipation du système institutionnel, ignorance des principes de réciprocité et d’interdépendance, visées politiques l’emportant sur les très probables conséquences sociales de l’acte de sanction, bref autant de décalages par rapport aux données du monde tel qu’il est devenu. Et pourtant, les résultats s’avèrent modiques, parfois presque inexistants, de plus en plus contre-productifs. Plusieurs études ont ainsi montré que les sanctions avaient une efficacité d’autant plus limitée qu’elles étaient coercitives et non incitatives. Le Targeted Sanctions Consortium, relevant de l’Institut des hautes études internationales de Genève, a ainsi évalué à 22 % le taux de résultats positifs des sanctions prises entre 1990 et 2013, et à seulement 10 % si elles visaient, par des mesures coercitives, un changement global du système politique affecté (Biersteker et al., 2013). Si certaines recherches font état d’un taux d’efficacité supérieur, jusqu’à 34 % (Hufbauer et al., 2007), d’autres évaluent au contraire celui-ci à seulement 6 % (Pape, 1997). À la lecture de ces écarts, on comprend bien sûr que les modes de construction statistique restent en partie incertains, tant il est difficile de s’accorder sur des critères de réussite et de vérifier si celle-ci se trouve réellement liée à la sanction elle-même. Mais quelles que soient ces différences, les analyses se rejoignent pour montrer que plus la charge coercitive est lourde, moins le résultat est probant, plus la sanction est unilatérale, moins elle est efficace, plus le changement exigé est conséquent, moins la pression a de chances d’aboutir : il n’est que de constater les échecs patents concernant les initiatives américaines punissant massivement Cuba (dès le 25 janvier 1962, suivies par tous les alliés sauf le Canada et la France), la Corée du Nord (dès 1953 et renforcées en 2005), l’Iran (initiées en 1979, renforcées en 1984, 1995, 2004, 2006, 2012, allégées entre 2014 et 2016, relancées en 2018) ou le Venezuela (mises en place en 2017 et sensiblement renforcées en août 2019). Rien de significatif ne fut obtenu de ces États « punis », malgré les crises alimentaires et sanitaires sévères qui en ont souvent résulté : à titre d’exemple, un rapport du PAM, daté de 2019, établissait que 43 % de la population nord-coréenne souffrait de malnutrition (ONU Info, 3 mai 2019)…
Or l’échec de l’arme des sanctions n’est pas accidentel : il se rattache directement à plusieurs caractéristiques propres à la mondialisation. D’abord, celle-ci favorise les possibilités de contournement, du fait de la multiplicité croissante des partenariats, notamment ceux de nature privée, insaisissables le plus souvent, surtout dans la sphère de l’armement. Les logiques d’interdépendance créent en outre des effets de ricochet parfois inattendus : les sanctions européennes décidées à l’encontre de la Russie, à partir du 17 mars 2014, ont ainsi dopé l’agriculture russe alors qu’elles privaient leurs homologues ouest-européennes d’un client avantageux. Par-dessus tout, le relâchement des modes d’alignement international et de soumission aux hégémons, combiné au poids croissant des sociétés, retourne souvent la sanction contre ceux qui la décident : celui qui en fait usage est mis en accusation par les victimes qui tendent à épargner les gouvernements frappés. Celui qui punit est dénoncé comme le responsable des souffrances endurées par les populations, il devient générateur d’un nationalisme victimaire qui le décrédibilise. Seule la sanction insérée dans une logique incitative et dans un processus actif de négociation parvient parfois à porter ses fruits : ainsi en fut-il peut-être du jeu interactif conduisant, en 2012, Barack Obama à moduler certaines sanctions frappant la junte birmane à mesure que celle-ci acceptait de libéraliser le régime en place. Mais l’effet ne dura pas !
En bref, le gladiateur n’a que peu de chance de réussir dans son rôle ancien de père fouettard, et trouve plus de chance de gagner s’il négocie d’égal à égal, en cassant ainsi la logique hiérarchique. Pire encore, la politique de sanction, surtout dans sa forme unilatérale, si valorisée dans un monde occidental qui se présente comme porteur de la vertu universelle, entretient l’image de la souffrance imposée, de l’ordre hiérarchisé et de l’arrogance affichée. Comble des effets pervers, elle contrarie directement les impératifs de la sécurité globale en créant des isolats de souffrance et de stigmatisation et en aggravant la vulnérabilité des pays touchés : l’Iran, mais aussi la Syrie, voire le Liban, ont eu à subir avec d’autant plus de violence la crise du Covid-19 que les sanctions avaient mis à mal leur système hospitalier, jusqu’à aggraver le nombre de victimes et créer, par ricochet, de nouvelles menaces pour la planète tout entière. Entre sanctions et expatriations, le Nord-Ouest syrien ne comptait plus, en 2020, que 600 soignants pour 4 millions d’habitants (UOSSM, 27 août 2020). Plus généralement, les gigantesques sanctions imposées par Washington à l’Iran, et même diffusées partout de manière forcée et hégémonique, n’ont rien rapporté à la superpuissance, sauf des entraves croissantes dont sa diplomatie eut à pâtir dans la région proche-orientale. Pour le moment, le décrochage semble total : peu importe aux puissants que la sanction échoue et soit globalement dysfonctionnelle, dès lors qu’elle entretient l’image d’un redresseur de torts tout-puissant. Pourtant, sanctionner l’autre devient de plus en plus une façon de punir tout le monde et soi-même en particulier pour ne rien gagner à la fin !
Cette même culture hiérarchique tend en outre à centraliser à l’excès tous les enjeux internationaux, censés se soumettre à la seule tutelle des États du sommet. Sa mise en pratique présente le double risque de réduire au minimum, ou à la pure forme, la délibération collective et de bloquer une régionalisation des solutions, remède souvent plus efficace et plus stable. Le premier écueil s’affiche dans la dérive oligarchique du système international qui, de P5 en G7 ou en G20, tend à ramener les choix fondamentaux à la délibération connivente, excluant précisément ceux des pays, majoritairement au Sud, qui souffrent le plus d’insécurité humaine (Hajnal, 2008 ; Badie, 2011). Le second s’exprime dans la tension sans cesse croissante opposant les puissances régionales qui s’affirment, notamment dans les lieux où les enjeux sont élevés, aux vieilles puissances rétives à abandonner leur vieux monopole : la Turquie et l’Iran que les « grands » s’efforcent de tenir à distance des grandes questions proche-orientales en sont un bon exemple, où se mêlent intérêts et émotions, construits l’un et l’autre sur un passé d’humiliation et d’exclusion. En leur temps, les premiers émergents avaient déjà eu droit au même funeste traitement (voir chapitre 8).
Le boomerang de l’intervention
Cette culture de la hiérarchie a très tôt fait de l’intervention, notamment militaire, une autre marque de la puissance classique, aujourd’hui un autre support de ses échecs, au demeurant coûteux. Le lien était direct et précoce, évoquant l’inéluctable postérité du gladiateur de Hobbes : il sera difficile à défaire. Ici aussi, l’idée de sécurité nationale a fait mécaniquement son œuvre : dès lors que se formait peu à peu un système international, celui-ci n’était acceptable, dans la conscience des acteurs dominants, que si chacun d’entre eux cherchait d’abord à garantir partout dans le monde sa propre sécurité, y compris par l’usage de la force. Le Concert européen qui prit corps dans le prolongement du congrès de Vienne affichait ainsi une rationalité préventive : il...