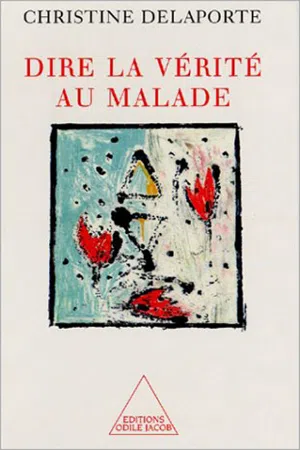Voilà, la chose est dite. Du camp des médecins, de ceux qui savent, elle a envahi celui des innocents. Quels remous profonds ne va-t-elle pas y engendrer ! Ils seront, en tout cas, dans un même registre, car il n’est pas un patient, pas un parent qui dise accepter sa maladie ou celle de son enfant. Celle-ci est, au mieux, supportée et, au pire, subie. Le refus d’intégrer la maladie est, la plupart du temps, sans rapport avec l’intensité des déficits et la gêne qu’ils procurent au patient. Cette impossibilité à reconstruire sa vie en y incluant la maladie trouve sa source dans la façon dont le diagnostic donné va être reçu. C’est en effet de la perception immédiate, des quelques secondes pendant lesquelles le nom de la maladie est communiqué, que l’orientation du vécu ultérieur de la maladie va se jouer.
La plupart des récits, qu’ils émanent des patients ou de leurs familles, montrent que le souvenir de l’annonce reste très intense, même après de longues années. Les vives traces qu’elles laissent dans leur tête semblent persister de façon indélébile. C’est ce qu’en atteste, entre autres choses, la capacité des individus à donner avec précision, même après qu’un long temps s’est écoulé, des petits détails insignifiants à propos de cette consultation. Ainsi, un malade dit qu’il garde toujours en mémoire les dessins du tapis qu’il avait sous les pieds à ce moment-là. Et cette image reste si forte que lorsqu’il regarde un tapis de même style, il se revoit instantanément dans le cabinet de consultation où sa maladie lui a été annoncée. La remémoration est d’ailleurs toujours un temps d’intense émotion pour les personnes qui ont eu à le faire. Sans même qu’elles le précisent, cela se perçoit à la forme de leur discours qui se fait confuse, le déroulement du récit devenant hésitant, émaillé de répétitions et ponctué de silences. Les larmes ne sont pas exceptionnelles, même lorsque les récits relatent des faits déjà anciens.
Il n’est pas possible de comprendre pourquoi cette minute de l’annonce, en devenant éternelle par son intensité, va provoquer un bouleversement si radical dans la vie des gens sans analyser les circonstances dans lesquelles l’annonce de leur maladie va leur être faite. Ce qu’ils vont ressentir immédiatement va certes dépendre au premier chef de la façon dont la nouvelle leur aura été dite, mais aussi du contexte psychologique dans lequel ils se seront trouvés avant de l’entendre. Leur état d’esprit au moment où ils arrivent pour cet entretien leur fera percevoir le verdict avec des nuances très contrastées.
Les circonstances qui précèdent une annonce diagnostique peuvent être schématisées comme étant de deux grands types opposés. Entre ces deux extrêmes, se trouve un éventail de situations qui résultent du panachage de celles-ci à des degrés divers. À une extrémité, elles sont brutales, faisant irruption dans la vie de la personne comme l’énorme couac d’un coup de cymbale détonnant en plein milieu d’une symphonie des plus mélodieuses. Cette soudaineté et cette brutalité peuvent faire dire qu’il n’y a pas de circonstances à proprement parler. L’annonce est un coup de poignard dans un cœur serein. À l’autre extrémité, la consultation d’annonce est au contraire précédée d’une période plus ou moins insidieuse de doutes et de craintes. La personne qui consulte le fait après que des troubles se sont accumulés peu à peu, les premiers pouvant être apparus de longues années auparavant. Dans ces cas-là, le sujet arrive à la consultation nimbé d’un climat lourd, chargé d’angoisse, parfois déjà de déni.
Parmi les annonces qui se font sans circonstances alarmantes préalables, sans prémices, celles qui se font dans la plus abrupte brutalité sont celles qui concernent une malformation décelée avant la naissance sur un examen échographique. C’est la plus aiguë des situations. La femme entre avec sa maternité triomphante dans le box de consultation et tous les rêves déjà bâtis vont s’effondrer avant qu’elle en sorte. Les parents sont ici inopinément plongés dans une situation de catastrophe. À peine moins terrible est la situation d’une personne qui a eu un traumatisme dû, par exemple, à un accident de la route. L’exemple le plus caractéristique est celui du jeune motard polytraumatisé. Des blessures cérébrales ont provoqué un coma et des lésions de la moelle épinière telles qu’il est évident que le sujet ne marchera plus. Au sortir de son coma, le blessé n’a pas conscience de ses lésions. Il va falloir très précautionneusement lui dire la vérité. La nouvelle, tellement impensable, arrivera là sur un terrain vierge de toute appréhension.
De l’appréhension, il n’y en a pas non plus lorsque la maladie est découverte au cours d’une consultation provoquée par un symptôme que le malade juge bénin ou lors d’une visite médicale de routine. Chez le petit enfant, ce peut être lors d’une consultation systématique dans un service de Protection maternelle et infantile (PMI) ou chez un pédiatre. La mère n’a rien remarqué d’inquiétant. La personne ayant une lésion traumatique de la moelle épinière est aussi un exemple assez typique du décalage qui se produit entre le peu soupçonné par le patient et l’énorme réalité entrevue par le médecin. À l’examen clinique, déjà, le médecin a de fortes présomptions diagnostiques, présomptions qui sont même bien souvent des certitudes. Elles resteront en son for intérieur, car il n’est plus pensable avec le niveau instrumentalisé de la médecine occidentale actuelle, d’affirmer un diagnostic sans l’appui d’examens complémentaires. Ceux-ci, biologiques ou radiologiques, auxquels pourront s’adjoindre des épreuves fonctionnelles, viendront toujours étayer les suspicions. Le médecin n’annonce rien, mais des indices de toutes natures indiquent au malade que la légèreté n’est plus de mise. Se crée alors un microclimat d’anxiété. Très vite, et même bien souvent avant d’avoir quitté le médecin, l’individu bascule de la plus légère insouciance à la plus sombre et la plus pesante des angoisses. Les délais nécessaires à l’obtention des examens complémentaires la faisant s’accroître très rapidement, il est impératif, par conséquent, de chercher à les écourter au maximum.
Lorsque, de toute évidence, l’individu qui vient consulter n’a pas le moindre soupçon, il est important d’avoir à l’esprit l’état de candeur dans lequel il se trouve pour éviter de faire une annonce brutale, sans ménagement. Il faudra bien le donner, ce diagnostic. Mais comme l’effondrement qu’il va provoquer est des plus prévisibles, il ne sera à dire que lorsque le diagnostic sera tout à fait certain. Ces cas où la maladie fait irruption, sans la préparation qu’auraient permise des signes prémonitoires plus ou moins alarmants, sont ceux qui justifient pleinement une annonce progressive, en plusieurs temps.
Sont tout à fait opposées les circonstances d’annonces qui concernent les maladies progressant lentement et très insidieusement. Durant des mois et, parfois, durant des années, des signes, d’abord minimes et si peu remarquables que la personne n’y prête qu’une attention fugace, vont se faire plus intenses et aussi plus nombreux. Le diagnostic de telles affections sera donné dans un tout autre climat que celui qui prévaut dans les situations précédentes. Le malade arrive avec la tête remplie certes d’interrogations, mais aussi d’hypothèses et de présomptions, voire de quelques certitudes. Celles-ci, il les a trouvées parfois en lui-même, ou encore dans son entourage quand ce n’est pas auprès de médecins. En effet, la consultation où il apprend le nom de sa maladie a souvent été précédée d’un certain nombre de visites à différents praticiens.
Présentées de la sorte, les dispositions d’esprit du patient au moment où il va apprendre son diagnostic semblent des plus contrastées. Pour être réelles, elles n’en paraissent pas moins caricaturales si l’on n’a pas à l’esprit que, dans la pratique, l’attitude, différente pour chaque individu, réalise toute une palette de nuances. En fait, les tableaux sont entremêlés.
Lorsqu’ils parlent de ce moment cruel de leur vie, il est très fréquent d’entendre des malades se dire sidérés à l’écoute du diagnostic qui leur a été donné. Lorsqu’ils n’avaient pas eu, ou si peu, de signes d’alarme, cela est compréhensible. Mais cela l’est moins s’ils se plaignaient depuis longtemps de troubles qui allaient en se majorant. Ces personnes, dans le récit qu’elles font de la consultation passée, tiennent souvent, avant toute autre chose, à préciser qu’elles n’ont pas consulté d’elles-mêmes, mais sous la pression d’un de leurs proches. Dans ces cas-là, le malade se présente donc comme un malade malgré lui. La façon dont il décrit sa consultation d’annonce peut être vue comme le résultat d’une construction psychique élaborée chez lui dans le but de refuser une réalité qui lui est insupportable. Avant même que l’entrée dans la maladie ne soit déclarée officiellement, ouverture solennellement faite par sa nomination, le déni à son égard est là. Quand le nom est lâché, seront prêts tous les ingrédients qui permettront de vite élever un mur de défenses pour refuser l’insupportable.
Il est remarquable que la personne proche, désignée par le malade comme « responsable » de ce qu’il lui est advenu, soit souvent une femme. Ce peut être la mère, ainsi que le dit une jeune malade : « Je me suis mise à boiter, mais pour moi, ce n’était rien. C’est ma mère qui s’est inquiétée et qui m’a envoyée chez le médecin » ; ou encore l’épouse, comme le fait remarquer un homme : « J’y prêtais pas attention… » mais ma femme me répétait : « Va voir un docteur. » Pour d’autres encore, c’est une amie qui a orienté vers une consultation, ainsi que le rapporte une malade : « J’avais une cliente qui était devenue une amie. Un jour elle me dit : “T’es mignonne, mais il y a certainement un problème quelque part chez toi”, et elle m’a dit qu’elle connaissait un docteur en neurologie. » Dans les récits d’une série de cent cinquante malades écoutés à propos de l’annonce de leur diagnostic, aucun homme n’aurait été l’instigateur de cette consultation inaugurale. Ceci est un argument qui conforte l’impression que, dans notre société, la santé, comme l’éducation primaire, est un domaine réservé aux femmes. Quelle étrange et sombre ironie donc, que celle qui, d’anges de la sollicitude, les transforme en démons de la désolation.
Les circonstances qui conduisent le patient à se présenter à la consultation d’annonce dans un état d’esprit des plus perturbés sont celles où cette consultation a été précédée d’une série d’autres. Leur succession qui ne s’est soldée d’aucune conclusion, d’aucun verdict, a fait croître l’angoisse liée à l’incertitude et a ouvert la porte au déni. En effet, plus la personne sent que la maladie rôde, plus elle cherche à ériger des barrières contre elle. En s’installant dans le déni, elle cherche à colmater les brèches que creuse dans son esprit chaque consultation à la conclusion incertaine. Ce déni peut être si fortement ancré qu’il n’est pas rare que le malade affirme même, lorsqu’il raconte cette période de sa vie, que la maladie était totalement ignorée de lui. Les preuves de telles attitudes sont légion. Ainsi une femme d’une quarantaine d’années, qui boitait depuis plus de dix ans et qui avait des difficultés pour soulever des objets même légers dit que sa myopathie a été « découverte tout à fait par hasard » au cours d’une consultation pour chirurgie esthétique. Le déni se manifeste encore sous la forme d’une négation massive proclamée par un jeune homme, atteint d’une maladie dégénérative hépatorénale : « Moi, cette maladie, je ne voyais pas ce que c’était ! » Or son père, atteint de cette même maladie génétique, était mort en insuffisance rénale après avoir été dialysé pendant des années.
Le temps qui s’écoule entre l’apparition des premiers signes observés par le malade et la consultation où le diagnostic est donné peut être subdivisé en deux espaces dont la charge anxieuse est très différente. Le premier est qualifié d’« intervalle libre » parce que le lien avec tout ce qui le rattacherait à la maladie : soignants, diagnostic, pronostic, etc., n’est pas encore fait. Il couvre la période qui va de la perception des premiers symptômes à la première consultation médicale. L’individu cohabite alors avec sa gêne, ses douleurs. Dans un premier temps, il les apprivoise. Mais celles-ci allant en se majorant, il se décide ou on le pousse à consulter. Là commence réellement l’angoisse. Elle ira croissant très vite, non pas linéairement mais plutôt de façon exponentielle avec le nombre de médecins consultés. Ce temps peut être qualifié de « temps de latence » parce qu’il est fait d’attente. Il devrait être des plus brefs car l’attente est « la plus horrible des tempêtes1 ». Il est donc très préjudiciable qu’il se prolonge, à la différence de l’intervalle libre. Cet espace temps pendant lequel la personne mène une vie hors maladie, il n’est pas souhaitable de chercher à le raccourcir, au moins dans les cas où il n’y a pas le moindre traitement à opposer à la progression du mal. Il en va évidemment différemment des maladies où des possibilités thérapeutiques précoces pourraient la ralentir.
Qu’il y ait eu ou non une phase prodromique et que celle-ci ait été plus ou moins longue, les patients présentent leurs récits comme celui de « cette maladie que je veux ignorer ». En arrivant à la consultation, ils pressentent évidemment très souvent leur maladie, sinon, ils ne seraient pas là. À un certain niveau de leur conscience, ils savent même ce qu’ils vont entendre, mais ils luttent de toute leur énergie pour, justement, ne pas l’entendre. La succession des médecins qu’ils ont pu consulter les a menés par paliers vers ce diagnostic. Parfois, le malade aboutit dans une consultation très spécialisée dont le nom seul leur donne à penser de quelle nature peut être leur affection : Institut Curie, Institut de myologie. Or ce temps de latence, temps de préparation, ne rendra pas le choc moins rude, bien au contraire.
À l’inverse, les patients qui connaissent rapidement ou même brutalement leur diagnostic ne mettent évidemment pas au premier plan l’intervention d’un tiers. Ils n’ont pas eu le temps de construire de telles défenses. Mais dans leurs récits anamnestiques, deux symptômes, censés avoir motivé la consultation, sont mentionnés très souvent. Il s’agit de la fatigue et de la douleur. Cela est spécialement net chez les patients interrogés peu de temps après qu’ils ont reçu leur diagnostic. Lorsqu’on leur demande d’évoquer ce qui a provoqué leur consultation, ces signes diffus, imprécis, sont mentionnés autant, voire plus, que des signes physiques plus précis tels une toux, une grosseur, un saignement, un trouble moteur. Cette prééminence de fatigue et douleurs donnés comme signes d’alarme est à interpréter comme l’expression de leur souffrance morale du moment. Ils sont le reflet de la réaction dépressive qui suit l’annonce. Celle-ci peut être si intense qu’elle nimbe tout ce qui se rapporte à cette catastrophe récemment annoncée en en masquant les autres éléments. Cette dépression n’est en général pas consciente ou, déjà refoulée, elle ne se manifeste que par des plaintes somatiques.
La révélation de la maladie provoque un choc dans tous les cas, même lorsqu’elle est attendue, car alors, elle est redoutée. Le choc est profond, massif, lame de fond qui submerge la personne qui la reçoit. C’est ce mot qui est donné tel quel par la plupart des gens : « Sur le coup, ça m’a fait un choc » ou : « Ça m’a choqué. » Tel est le commentaire immédiat que livrent patients ou parents. Le coup porté est si violent qu’il est comme physiquement ressenti ainsi qu’en témoignent ces commentaires : « C’est des coups de massue sur la tête » ; « C’est un coup de poignard. » Bien que décrit comme une blessure physique, le traumatisme est psychologique et son intensité est telle qu’il provoque un arrêt de la pensée, arrêt qui est même une véritable sidération. Le choc de la découverte de la maladie, plus exactement des mots prononcés pour lui donner un nom, a un effet destructeur et pratique une blessure qui, souvent, ne se referme plus. C’est aussi la violente intensité du choc qui fait qu’un bruit assourdissant envahit la tête de celui qui le reçoit. Ainsi, la simple audition de ce qui est dit ne rend plus perceptif aux bruits extérieurs celui à qui la nouvelle est destinée.
Le nom de la maladie est donné ; il n’est pas entendu. « Sur le coup, on n’entend plus rien, on est complètement abasourdi », explique simplement un malade. Très fréquemment, les patients, lorsqu’ils sont interrogés peu de temps après qu’ils ont reçu leur diagnostic, sont incapables de donner le nom exact de leur maladie alors même que celui-ci leur a été effectivement donné. Cette impossibilité n’est pas à mettre sur le compte d’une incompréhension sémantique car elle se rencontre quel que soit leur niveau culturel. Par exemple, en ce qui concerne la pathologie musculaire, certaines appellations retenues, telle cette pléonastique « myopathie musculaire » dont disait souffrir un malade, montrent combien les mots prononcés sont restés incompréhensibles.
L’amnésie des paroles exprimées au moment de la révélation n’est pas totale, mais lacunaire. Elle peut être comparée à un scotome qui serait ici auditif. Lacune, scotome, ces termes dépeignent bien la situation, car toute une partie de l’information sera oubliée, perdue. Mais une sorte de filtrage des paroles reçues aboutit à n’en garder que les éléments les plus dramatiques. Quant à ceux qui sont rassurants dans le discours de l’annonceur, ils ne sont pas entendus. Et quand ils le sont, comme par un effet de distorsion, ils sont interprétés dans le sens des perspectives les plus catastrophiques qu’ils voient s’ouvrir devant eux dans l’abîme que creuse cette révélation. Ainsi, un homme dit ne plus se souvenir si le médecin lui a donné le nom exact de la maladie dont il souffre. Mais il a très bien retenu que ce dernier a assorti son annonce diagnostique d’une obligation à arrêter le travail : « Il (le médecin) m’a dit tout de suite : il faudra penser à arrêter de travailler ; ça, il me l’a dit tout de suite ! » Cette phrase, présentée comme une exhortation, même comme une obligation, n’était en fait donnée qu’à titre de conseil pour l’avenir. Mais elle a été ressentie par le patient comme une sanction d’application immédiate et, traumatisante comme telle, est restée très vive dans sa mémoire. Un autre relate que le médecin lui a dit que sa maladie n’était pas mortelle, mais il ajoute immédiatement cette précision : « Enfin, pas à cent pour cent, je veux dire. » Il a donc retenu que sa maladie était presque toujours mortelle, c’est-à-dire exactement l’inverse du message qui lui était délivré, à savoir que son affection était invalidante mais qu’elle ne serait pas la cause directe de sa mort.
Le choc de la révélation place les personnes qui viennent de connaître leur diagnostic dans un désarroi dont la profondeur se décèle certes dans la teneur de leur discours mais aussi dans la forme de celui-ci qui peut prendre une allure déstructurée et incohérente. Telle cette femme, rencontrée juste après qu’elle a reçu son diagnostic qui, en un seul souffle, exprime les idées les plus contraires : « Je veux rien savoir ! Je veux rien qu’on me parle ! Je veux comprendre ! » Il est évident qu’alors, seul un silence empathique peut aider à apaiser un état aussi cataclysmique.
La révélation de la maladie est un coup d’arrêt dans la vie de la personne qui la reçoit. Coup d’arrêt réel, « objectif », car existant hors de l’esprit des patients, il est matérialisé par des changements sociaux : arrêt de travail spécialement mal ressenti car il affirme la mise sur la touche, comme l’exprimait avec amertume l’homme témoignant plus haut. Mais ce peut être aussi la déclaration de la maladie en affection professionnelle, ou la mise en congé de longue maladie. Tout ceci constituant des stigmates sociaux qui alourdissent profondément l’impact psychologique de ...