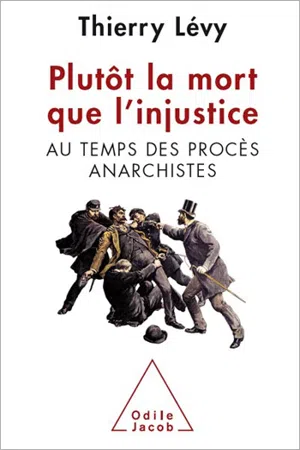La bombe a manqué sa cible mais elle a libéré l’idée qu’elle contenait. La cible, c’était la Compagnie des mines de Carmaux et son président, le baron Reille. L’idée, c’était celle de l’anarchie. L’engin a explosé le 8 novembre 1892 dans l’escalier du commissariat de la rue des Bons-Enfants alors qu’il avait été déposé dans celui d’un immeuble cossu de l’avenue de l’Opéra.
L’auteur de l’attentat devait rester longtemps inconnu mais qu’il fût anarchiste, c’est ce dont personne ne douta. C’était la sixième explosion de dynamite depuis le début de l’année, « la plus terrible de toutes », selon le quotidien Le Temps. « La formidable détonation » a eu lieu dans l’un des quartiers les plus actifs de Paris, à l’heure la plus animée, peu de temps avant celle du déjeuner. Il était exactement 11 h 40 quand un bruit de canon, « mais d’une intensité cent fois supérieure », accompagné d’un nuage aveuglant de fumée et de poussière, figea les passants sur place. L’instant d’après, on accourait de partout. Des dizaines d’agents des brigades centrales, venus de la préfecture de police, arrivaient au pas de course. Un cheval de fiacre, emballé, s’abattait contre un omnibus, une escouade de pompiers pénétrait dans l’immeuble du commissariat, vite suivie par le préfet Loze, Viguier, son chef de cabinet, Cavard, chef adjoint, Bauer, chef du premier bureau, arrivés à pied, tous ayant refusé d’attendre la voiture qu’on avait fait atteler. MM. Girard, directeur du laboratoire central, et Vielle, directeur des poudres et salpêtres, sont là aussi. À 14 heures, le président du Conseil, Émile Loubet et le ministre de la Justice, Ricard, sont vus dans les salons de la Compagnie de Carmaux par un collaborateur du Temps. Ces messieurs confèrent avec le baron Reille dont les ouvriers sont en grève. Le chef du gouvernement ne s’y est pas trompé. Il y a un lien entre l’attentat et le baron. Les lettres le prouvent, celles qu’il a reçues à son domicile de l’avenue de La Tour-Maubourg. Elles étaient nombreuses, toutes lourdes de menaces. Qu’en a-t-il fait ? C’est Athalain, le juge d’instruction chargé de l’affaire, convoqué lui aussi avenue de l’Opéra, qui pose la question. La réponse surprend. Reille en personne les a portées à la Préfecture de police. Pourquoi n’a-t-on pas surveillé l’immeuble où siège la société des mines alors que le domicile du baron était gardé ? Les menaces, expliquera-t-on, étaient personnellement dirigées contre lui et contre les siens.
À Carmaux, où les attroupements ainsi que le drapeau rouge sont interdits, les mineurs, réunis en assemblée générale par le comité de grève le 9 novembre, le lendemain de l’explosion, ont voté un « ordre du jour » : « Ne voulant pas être dupes des tentatives qui ne peuvent servir que le capitalisme et la réaction, ils répudient hautement l’explosion de Paris et déclarent qu’elle n’a aucune corrélation avec la grève. Ils se proclament socialistes révolutionnaires, et à ce titre affirment que l’émancipation ouvrière sera l’œuvre non de la dynamite, mais de l’effort commun du prolétariat. » Les locataires de l’immeuble visé se sont eux aussi réunis. Avocats, médecins, modistes, ils ont approuvé une pétition demandant à la société des mines de déguerpir et au baron Reille de ne plus mettre les pieds au 11, avenue de l’Opéra.
La jeune et jolie Mme Garin n’a rien demandé à personne. Son mari, Émile Garin, garçon de bureau à la Compagnie, avait été chargé par le caissier Angenard, lui-même alerté par le comptable Bellois, de prévenir le concierge, un militaire couvert de médailles et coiffé d’un bicorne, qu’un volumineux paquet encombrait l’entresol près de la porte d’entrée des bureaux. « J’ai monté immédiatement, dira ce dernier, et j’ai vu un gros paquet rond enveloppé dans un journal retenu par une ficelle. » Après avoir coupé la ficelle et déplié le journal, Simon Garnier, c’est le nom du concierge, a vu une marmite en fonte ayant la forme d’un pot-au-feu renversé. Il l’a prise à pleins bras, elle pesait 5 à 6 kilos, et l’a transportée à l’autre entrée de l’immeuble, au numéro 12 de la rue d’Argenteuil, voie menant de la rue de l’Échelle à la rue des Pyramides. Pendant ce temps, Garin allait chercher des gardiens de la paix, laissant Garnier en tête à tête avec la marmite. Une bandelette de fer en maintenait le couvercle fermé non sans laisser échapper un peu de poudre blanche. Par précaution, le concierge entoura la marmite avec une grande serviette blanche apportée par Mme Garnier. Garin revenait accompagné d’un sous-brigadier et d’un gardien de la paix. Prenant les coins de la serviette qui enveloppait l’engin, les deux agents, suivis du garçon de bureau, traversèrent l’avenue de l’Opéra, longèrent la Comédie-Française puis le Palais-Royal et prirent la rue Saint-Honoré avant de rejoindre la rue des Bons-Enfants. Ils franchirent une porte cochère donnant sur une vaste cour entourée d’un bâtiment central et de deux ailes perpendiculaires. Le commissariat, desservi par deux escaliers, se trouvait au premier étage de l’aile gauche. Ne pouvant emprunter le premier escalier réservé au commissaire, ils durent traverser la cour avant d’atteindre le second escalier à l’usage des employés et du public. Passant par un vestibule, les trois hommes venaient d’entrer dans le bureau des inspecteurs quand la bombe explosa, les tuant tous les trois. Pousset, le secrétaire du commissariat, fut tué lui aussi.
Mme Garin, vivant avec Émile, ancien domestique du baron, dans l’immeuble de l’avenue de l’Opéra, l’a vu partir et attend son retour. Ils ont un enfant, elle est enceinte du second. Auprès d’elle, sa sœur la rassure, les formalités administratives sont toujours longues, mais la jeune femme ne veut pas quitter le pied de l’escalier. Après la détonation, on lui dit que le jeune homme n’est que blessé, qu’il ne tardera pas à arriver, elle ne veut pas le croire, on lui cache quelque chose.
Trois jours plus tard, le vendredi 11 novembre, elle assistera à Notre-Dame aux obsèques de son époux dont l’initiale du nom figure à côté de celles des quatre autres tués du commissariat (un quatrième policier étant mort de ses blessures), en caractères blancs sur le fond noir des draperies couvrant la porte centrale de la cathédrale.
De chaque côté de la porte, deux trophées tricolores sont voilés de noir. À l’intérieur de l’église, des cartouches placés sur les piliers vêtus de noir de la grande nef reproduisent dans le même ordre qu’à l’entrée les initiales des patronymes des cinq hommes, le G de Garin venant en dernier.
Le conseil municipal de Paris ayant délibéré qu’il ne participerait pas à la cérémonie religieuse, le cortège civil, précédé d’un peloton de la Garde républicaine à cheval, s’est mis en marche, après la messe, depuis la Préfecture de police. Trois couronnes, faites de roses, de lilas, de chrysanthèmes et de violettes, placées sur des brancards noirs portés par des gardiens de la paix et des huissiers de l’Hôtel de Ville précèdent les membres du gouvernement, suivis des cinq corbillards défilant dans l’ordre adopté pour les initiales de la cathédrale, celui de Garin, fleuri par la société des mines, venant donc en dernier. La garde à cheval ferme le cortège.
Au cimetière Montparnasse, la parole est donnée successivement au président du Conseil, au préfet de police et au président du conseil municipal. « L’émotion que j’éprouve, commence Émile Loubet, ne me permet pas de prononcer un discours. Ce n’était point assez, poursuit-il, des crimes commis au mois d’avril dernier et de la mort de Very et d’Hamonod. Les lâches assassins que la justice recherche n’ont été arrêtés ni par l’explosion de douleur et de colère qui suivit les premiers crimes, ni par la pensée qu’ils allaient frapper des hommes inconnus et innocents et porter le deuil dans d’honorables familles contre lesquelles aucune haine ou aucun désir de vengeance ne pouvait armer leur bras.
Le cœur humain se refuse à concevoir de tels forfaits et la parole à en flétrir les auteurs comme ils le méritent.
Des hommes, repoussés par tous les partis, aveuglés par une haine sauvage, pensent par de tels moyens satisfaire des vengeances inavouables ou réformer la société ; comme si ces faits n’étaient pas de nature à soulever l’indignation publique contre leurs actes et la réprobation universelle contre les prétendues doctrines qu’ils veulent propager.
Non, il faut le dire bien haut, il ne s’agit pas ici d’hommes appartenant à une école politique, animés et aveuglés par le désir de porter remède à un état social dont ils croient avoir à se plaindre mais bien de vulgaires malfaiteurs, justiciables des cours d’assises.
Ce n’est pas l’amélioration de l’état social qu’ils poursuivent, c’est sa destruction.
Il ne se trouvera jamais dans aucun pays et à aucune époque un honnête homme qui puisse essayer, non de justifier, mais d’excuser de pareils forfaits.
Ceux qui le tenteraient seraient l’objet du mépris public. »
Dans ce discours, qu’Émile Loubet s’était interdit d’appeler par son nom, le président du Conseil, futur président du Sénat et président de la République, feint d’ignorer que l’anarchie est une doctrine politique professée par de parfaits honnêtes gens. Il le sait pourtant puisque le régime qu’il représente les connaît et les combat.
La Commune de Paris (février-mai 1871) n’est pas loin. Sedan non plus (2 septembre 1870). La République, quant à elle, n’a pas vingt ans. Thiers, qui fut le premier président d’une République qui n’existait pas (31 août 1871-24 mai 1873) a d’abord massacré les communards ou présumés tels (30 000 morts, 36 000 prisonniers, 10 000 condamnés) avant de libérer la France d’une occupation étrangère de deux ans et demi. L’état de siège, permettant le contrôle a priori des libertés publiques, n’a pris fin qu’en 1876. Certaines théories n’ont pas droit de cité. En particulier, celles professées par les fondateurs de la Première Internationale et du premier parti ouvrier.
La loi du 14 mars 1872 punit d’emprisonnement les membres de l’association internationale des travailleurs ou « de toute autre association professant les mêmes doctrines et ayant le même but ». Sont visés ceux qui veulent « l’abolition du droit de propriété, de la famille, de la patrie, de la religion ou du libre exercice des cultes1 ». C’est le but que se fixe une partie de la doctrine anarchiste, mais aussi la plupart des petits partis socialistes. Celui de Jules Guesde, et plus encore celui de Jean Allemane. Tous veulent la révolution, la destruction de la société bourgeoise, ils ne diffèrent que sur le choix des moyens.
Si l’assemblée élue en 1889 pouvait se réjouir d’avoir triomphé du boulangisme grâce à la « concentration républicaine » (l’union des républicains jusqu’à l’extrême gauche), elle devait affronter un autre danger, aussi puissant mais d’une certaine façon plus intime, l’affaire du Panama.
L’ébranlement provoqué par Boulanger, le « jacobin botté », avait sa cause dans la conjonction d’une revendication sociale et d’un nationalisme revanchard. Parmi les soutiens du général, on trouvait pêle-mêle deux hommes qui ne tarderaient pas à s’opposer violemment, le Lorrain patriotique Maurice Barrès et le radical Georges Clemenceau. Nommé en 1886 ministre de la Guerre à la demande de ce dernier par le républicain modéré Freycinet, le beau cavalier n’avait pas seulement peint les guérites en tricolore mais avait fait savoir, acclamé par la gauche, que l’armée n’avait pas l’intention de tirer sur les ouvriers de la mine en grève à Decazeville. S’il n’avait pas proposé de lancer un ultimatum aventureux à l’Allemagne après l’arrestation en Alsace annexée du policier lorrain Schnaebele, le gouvernement auquel il appartenait ne serait pas tombé. Son départ l’avait rendu plus populaire que jamais. Bien sûr, la Ligue des patriotes où s’illustra Paul Déroulède était derrière lui, mais aussi d’anciens directeurs de journaux révolutionnaires et antimilitaristes, Henri Rochefort et Eugène Mayer faisaient partie de son « état-major2 » où l’on rencontrait également Déroulède, Dillon, un homme d’affaires, et Thiebaut, un journaliste bonapartiste. Mis à la retraite mais éligible, Boulanger s’était fait élire à des élections partielles au printemps 1887 dans le Nord, la Somme, la Charente et la Dordogne par un concours de voies conservatrices et cléricales venues de la droite et de voix radicales et socialistes venues de la gauche. Le 27 janvier 1889 enfin, à Paris, bastion de la gauche et de la République, il avait fait un triomphe. On prononçait désormais à son sujet le mot honni depuis la chute de Napoléon III. Boulanger, disait-on, avait été plébiscité. L’homme était fragile. Accusé d’attentat contre la sûreté de l’État, cité à comparaître devant le Sénat formé en haute cour, Boulanger s’était enfui à Bruxelles le 1er avril 1889. Le 22 septembre, aux élections générales, la République parlementaire l’emportait « de justesse3 », grâce à une partie importante des voix de gauche, celles des radicaux de Clemenceau en particulier. Le jeune Barrès, élu boulangiste à Nancy, entrait au Parlement.
Le jour de l’explosion, dans les décombres gris de poussière et sales de sang de la rue des Bons-Enfants, le procureur général Quesnay de Beaurepaire, appelé lui aussi à rencontrer le baron Reille avant de s’apitoyer sur les victimes, avait toutes sortes de graves préoccupations. Les anarchistes, il les connaissait, du moins le pensait-il, puisqu’il avait requis contre Louise Michel, accusée d’avoir porté le drapeau noir en tête d’une manifestation de chômeurs des Invalides au boulevard Saint-Germain. Au passage, certains avaient pillé une boulangerie. M. Quesnay de Beaurepaire disait qu’on l’avait vue distribuer du pain. Il lui reprochait aussi d’avoir, cette même année 1883, diffusé une brochure, À l’armée, incitant les soldats révolutionnaires à mettre le feu à leur caserne4. La cour d’assises de la Seine l’avait condamnée à six ans de réclusion criminelle. En moins de dix ans, l’avocat général, devenu procureur général, avait fait du chemin puisqu’il parlait désormais d’égal à égal, ou quasiment, avec le ministre de la Justice. L’été précédent, le procureur avait fait une mauvaise lecture, celle du rapport du conseiller Prinet consacré à l’emprunt émis par la Compagnie du canal du Panama en 1888. Ce magistrat concluait que les grosses sommes d’argent sorties des caisses de la compagnie à la veille de l’émission – autorisée par le Parlement – d’obligations à lots étaient des pots-de-vin versés par les administrateurs de la société à deux intermédiaires, Cornélius Herz et le baron de Reinach, dans le but de faciliter le vote de la loi d’autorisation. Depuis le début de ce méchant et triste mois de novembre, Quesnay passait la plus grande partie de son temps à courir du palais de justice à la place Vendôme et de celle-ci à la rue du Faubourg-Saint-Honoré non sans passer par la place Beauvau. À l’Élysée, c’était le président Sadi Carnot qui le convoquait ; place Beauvau, le ministre de l’Intérieur et président du Conseil, Loubet ; place Vendôme, le garde des Sceaux Ricard et, dans son cabinet du palais, il était aux prises avec les velléités de poursuite du conseiller Prinet. Le chef de l’État lui disait que le baron de Lesseps était de bonne foi mais « ne savait pas compter », Loubet, que le procès allait découvrir des députés « ayant trafiqué de leurs votes », et Ricard, qu’il ne lui donnerait pas d’ordres formels. Cependant, le conseiller Prinet n’en démordait pas et le vendredi 4 novembre, moins de huit jours plus tôt, il avait inculpé le baron de Reinach de recel. Ce dernier, banquier, était le beau-frère de Joseph Reinach, lequel, avec son journal, La République française, était devenu une espèce de porte-parole des républicains modérés, de ceux qu’on appelait les opportunistes. Un ministre avait averti le procureur : « C’est notre vieux point de ralliement [le journal de Gambetta devenu celui de Reinach] qu’on s’est promis de noyer dans la boue. Par la blessure qu’on ouvre, le plus pur sang républicain coulera5. »
« La plaie panamiste », expression de Barrès, ramenait au premier plan la question déjà posée par l’engouement boulangiste. Qui était pour, qui était contre le Parlement ? Qu’ils fussent de droite ou de gauche, boulangistes ou radicaux, tous les contre éprouvaient de la sympathie pour la doctrine anarchiste, laquelle dénonçait le système représentatif et toutes les délégations de pouvoir issues du vote comme le pire des maux de la démocratie.
Pour beaucoup d’o...