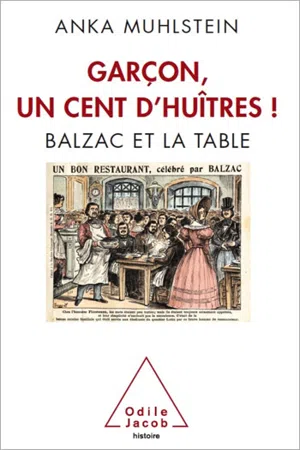
This is a test
- 224 pages
- French
- ePUB (adapté aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Détails du livre
Aperçu du livre
Table des matières
Citations
À propos de ce livre
Voici un étonnant essai de « gastronomie littéraire », mariant les plaisirs du texte et ceux de la chère. Relisant Balzac, des restaurants à la mode aux sombres estaminets, des festins mondains aux mesquineries de la petite-bourgeoisie, c'est toute la France à table au XIXe siècle qu'Anka Muhlstein nous fait redécouvrir. Et surtout, à travers toute La Comédie humaine, c'est notre imaginaire gourmand dont elle nous donne à retrouver les sources. Car c'est vraiment Balzac, avant Flaubert, Zola ou Maupassant, qui, en France, a fait entrer la table en littérature. Auteur notamment de Napoléon à Moscou, Anka Muhlstein est historienne et biographe.
Foire aux questions
Il vous suffit de vous rendre dans la section compte dans paramètres et de cliquer sur « Résilier l’abonnement ». C’est aussi simple que cela ! Une fois que vous aurez résilié votre abonnement, il restera actif pour le reste de la période pour laquelle vous avez payé. Découvrez-en plus ici.
Pour le moment, tous nos livres en format ePub adaptés aux mobiles peuvent être téléchargés via l’application. La plupart de nos PDF sont également disponibles en téléchargement et les autres seront téléchargeables très prochainement. Découvrez-en plus ici.
Les deux abonnements vous donnent un accès complet à la bibliothèque et à toutes les fonctionnalités de Perlego. Les seules différences sont les tarifs ainsi que la période d’abonnement : avec l’abonnement annuel, vous économiserez environ 30 % par rapport à 12 mois d’abonnement mensuel.
Nous sommes un service d’abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d’un seul livre par mois. Avec plus d’un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu’il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l’écouter. L’outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l’accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui, vous pouvez accéder à Garçon, un cent d'huîtres ! par Anka Muhlstein en format PDF et/ou ePUB ainsi qu’à d’autres livres populaires dans Arte et Artes culinarias. Nous disposons de plus d’un million d’ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Sujet
ArteSous-sujet
Artes culinariasV
Avares et gourmands
Il faut manger pour vivre et non point vivre pour manger : admirable axiome adopté par tous les avares de La Comédie humaine. Si Balzac s’est attaché à décrire plus particulièrement Grandet, Gobseck et, plus rapidement, Hochon, il ne s’est pas privé d’en esquisser bien d’autres. Tous partagent la même hantise de la nourriture. M. de La Baudraye reproche à sa femme, dans La Muse du département, d’offrir des brioches à ses amis ; pour évoquer la sauvage économie des Sauviat, le ménage de ferrailleurs dont la fille Véronique est l’héroïne du Curé du village, Balzac décrit le désespoir avec lequel la femme sort une pièce de son tablier pour acheter de la viande les jours de fêtes carillonnées ; la plupart du temps, elle et son mari se contentent de harengs, de pois rouges, de fromage, d’œufs durs mêlés à une salade. Leurs uniques provisions consistent en quelques bottes d’ail ou d’oignons. À ce régime, ils font fortune. La frugalité de leur futur gendre, M. Graslin, qui, lui aussi, est devenu fort riche, est si proverbiale qu’« en vingt-cinq ans, il n’avait pas offert un verre d’eau à qui que ce soit », tellement il tenait peu à se rendre aimable en société. Mais ce sont là des traits presque caricaturaux. Les portraits de Grandet, de Gobseck et de M. Hochon sont beaucoup plus fouillés et plus différenciés. La manière dont ils se nourrissent et dont ils nourrissent les autres demeure un élément essentiel de leur comportement.
Les deux premiers sont des personnages terribles, le troisième, comique. Grandet, c’est l’avarice et l’avidité qui vont jusqu’au vol, l’abandon de tout principe devant la possibilité d’acquérir la moindre richesse, la passion de l’or pour l’or. Grandet brise le pacte qui l’unit avec les vignerons de son pays, trahit son neveu, escroque sa femme et sa fille, et, sur son lit de mort, fait le geste horrible de vouloir s’emparer du crucifix en argent que le prêtre approche de lui. Gobseck, l’usurier, est aussi un homme qui voue un culte à l’or, mais Balzac a créé en lui un type très différent, tout à fait inhabituel. À l’opposé de Grandet, son passé est mystérieux et quelque peu fantastique. Il est usurier quand il apparaît dans La Comédie humaine, profession immémoriale et d’une certaine manière abstraite, alors que Grandet est ancré dans la réalité de la vie quotidienne. Grandet observe le temps qu’il fait ; un coup de froid peut déterminer un gain ou une perte pour un propriétaire campagnard, tandis que Gobseck n’a pas besoin de sortir de son fauteuil pour calculer combien les diamants qu’une femme du monde lui a confiés lui rapporteront. Ce qui est commun à ces deux hommes, c’est leur obsession, leur amour quasi physique de l’or. Cette passion les définit, tout comme l’alchimie définit Balthasar Claes, le héros de La Recherche de l’absolu, ou la luxure le baron Hulot. M. Hochon, lui, n’a pas cette envergure : on ne le voit pas accumuler son argent, mais souffrir, ô combien, à le dépenser.
M. Hochon, receveur des impôts de l’Ancien Régime, a échappé aux orages de la Révolution et vit tranquillement à Issoudun. Il a quatre-vingt-cinq ans lorsque nous faisons sa connaissance. Balzac va droit au fait et, pour le décrire, évoque d’emblée la scène au cours de laquelle sa cuisinière interrompt la lecture du contrat de mariage de sa fille pour demander à son patron de la ficelle pour trousser la dinde. Celui-ci tire de la poche de sa redingote un vieux lacet et lui dit : « Tu me le rendras. » Le personnage est campé, mais ce qui en fait le jus, c’est son attitude à table. C’est un avare qui pense tromper son monde par des ruses enfantines. À son grand dam, il se voit contraint de recevoir Agathe Bridau, la filleule de sa femme, accompagnée de son fils Joseph, un peintre sur le point de devenir un grand artiste, un artiste au goût de Balzac, très doué, très travailleur et blagueur comme on sait l’être dans les ateliers parisiens. Descendant dîner le jour de leur arrivée, Joseph aperçoit le vieux monsieur occupé à couper les tranches de pain à l’avance. On aurait mieux fait de descendre à l’auberge, se dit le jeune homme. Il n’avait pas tort.
On servit un bouillon, clair bien entendu. Manifestement, la quantité devait surseoir à la qualité. Gritte, la servante, posa ensuite tous les plats sur la table à l’ancienne. Le bouilli chez les bourgeois était généralement servi entouré de ses légumes de cuisson, et un second plat de légumes frais était proposé aux convives. M. Hochon, lui, avait résolu le problème à son avantage en servant le bouilli « triomphalement » entouré de persil, tandis que les carottes, navets et oignons du bouillon constituaient un plat à part en plus d’une salade, d’œufs durs à l’oseille et de petits pots de crème à la vanille mais où la vanille avait été remplacée par de « l’avoine brûlée qui ressemble à la vanille comme le café de chicorée ressemble au moka1 ». Le maître de maison disséqua le bouilli en tranches fines et sèches comme des semelles d’escarpin. Le bouilli n’était guère considéré par les connaisseurs, mais le plat exigeait peu de préparation et donc convenait aux ménages qui devaient se contenter d’une seule servante. Puis Gritte apporta trois pigeons. La physionomie du vieil homme laissait voir le chagrin que lui donnait cette folie, trois pigeons pour sept, folie imposée par sa femme ! Comme elle n’avait rien à dire pour le vin, M. Hochon servit à ses invités son cru de 1811, autant dire du vin imbuvable, car la récolte de cette année, celle de la comète, avait été gâtée.
Joseph Bridau était jeune et il avait faim. Lui et sa mère avaient déjeuné à 6 heures du matin d’un café exécrable. Et les portions distribuées n’avaient fait qu’aiguiser son appétit : il redemanda du pain.
M. Hochon se leva, chercha lentement une clef dans le fond de la poche de sa redingote, ouvrit une armoire derrière lui, brandit le chanteau d’un pain de douze livres, en coupa cérémonieusement une autre rouelle, la fendit en deux, la posa sur une assiette et passa l’assiette à travers la table au jeune peintre avec le silence et le sang-froid d’un vieux soldat qui se dit au commencement d’une bataille : — Allons, aujourd’hui, je puis être tué. Joseph prit la moitié de cette rouelle et comprit qu’il ne devait plus redemander de pain. Aucun membre de la famille ne s’étonna de cette scène si monstrueuse pour Joseph2.
Il y eut plus grotesque encore. Des petits fromages entourés de noix et de biscuits constituaient le dessert. Il faut préciser que les noix constituent une nourriture de pauvres chez Balzac qui se souvint toute sa vie des repas de souris, ces dîners de pain et de noisettes ou de pain et de cerises, qu’il grignotait dans sa mansarde d’étudiant. Mme Hochon, qui voulait faire honneur à ses invités, demanda des fruits. « Mais Madame, répondit Gritte, il n’y en a plus de pourris. » Joseph partit d’un grand éclat de rire en comprenant que la précaution de commencer par les fruits les plus avancés ne souffrait aucune exception et il assura la bonne vieille qu’il en mangerait quand même.
Gobseck est un type d’homme autrement redoutable. L’argent d’un usurier ne vient-il pas directement de la poche d’un autre ? Les débuts de cet homme sont aussi mystérieux que violents. Engagé par sa mère comme mousse, il a roulé pendant une vingtaine d’années dans le monde entier, et Balzac fait allusion à des événements horribles, des terreurs soudaines, des joies inespérées. Après de longues escales dans les possessions hollandaises des grandes Indes, il fait un séjour en Argentine, participe à la guerre d’indépendance américaine, entretient des relations avec les corsaires les plus fameux du temps, mais son créateur n’explique jamais pourquoi il se retrouve habitant une chambre misérable, rue de Grès (actuelle rue Cujas) dans le quartier Latin où il pratique sa profession avec une rigueur et une intelligence des risques sans pareilles. Ses clients sont des fils de famille, des femmes du monde imprudentes, des banquiers qui frôlent la faillite. Inflexible, impitoyable, il démonte toutes leurs ruses, tous leurs mensonges d’un mot et les réduit au désespoir et à l’impuissance.
Toute l’histoire de Gobseck, dans la nouvelle qui porte son nom, est contée par son voisin, un jeune avoué, qui débute dans la vie mais finira par être le grand avoué de La Comédie humaine, maître Derville, et Derville observe avec fascination ce vieillard émacié, toujours seul, refusant absolument le moindre contact avec ses uniques parentes, enfants et petits-enfants de sa sœur – comme, chez Balzac, on finit par connaître tout le monde, le lecteur apprend bientôt que la dernière conquête de Gobseck est la célèbre courtisane Esther –, se contentant du café qu’il se fait lui-même sur un réchaud de tôle, coincé dans un angle de la cheminée. C’est un personnage fantastique, dit Derville, parce qu’il sait tout. Par quel pouvoir magique cette « huître sur son rocher » peut-elle deviner les secrets d’alcôve, les faillites avant qu’elles ne se déclarent ? Gobseck économisait jusqu’à sa voix. Il ne faisait jamais le moindre bruit, contrairement à ses clients, ou plutôt ses victimes, qui « criaient beaucoup, s’emportaient ; puis après il se faisait un grand silence, comme dans une cuisine où l’on égorge un canard3 ». Il semble se nourrir d’or et de pierres précieuses. Derville l’observe un jour que la comtesse de Restaud, la fille du père Goriot, lui apporte ses diamants en gages. « Ses joues pâles s’étaient colorées, ses yeux, où les scintillements des pierres semblaient se répéter, brillaient d’un feu surnaturel. Il se leva, alla au jour, tint les diamants près de sa bouche démeublée, comme s’il eût voulu les dévorer. Il marmottait de vagues paroles, en soulevant tour à tour les bracelets, les girandoles, les colliers, les diadèmes, qu’il présentait à la lumière pour en juger l’eau, la blancheur, la taille ; il les sortait de l’écrin, les y remettait, les y reprenait encore, les faisait jouer en leur demandant tous leurs feux, plus enfant que vieillard, ou plutôt enfant et vieillard tout ensemble4. » Gobseck mange-t-il autre chose que des diamants ?
Sec, maigre, sa jambe décharnée et vigoureuse évoque celle d’un cerf, il se nourrit chez lui une fois par jour de ce que le rôtisseur du quartier lui apporte, et, deux fois par semaine, Derville l’invite à dîner où il se régale d’une aile de perdrix et d’un verre de champagne. C’est dans la démence de la vieillesse que son rapport à la nourriture se dérègle complètement. Il commence à exiger de ses débiteurs des tributs en nature. Gobseck accumule ces provisions, mais, avec l’instinct illogique de certains avares, n’en profite pas. Selon l’expression de sa portière : « Il avale tout sans que cela le rende plus gras. » Symptôme effroyable « de cet enfantillage, de cet entêtement incompréhensible auxquels arrivent tous les vieillards chez lesquels une passion forte survit à l’intelligence5 » et occasion pour Balzac, qui lui-même n’était pas ennemi de la démesure, de décrire un monceau pourrissant de mets rares et coûteux. Tel un insatiable boa – Balzac avait comparé Grandet au même serpent –, Gobseck acceptait tous les cadeaux qu’il entassait dans les chambres de la maison qu’il avait louée à cet effet. Grandet, homme logique et fidèle à sa passion de l’argent, revendait tout ce qu’il ne pouvait pas ou ne voulait pas manger, tandis que Gobseck, devenu gâteux, chicanait les marchands prêts à racheter et pendant que la discussion traînait la marchandise s’avariait. Derville est appelé par le portier lorsque Gobseck semble à l’article de la mort, et en effet celui-ci se sentant faiblir, conscient d’être « obligé de tout quitter », le nomme son exécuteur testamentaire, lui demande de rechercher sa petite héritière et lui précise même qu’elle est surnommée la Torpille et qu’elle est jolie comme un amour. Puis il lui donne un dernier ordre mystérieux : « Prends ce que tu voudras, mange : il y a des pâtés de foie gras, des balles de café, des sucres, des cuillers d’or6. » Et mettant sa main osseuse sur sa couverture, comme pour se retenir, il rendit le dernier soupir. Derville, décontenancé par ce discours de fou, saisit alors les clefs et entre dans les chambres avoisinantes Dans la première « se trouvaient des pâtés pourris, une foule de comestibles de tout genre et même des coquillages, des poissons qui avaient de la barbe et dont les diverses puanteurs faillirent [l’]asphyxier. Partout fourmillaient des vers et des insectes. Ces présents récemment faits étaient mêlés à des boîtes de toutes formes, à des caisses de thé, à des balles de café. Sur la cheminée, dans une soupière d’argent étaient des avis d’arrivage de marchandises consignées en son nom au Havre, balles de coton, boucauts de sucre, tonneaux de rhum, cafés, indigos, tabacs, tout un bazar de denrées coloniales […]. Quand je revins [rapporta Derville] dans sa chambre, je trouvai sur son bureau la raison du pêle-mêle progressif et de l’entassement de ces richesses. Il y avait sous un serre-papiers une correspondance entre Gobseck et les marchands auxquels il vendait sans doute habituellement ses présents. Or, soit que ces gens eussent été victimes de l’habileté de Gobseck, soit que Gobseck voulût un trop grand prix de ses denrées ou de ses valeurs fabriquées, chaque marché se trouvait en suspens. Il n’avait pas vendu les comestibles à Chevet, parce que Chevet ne voulait les reprendre qu’à trente pour cent de perte. […] Pour son argenterie, il refusait de payer les frais de la livraison. Pour ses cafés, il ne voulait pas garantir les déchets. Enfin chaque objet donnait lieu à des contestations7 ».
Au gâchis de la nourriture se juxtapose celui de son héritage. Gobseck meurt le jour même du suicide de la belle Esther. Sa fortune n’aura servi ni à lui ni à personne.
La sécheresse, l’aridité de l’avare sont évoquées par le refus total du plaisir de la table. Mais Gobseck vit seul et ne fait souffrir que lui, si tant est que les privations le fassent souffrir. Il n’en va pas de même pour M. Grandet, qui est un personnage social, vivant dans une maison familiale, entouré de voisins et secondé par une véritable perle, sa servante Nanon qui mérite une place d’honneur dans la galerie des cuisinières balzaciennes.
Il est servi comme un despote par les trois femmes de la maison, son épouse, sa fille et sa servante. « Lorsqu’il se couchait, chez lui tout devait dormir8 », et sa femme dormait, mangeait, buvait, marchait selon ses désirs. Il la terrifiait, et sa fille n’aurait pas osé lui adresser la parole sans y être invitée. Seule Nanon ne se décomposait pas sous son regard et avait assez d’assurance lors des séances quotidiennes au cours desquelles M. Grandet ouvrait sa dépense et lui mesurait le pain et les denrées du jour pour lui réclamer un supplément et parfois même plaisanter. C’est que Grandet avait confiance en elle et reconnaissait son intelligence. C’était son ministre, un ministre qui défendrait son bien comme un chien fidèle, un ministre qui faisait tout, se levait tôt et se couchait tard, et dont l’autorité était reconnue par sa débile de femme et sa gourde de fille. C’est Nanon, et non Mme Grandet, qui encaissait les redevances des fermi...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Copyright
- Dédicace
- Introduction
- I - Balzac à table
- II - Paris à table
- III - Les grandes occasions
- IV - En famille
- V - Avares et gourmands
- VI - Une pêche diaprée, un soufflé, une pièce montée
- Du même auteur chez Odile Jacob