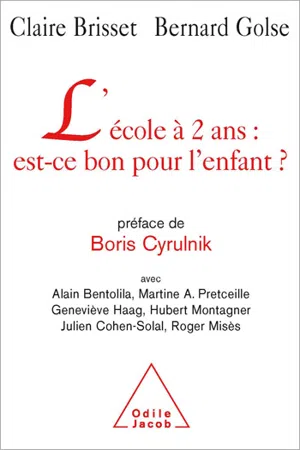Le propre de l’homme
Un nombre assez considérable de recherches a tenté, durant ces vingt dernières années, non pas seulement d’analyser les modes de communication de certaines espèces animales mais aussi de démontrer qu’il était possible de leur apprendre à communiquer avec nous et comme nous. Pour pallier leur incapacité à articuler les sons des langues humaines, on a le plus souvent utilisé la langue des signes. Ce qui anime ces recherches, c’est l’idée, devenue politiquement correcte, qu’il y aurait une sorte de continuité entre les capacités de communication humaine et celles auxquelles peuvent prétendre les espèces animales les plus évoluées. La différence entre la langue des hommes et les « langues » animales tiendrait alors à un « déficit phonatoire » qui ne permettrait pas à l’animal de réaliser nos prouesses articulatoires. Il suffirait donc de donner au singe un système de communication par signes inspiré de celui des humains sourds pour qu’ils entrent dans le cercle du verbe jusqu’ici réservé aux seuls êtres humains. Je dois, tout d’abord, avouer que l’utilisation de la langue des signes dans la plupart de ces recherches me gêne quelque peu. Créé pour permettre à l’homme sourd de communiquer avec d’autres hommes, son usage avec les singes me semble suspect. Mais, au-delà de ce transfert ambigu, qui réduit considérablement la valeur sémiologique et la puissance de communication de la langue humaine des signes, la vraie question est la suivante : « Y a-t-il ou non un écart essentiel et irréductible entre le verbe humain et les modes de communication animale aussi évolués soient-ils ? » À cette question, je répondrai sans l’ombre d’une hésitation : oui ! Aucun des résultats de toutes les recherches que j’ai analysés n’a réussi à ébranler cette conviction.
Cet écart n’est pas simplement d’ordre quantitatif ; il ne se résume pas au fait que les singes utilisent un nombre de signes moins important et des combinaisons moins complexes. Ce qui importe c’est que, quelles que soient les sollicitations auxquelles on les soumettra, quel que soit le code qu’on leur inculquera, les animaux se contenteront de communiquer le reflet le plus fidèle et le plus immédiat de la réalité qu’ils perçoivent. La communication animale, dont il n’est aucunement question de nier l’existence, se limite à transmettre ce qui est vu, entendu, senti ou désiré. Les abeilles comme les grands singes n’ont ni l’ambition ni les moyens d’évoquer un monde dont leurs sens n’attestent pas immédiatement et directement l’existence. En d’autres termes, ce que l’on appelle improprement « langage animal » n’est en fait qu’un instrument qui peut certes désigner, indiquer, avertir ou demander, mais qui en aucun cas n’a ce pouvoir propre à l’humain de créer par le verbe un monde que jamais leurs yeux n’ont vu ni ne verront : c’est certes plus qu’un geste, mais en aucun cas une langue. Le fait qu’un singe soit effectivement capable de mémoriser plusieurs centaines de signes humains de nature idéographique ou gestuelle, qu’il soit capable d’en combiner certains, n’est qu’une performance de dressage et de conditionnement. La vraie question se pose à propos de ce qu’il aura l’ambition d’en faire, c’est-à-dire des enjeux qu’il va assigner à son acte de communication. C’est sur ce point que l’écart avec l’être humain s’avère irréductible et essentiel.
Le pouvoir du verbe
Toutes les langues humaines ont la même ambition : permettre à l’homme et seulement à l’homme d’être l’interprète du monde et non d’en être le miroir fidèle. Par la parole, l’homme est du côté des créateurs et non des créatures. Le monde parlé n’est pas le monde perçu, c’est le monde transformé par le pouvoir de l’intelligence humaine ; c’est un monde que l’homme soumet au pouvoir de sa pensée ; il le crée en le disant, il n’en rend pas un compte exact.
La langue humaine donne sens à ce qui sans elle ne serait que formes. J’ai le souvenir d’une expérience que me raconta mon collègue et ami, Yves Quéré1 : la scène se passe dans une école maternelle avec une petite dizaine d’élèves de quatre ans environ. Dans le courant de la journée, toutes les heures, la maîtresse demande à Sophie de se planter au milieu de la cour et chaque fois on dessine sur le sol le contour de l’ombre de Sophie. Ainsi, à mesure que s’égrènent les heures, se succèdent les traces qui rappellent les différentes positions de l’ombre projetée. Lorsqu’ils les examinent à la fin de la journée, la plupart des enfants disent : « C’est une fleur. » Ils parlent de ses pétales ; pour les uns, il s’agit d’une « rose », pour d’autres, d’une « marguerite ». La maîtresse ne se satisfait pas de la réponse ; elle incite à la réflexion, rappelle comment l’on a obtenu ces traces successives, s’interroge sur ce qui a pu produire un tel dessin. Et une petite fille ose enfin dire avec la timidité de celle qui a eu l’audace de regarder derrière le rideau : « Maîtresse, c’est parce que ça a tourné. »
Mue par une « poussée pédagogique » donnée par une maîtresse exigeante et disponible, cette petite fille a dépassé le simple constat ; elle ne s’est pas contentée de mettre un mot sur une apparence ; elle a décidé de tenter de s’engager dans cette quête propre à l’humain de savoir pourquoi les choses sont ce qu’elles sont. Et c’est sa langue qui le lui a permis, passant du substantif : « C’est une fleur » au verbe : « Ça a tourné ». Identifier une forme en la nommant ne suffisait pas ; comprendre ce qui l’avait générée supposait que l’on passât de la simple désignation d’une forme à l’évocation du processus qui fut à l’œuvre pour la concevoir. Pour franchir ce palier décisif, il fallait mobiliser des outils linguistiques différents : abandonner le substantif (fleur) au profit du verbe (tourner). Plus tard, viendra un concept : la rotation.
La langue donne ainsi à ceux qui y sont justement et sereinement initiés un merveilleux pouvoir : celui d’aller au-delà des apparences afin de concevoir une représentation du monde éclairée par leur intelligence. Ainsi, quand Nicolas Copernic, au milieu du XVIe siècle, soutient que la Terre tourne autour du Soleil mais aussi sur elle-même, il ne décrit rien, il ne rend compte de rien de ce qu’il perçoit. Aucun instrument ne lui permet de constater les mouvements dont il affirme la réalité. Les preuves n’en furent apportées que par Kepler et Galilée ; par ce dernier notamment qui construisit une lunette d’approche qui lui permit de découvrir les phases de Vénus que Copernic avait prévues. Seul, le verbe porta et manifesta une pensée qui s’opposait à la certitude de tous ceux qui voyaient, de leurs yeux, le Soleil se déplacer au-dessus de leur tête. Pouvoir formidable du verbe humain d’imposer, contre l’évidence du « perçu », une représentation qui privilégiait l’explication audacieuse sur le simple constat !
Dans un élan d’imagination et de rigueur mêlées, la langue porte et diffuse la pensée scientifique. C’est dans le même élan qu’elle ouvre à la poésie les portes de l’imaginaire. Écoutons Paul Éluard qui nous dit que « la Terre est bleue comme une orange » et qui ajoute pour bien insister sur la puissance des mots : « Jamais une erreur, les mots ne mentent pas. » Et si les mots de la langue ne mentent pas, c’est bien parce que sa grammaire permet d’imposer aux autres une pensée singulière qui n’a d’autres limites que celles qu’elle s’impose.
Transmettre les droits et les devoirs de la communication
C’est à la fois le goût du pouvoir linguistique mais aussi la conscience des responsabilités qu’il impose qui constituent les enjeux essentiels de la transmission et de la médiation. La conquête du pouvoir du verbe de même que son juste exercice ne peuvent s’apprendre en l’absence d’un adulte disponible alliant une grande bienveillance à une forte exigence.
Le tout jeune enfant, quand il commence à faire ses premières armes linguistiques, va s’adresser à des gens qui le connaissent fort bien et qu’il connaît fort bien, pour leur dire des choses que ces gens savent déjà, ou qui sont là, offertes à leur vue. Les premières armes linguistiques se font donc dans un cercle très étroit où ceux à qui on s’adresse sont connus, et ce que l’on dit est tout aussi connu. La question qui va se poser à ce petit enfant qui va grandir est de parvenir à quitter ce cercle étroit de la connivence et de la familiarité pour donner à son langage une tout autre ambition : celle de pouvoir s’adresser à des gens qu’il ne connaît pas pour leur dire des choses que ces mêmes gens ne savent pas encore. Il s’engage donc dans une démarche où son langage va devoir porter une charge de plus en plus lourde d’inconnu et la porter de plus en plus loin. Mais pour atteindre ces rivages encore vierges, c’est-à-dire là où il va s’adresser au plus étranger parmi les étrangers pour lui dire les choses les plus étranges possibles, il lui faudra des moyens linguistiques de plus en plus puissants. Comme disait Gilles Deleuze, il faut « pousser la langue jusqu’à ce qu’elle bégaie », c’est-à-dire la pousser jusqu’à ses derniers retranchements ; c’est en effet à ce moment-là que l’on fait honneur à la langue, qu’on la place au niveau où elle doit être. Pour atteindre cette fonction du langage, qui est celle de la distance et du défi à l’inconnu, il faut bénéficier de l’apport à la fois très bienveillant et très exigeant d’adultes qui, de proche en proche, vont offrir cette phrase toute simple et tellement essentielle : « Je ne t’ai pas compris, mais je veux te comprendre. »
« Je ne t’ai pas compris », dira la mère ou le père. Cela veut dire : « Il m’importe de te comprendre. » Cela veut dire aussi : « Je ne suis pas toi. » Cela signifie : « Aussi proche que je sois de toi, tu sais des choses que je ne sais pas » ; et la langue est justement faite pour apporter à l’autre ces choses qu’il ne sait pas. C’est cette question essentielle qui est en œuvre tout au long de l’apprentissage du langage. C’est cette question essentielle qui va permettre à l’enfant de gagner un peu de pouvoir à travers l’usage de la langue.
Je vais prendre l’exemple de la petite Tiphaine (trois ans à peine) qui propose à sa mère de lui raconter une histoire. La petite raconte son histoire :
« Voilà, ils l’ont prise, ils l’ont emmenée et ils l’ont enfermée là-bas. Heureusement, les autres l’ont vue et sont venus la délivrer, et, enfin, il l’a épousée. »
La mère prend la décision de lui dire : « Ma petite Tiphaine, je n’ai pas compris grand-chose à ton histoire » ; et la petite en conçoit de l’irritation. Car les enfants n’aiment pas qu’on leur dise qu’on ne les comprend pas. Ils ont toujours l’impression que leur mère sait ce qu’ils savent, et que si elle ne les comprend pas c’est parce qu’elle y met de la mauvaise volonté. Passé cette irritation, la maman lui explique : « Je ne t’ai pas comprise parce que je n’étais pas là quand l’histoire t’a été racontée. Alors je ne sais pas qui sont ceux qui l’ont enlevée, où ils l’ont emmenée, et qui l’a épousée. » Tiphaine, petit à petit, lui explique que c’étaient les méchants lutins et le dragon qui avaient enlevé la princesse, qu’ils l’avaient enfermée dans une caverne, que le roi et le prince l’avaient délivrée, et qu’enfin le prince l’avait épousée.
Dans la soirée, lorsque son père va rentrer (on peut bien sûr intervertir les rôles), Tiphaine va lui raconter son histoire. Elle aura l’immense satisfaction de constater que son père ne lui dira pas : « Je ne t’ai pas comprise. » Elle se rend ainsi compte que les efforts qu’elle avait produits pour utiliser les formes anaphoriques judicieuses, des déictiques pertinents n’avaient pas seulement pour but de faire plaisir à sa mère ; cela lui permettait de laisser sur l’autre une trace qu’elle n’aurait pas laissée autrement et qui n’appartient qu’à elle. Elle a exercé sur son père son pouvoir de parole : il est arrivé ignorant, elle l’a rendu savant ; c’était certes un savoir modeste, mais sa juste transmission justifiait les efforts fournis.
Il faut qu’un adulte aide l’enfant à comprendre qu’adresser un message à quelqu’un ne se résume pas à l’inviter à regarder un spectacle qui se trouve dans sa propre tête. Il faut lui montrer que communiquer exige que l’on maîtrise le débit d’une source d’informations qui doit s’adapter à une situation spécifique et à un partenaire singulier sur lequel on exerce certes un pouvoir mais envers lequel on a des devoirs.
Lorsque l’on parle d’une « langue maternelle », on signifie non seulement qu’il s’agit d’une langue parlée par sa mère mais bien plus encore d’une langue apprise de sa mère. « Passer la parole » à son enfant, c’est lui faire comprendre que l’on prend avec lui les distances indispensables à l’apprentissage de la communication ; c’est imposer une séparation des intelligences et reconnaître la singularité de chacune d’elles. Mais c’est aussi lui dire que cet écart intellectuel nécessaire ne met pas en cause l’amour qu’on lui porte, bien au contraire ! Passer la parole à son enfant consiste à lui montrer qu’il sait déjà des choses que sa mère ignore et qu’elle serait heureuse de savoir. Lorsqu’une mère transmet à son enfant les armes du pouvoir linguistique, elle lui montre l’ambition qu’elle a pour lui. Elle l’invite à exercer ce pouvoir d’abord sur elle, mettant ainsi entre eux une distance propice au tissage de liens plus solides et plus explicites.
Y a-t-il une urgence scolaire ?
Il y a peu de temps, la maman d’un bébé d’une quinzaine de mois m’interrogea dans les termes suivants : « J’ai lu récemment un livre d’un auteur américain qui disait que les enfants surdoués apprenaient à lire très tôt ; dès deux ans, et certains avant. » Elle poursuivit, levant vers moi des yeux pleins d’espoir : « Est-ce que vous pensez qu’il faudrait que je commence à apprendre les lettres à Julie… juste comme ça, pour voir. » Cette maman, par ailleurs aimante et attentive, encouragée par des articles et des livres sans aucun fondement scientifique, avait fait le raisonnement suivant : « Puisque les surdoués apprennent à lire plus tôt que les autres, si j’apprends à lire très tôt à mon enfant, peut-être en révélerai-je ainsi la précocité intellectuelle que je soupçonne et espère. »
Aujourd’hui, le temps est à l’impatience ; aussitôt nés, il faut cultiver activement leurs jeunes intelligences, développer énergiquement leurs capacités logiques et attiser leurs appétits artistiques. Très tôt, il faut les précipiter dans des activités éducatives et culturelles afin de multiplier leurs chances de réussite et parfois pour se dédouaner de ne pas leur consacrer toute l’attention et la disponibilité auxquelles ils ont droit. Impatience éducative et déficit de la médiation familiale sont sans doute à l’origine de la scolarisation de plus en plus précoce des enfants.
Une des mutations les plus importantes de notre société tient au fait que les familles sont amenées à confier beaucoup plus tôt qu’auparavant leurs enfants à d’autres. Il ne s’agit pas de le déplorer ; il est vain de regretter avec nostalgie l’heureux temps où tous les petits enfants bénéficiaient plus longtemps de la chaleur du foyer familial. La seule question qui mérite d’être posée est la suivante : comment assurer, à un moment crucial du développement d’un enfant, une qualité d’accueil et d’accompagnement qui lui donne les meilleures chances d’épanouissement ?
Parlons clair ! La conquête par les femmes des postes de responsabilités au plan professionnel, associatif et politique est sans aucun doute la meilleure chose qui pouvait arriver à notre société tout entière. Encore faut-il que cette émancipation soit accompagnée de mesures sociales telles qu’une mère ne soit pas déchirée entre des obligations professionnelles exigeantes et sa volonté de donner à son enfant le temps d’affection, d’écoute et de compréhension qu’elle sait indispensable. Nous, pères, maris ou compagnons, n’avons pas voulu ou su compenser la juste prise de responsabilités de nos compagnes ; dans la plupart des cas, nous n’avons rien ou très peu changé à nos ambitions professionnelles et à nos habitudes de vie. Et, pour couronner le tout, les grands-parents, en bien meilleure forme qu’auparavant et beaucoup plus sollicités, sont moins disponibles et ne peuvent apporter à leurs petits-enfants cette présence rassurante et apaisante de la « génération d’avant ». À ce propos, j’ai la conviction que l’accélération de l’obsolescence des mots aujourd’hui est certainement due au fait que les grands-parents ont, moins qu’auparavant, l’occasion de passer leurs mots plus anciens à leurs petits-enfants.
En bref, nous vivons une époque où la médiation familiale, pour les meilleures raisons du monde, s’affaiblit au moment où justement l’enfant en a le plus besoin. La question qui se pose alors est : Qui prend le relais ? Ou, en d’autres termes, que fait-on des enfants de deux ans ?
Avant de vous dire ma façon de penser sur l’accueil des enfants de deux ans à l’école, je voudrais dire combien il m’apparaît injuste et scandaleux qu’une femme ne puisse pas conjuguer avec sérénité son travail et son rôle de mère. Au lieu d’avoir octroyé à tous les Français des loisirs supplémentaires à travers la loi limitant le temps de travail à 35 heures, j’aurais aimé que l’on fasse un effort significatif pour permettre aux mères (ou aux pères d’ailleurs) de jeunes enfants de partager leur temps entre leur profession et l’éducation de leurs petits, et ce, avec l’assurance totale que ce partage ne nuirait en rien à l’avancement de leur carrière. On ne peut pas condamner un enfant de deux ans à ne voir sa mère qu’une heure à peine par jour pendant la semaine ; on ne peut pas condamner une mère à laisser toute la journée son enfant à des gens qui n’auront que peu de temps à lui consacrer. Il est bien beau de parler de parité, mais si cette juste cause n’est pas portée par des mesures qui garantissent aux femmes un équilibre serein entre maternité et responsabilité professionnelle, elle restera un simple mot d’ordre et cachera mal une très profonde injustice.
Lorsque l’école a décidé de « laisser venir à elle les petits enfants de deux ans », elle n’avait ni les lieux, ni surtout les femmes et les hommes capables d’accompagner les tout-petits dans leur développement linguistique, psychologique et affectif. Mais, il faut le reconnaître, elle a répondu légitimement à une demande sociale, urgente et forte, qu’aucun organisme ne prenait en charge. Encore eût-il fallu que les responsables de l’Éducation nationale comprennent qu’ils endossaient là une responsabilité majeure et qu’il était extrêmement grave de « faire avec les moyens du bord ». Ils n’ont pas pris conscience – ou n’ont pas voulu prendre conscience – que la mission nouvelle que l’on assignait à l’école maternelle exigeait que l’on transformât en profondeur les lieux et les modalités d’accueil des tout-petits.
L’école maternelle constitue en effet le poste avancé de l’éducation et reçoit de plein fouet le choc de l’insécurité linguistique. C’est elle qui d’emblée a le devoir de donner sens au désordre et au tumulte du monde ; c’est elle qui veille à l’entrée de ce vaste champ de la signification dans lequel l’école de la République invite le jeune enfant à entrer de plus en plus tôt. Elle doit aujourd’hui ouvrir les premiers chemins à ceux qui ont un urgent besoin qu’on leur dévoile le sens de leur rapport au monde. Elle constitue pour bien des enfants la se...