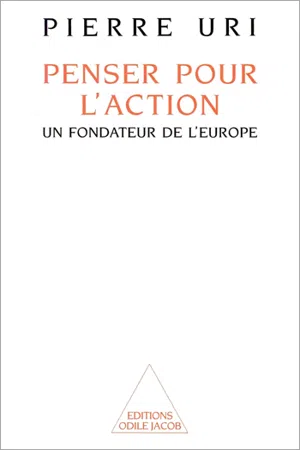
This is a test
- 320 pages
- French
- ePUB (adapté aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Détails du livre
Aperçu du livre
Table des matières
Citations
À propos de ce livre
Comment un jeune professeur de philosophie participe-t-il à l'action pour la reconstruction de la France et, aux côtés de Jean Monnet, pour l'édification de l'Europe? Comment son action a-t-elle évolué face au gaullisme, puis avec la montée de la gauche socialiste?Pierre Uri (1911-1992), économiste, fut membre du Commissariat au Plan, professeur à l'ENA et à l'université de Paris IX-Dauphine.
Foire aux questions
Il vous suffit de vous rendre dans la section compte dans paramètres et de cliquer sur « Résilier l’abonnement ». C’est aussi simple que cela ! Une fois que vous aurez résilié votre abonnement, il restera actif pour le reste de la période pour laquelle vous avez payé. Découvrez-en plus ici.
Pour le moment, tous nos livres en format ePub adaptés aux mobiles peuvent être téléchargés via l’application. La plupart de nos PDF sont également disponibles en téléchargement et les autres seront téléchargeables très prochainement. Découvrez-en plus ici.
Les deux abonnements vous donnent un accès complet à la bibliothèque et à toutes les fonctionnalités de Perlego. Les seules différences sont les tarifs ainsi que la période d’abonnement : avec l’abonnement annuel, vous économiserez environ 30 % par rapport à 12 mois d’abonnement mensuel.
Nous sommes un service d’abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d’un seul livre par mois. Avec plus d’un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu’il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l’écouter. L’outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l’accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui, vous pouvez accéder à Penser pour l'action par Pierre Uri en format PDF et/ou ePUB ainsi qu’à d’autres livres populaires dans Économie et Théorie économique. Nous disposons de plus d’un million d’ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Sujet
ÉconomieSous-sujet
Théorie économiqueCHAPITRE 1
Une famille d’agrégés
1911-1939
Famille – Études – Normale – Agrégation de philosophie – Le service – Les États-Unis – Professeur – Réforme de l’enseignement.
Je suis né à Paris en plein Quartier latin. Ma mère aussi était parisienne. Mais si l’on remonte aux grands-parents, tous venaient d’Alsace ou de Lorraine. Aucun membre, même les plus éloignés, de cette famille n’était resté là-bas sous l’annexion allemande. Cette origine n’est pas dépourvue de sens pour un homme qui a été mêlé centralement à la réconciliation des Européens.
Le père de mon père, que je n’ai pas connu, avait comme instituteur quitté l’Alsace dès 1850 pour une Algérie qui n’était pas encore totalement pacifiée. C’est de la sorte que mon père est né à Tlemcen. Mais pour qu’il puisse poursuivre ses études la famille s’est transportée à Oran et finalement à Paris.
Si j’ai un regret, c’est de n’avoir pas mesuré le bond qu’il avait accompli. Agrégé de grammaire à vingt et un ans, docteur ès lettres à vingt-six ans, obligé de refuser une maîtrise de conférence à Bordeaux parce que sa mère ne voulait pas quitter Paris, on lui crée un poste à la Sorbonne où il fera toute sa carrière à la fois administrative et enseignante ; secrétaire de la Faculté des Lettres, ses collègues pensent qu’un latiniste comme lui, qui a publié des recueils de textes et de magnifiques traductions, ne devait pas être perdu pour les étudiants. Et ses cours pour la licence d’histoire, je l’ai vu les préparer en accumulant des notes sur les textes qu’il commentait mot à mot.
L’agrégation est le signe commun de toute la famille. Ma mère avait été une des premières femmes à en acquérir une, qui couvrait à la fois la physique, la chimie et les sciences naturelles, ma sœur a passé physique et chimie, et ma femme ce qui était encore histoire et géographie.
Ma sœur étant un peu plus âgée que moi, je pouvais, dans les petites classes, et bien avant que les études soient mixtes, être admis au même lycée qu’elle : c’est ce petit garçon de la classe qui a obtenu le premier prix de couture.
En 1918 les avions qu’on appelait « les taubs » et les canons à longue portée dits « la Bertha » bombardaient Paris. D’où un départ pour Lyon, sauf mon père retenu par ses fonctions.
Encore une fois j’étais au lycée de filles. J’ai retrouvé, dix-sept ans après seulement, la très gentille maîtresse d’école qui se souvenait de ce petit réfugié ; mais lui, dans le même établissement, enseignait cette fois la philosophie en première supérieure pour les candidates à l’École normale supérieure de Sèvres.
C’est en huitième que je suis entré à Henri-IV, que j’ai commencé à être premier de classe, pour y passer dix ans jusqu’à l’hypokhâgne d’où j’ai été reçu directement à l’École normale à dix-sept ans.
Presque tous les ans et presque dans tous les domaines, les professeurs étaient extraordinaires, certains étaient poètes, tous insistaient sur le style en nous apprenant à éviter les clichés et à reconnaître que notre langue appelait une prose cadencée. Le latin et le grec, ce n’était pas du mot à mot, mais l’obligation d’inventer des transpositions fidèles, respectant à la fois le sens et la tournure propres des phrases.
Mon professeur de première n’avait pas été choqué quand j’avais revêtu une longue chemise et un morceau de tissu rouge pour réciter, en les jouant, Les fureurs d’Oreste jusqu’à m’écrouler sur le sol comme je pense qu’on le fait à la scène dans Andromaque.
Pour la fête du lycée, nous avions joué Hernani. Je ne me contentais pas du principal rôle, mais soufflais à mes camarades les répliques qu’ils avaient oubliées.
Mon professeur de philosophie Louis Lavelle est entré plus tard au Collège de France. Mais ce qui est inoubliable, c’est mon hypokhâgne : c’était la première année que l’on avait séparé les deux classes préparatoires, le célèbre Alain avait accepté de cumuler, et j’ai été l’un des derniers à profiter de sa manière inimitable. Avant son entrée en salle, nous écrivions des phrases sur le tableau qu’il se prêtait à commenter. Nous pouvions lui remettre autant de papiers libres que nous voulions, on ne peut donc pas les appeler devoirs, et il les corrigeait de sa plume appuyée, écartant tous les néologismes, insistant pour que les phrases fussent rigoureusement liées entre elles, et préférant les longs paragraphes qui obligent à l’approfondissement et à la cohérence des idées.
Il y avait encore peu de khâgnes en France, la plus peuplée était à Louis-le-Grand, mais Henri-IV attirait les garçons brillants de toutes origines : l’un de mes camarades était Maurice Schumann, un autre le futur Julien Gracq. Un petit groupe s’était formé qui se réunissait à la fois pour discuter les idées et pour lire les uns aux autres les poèmes que nous composions. Moi qui avais déjà écrit des sonnets à douze ans en respectant la prosodie la plus stricte, c’est dans cette dernière année de lycée que j’ai commis mes derniers vers.
Un trait que je ne voudrais pas manquer de souligner : prêt à me présenter au bout d’un an, je n’avais fait que l’histoire grecque, et j’ai dû en quelques jours absorber l’histoire romaine. Quant à l’histoire moderne, qui pour nous commençait en 1789, je n’avais abordé que la première moitié du programme. Alors que j’étais un concurrent, ceux qui étaient déjà en khâgne avec l’inoubliable Simone Weil ont eu l’élégance de me passer leurs notes.
C’était un concours difficile, il y avait près de cinq cents candidats et seulement vingt-huit places. A l’oral l’ordre alphabétique me faisait régulièrement interroger derrière Jacques Soustelle : il avait trois mois de moins que moi, déjà deux certificats de licence et il était reçu premier, n’a fait que trois ans à l’école et a encore été premier à l’agrégation de philosophie.
Tous les ans, à la distribution solennelle des prix qui avait lieu dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, c’était la joie de mon père, assis sur l’estrade dans sa robe jaune avec les trois bandes d’hermine, de me remettre ma pile de livres, à mon départ celle du prix de l’association des anciens élèves.
Je m’étais toujours concentré sur ce qui m’était le moins facile, la composition française parce que j’étais très jeune, mais de la troisième à la première j’ai fait le bond jusqu’à une des hautes nominations au concours général. Pour le latin et le grec, je faisais en un quart d’heure mes versions et mes thèmes sans dictionnaire et mon professeur de première les dictait comme corrigés à mes camarades. J’ai tenu à cœur, la dernière année, donc en seconde, où le dessin était obligatoire, d’en remporter le premier prix.
Mon expérience d’élève, que je devais retrouver comme professeur, m’a révélé les hasards des examens et des jurys. Une grève des agrégés avait conduit à faire appel, pour le baccalauréat, à des professeurs d’Université aussi bien qu’à des professeurs de Collège. En version latine le doyen de Lille m’avait donné 39 sur 40, en particulier parce que, sur un texte classique, je n’avais pas suivi la citation erronée de tous les dictionnaires. En philosophie au contraire, alors que mon maître comptait sur moi pour le concours général et sans doute parce que je présentais des idées originales sur un sujet qui concernait « l’habitude », l’homme d’un collège a failli me faire échouer : le président du jury était le grand historien Pierre Renouvin qui, au vu de mon livret, a déclaré que je serai admissible quelle que soit la note que m’attribuerait ce novice.
J’ai tout rattrapé à l’oral, mais j’ai pu apprécier la nullité du correcteur. Comme j’ai enseigné moi-même, j’ai connu aussi les incertitudes auxquelles mes élèves étaient exposés : un professeur qui, sur des copies de qualité moyenne, mettait un 9, alors que le président de jury ne relevait pas les notes, comprenait enfin pourquoi il y avait si peu de reçus, et que la moyenne était 10 ; pis encore une dame n’avait laissé recevoir que le dernier de ma classe, et mon ami Jankélévitch, appelé à la révision, avait déclaré qu’aucune discussion n’était utile, que cette femme était tout simplement folle. J’ai plus tard tenté d’imaginer des systèmes d’examens qui élimineraient le hasard.
Quand j’ai été reçu à l’École j’ai passé par une crise : je me demandais si j’étais prêt à être professeur toute ma vie et, au désespoir de mon père, j’envisageais de me tourner vers la médecine. Peu après j’étais tenté de devenir avocat ou même acteur. Je peux rassurer les plus jeunes : ce qu’on fait au départ ne détermine pas la carrière ; les hasards, les événements, les attirances offrent toutes les chances d’opérer des tournants.
Je choisis immédiatement la philosophie parce que c’était à la fois la ligne la plus générale et la plus difficile. Bien sûr le latin et le grec m’ont servi, puisque, en même temps que les sciences, ils étaient exigés pour l’agrégation. Mais aller vers les lettres aurait été jouer la facilité. Justement, le début ne fut pas facile. Je n’avais pas assez d’années derrière moi pour avoir lu les principaux auteurs. Et je n’ai jamais su comment j’aurais pu éviter de rester court devant Léon Brunschvicg, cet homme d’une grande originalité et d’une immense culture, et qui nous était réservé rue d’Ulm. Je ne sais pas encore aujourd’hui comment j’aurais dû traiter le sujet de leçon qu’il m’avait donné « la logique de Leibniz ». Il me demanda s’il ne serait pas plus prudent de m’orienter vers une autre agrégation.
Il a été pleinement rassuré par la suite. Pour un garçon qui avait préparé une telle École, la licence ne demandait pas un grand travail. J’ai fait mon droit, moyennant une préparation de huit jours en première année, de quinze jours en seconde et de trois semaines en troisième. Et pour les sciences, le certificat de physiologie générale me plaçait une année à cheval entre la section Lettres et la section Sciences de l’école, dans ce vieux bâtiment que nous baptisions « la Nature ».
J’ai passé deux mois en Allemagne, d’abord chez un professeur de collège à Heidelberg, travaillant dur, dictionnaire en main, pour apprendre la langue dans un auteur difficile, La Mort à Venise de Thomas Mann, et le deuxième mois à Francfort dans une maison où les gens n’avaient rien de mieux à faire que de bavarder avec moi. Au retour j’étais en mesure de lire dans le texte un écrit posthume de Kant, imprimé comme il l’avait écrit, sans alinéa et sans aucune ponctuation, alors que les substantifs commencent par une majuscule et ne révèlent même pas le passage d’une phrase à l’autre. Nous avions failli nous trouver vingt élèves de l’école pour prétendre à l’agrégation de philosophie. Le Directeur Célestin Bougle en a détourné quelques-uns vers les lettres, vers l’histoire ou vers une bourse de tour du monde. Lors du concours, sept normaliens se présentaient pour la deuxième fois, le seul qui ait été reçu était Beaufret, qui s’est illustré comme interprète de Heidegger, et par ailleurs sept membres de ma promotion, où j’ai été le seul reçu. Un sujet peu inspirant à ma leçon d’oral m’a coûté le quart de point qui m’empêchait d’être premier comme on s’y attendait. Comme j’ai fait tout autre chose dans la suite de ma vie, il aurait été plaisant de gagner ce caciquat. Au lieu de me réjouir d’être reçu, je me suis consolé en allant danser le soir.
Vacances à Biarritz : j’en profite pour aller passer quelques jours en Espagne et je m’habitue très vite à la langue, au moins à la comprendre, un peu même à la parler, ce qui me servira plus tard dans des colloques concernant l’Europe ou dans des missions en Amérique latine.
A l’école on faisait de la préparation militaire et on avait même le privilège d’être sous-lieutenant du premier jour, mais au lieu de Saint-Cyr on s’exilait à Saint-Maixent, où l’on retrouvait les premiers reçus aux examens ouverts à tous.
Je partageai avec un camarade l’achat d’une très vieille voiture pour rejoindre Niort et passer les week-ends chez moi à Paris. L’un de mes deux meilleurs camarades était un garçon de style gavroche, fils d’un bistrot d’Amiens, qui se préparait à une carrière juridique, et le sacrifice de ses parents a été anéanti quand il a été tué à la guerre ; l’autre était un séminariste que j’ai retrouvé quand il m’a invité, lors de mes activités européennes, à parler au Centre catholique des intellectuels français, que nous nous attendions à voir évêque, mais qui a tout de même achevé sa carrière comme archiprêtre de Notre-Dame et invité à Vatican II.
Il fallait ensuite choisir sa garnison : je n’ai pas voulu contrarier certains camarades dont les préférences étaient marquées, j’ai accepté un bataillon de chasseurs à Grasse, qui exigeait de me faire faire un uniforme, mais qui me faisait bénéficier des délices de la Côte d’Azur.
Mon capitaine était un ancien de la guerre, qui avait rempilé. Il me laissait la conduite de la compagnie, aussi bien pour les exercices qui commençaient très tôt que pour le tir ou les marches hebdomadaires qui exigeaient un départ à deux heures de la nuit. Si bien que je rentrais fièrement à cheval à travers la ville et à la tête de mes troupes.
Je me souviens, lors de manœuvres, d’un incident révélateur. Le commandant du bataillon nous récitait la doctrine classique : les chars avançant à quatre à l’heure avec l’infanterie qui suivait à pied. J’osai murmurer une remarque. De 1918 à 1933, la vitesse des voitures avait singulièrement progressé, et les chars étaient conçus pour faire du trente, sinon du soixante en tout terrain. Il n’y avait pas besoin d’être de Gaulle ni, comme lui, officier de chars, pour mettre en question l’héritage entretenu par Weygand, qui restait à la tête de l’armée après avoir été le chef d’état major de Foch. Il est vrai que dans la première édition, que j’ai eu la chance de lire, de L’Armée de Métier, et qui a été corrigée par la suite, l’auteur plaidait pour l’autonomie de l’arme blindée, mais il écrivait aussi que dans le futur conflit l’aviation ne jouerait aucun rôle. Pour moi, je me suis fait répondre que je n’étais qu’un pékin qui n’y connaissait rien, et que si j’insistais je recevrais quinze jours d’arrêts de rigueur. Mon chef de bataillon est devenu général.
Mes périodes, je les ai faites à Albertville, c’est-à-dire dans la vraie montagne à laquelle j’étais habitué par mes ascensions en Savoie, et avec des officiers qui pensaient davantage à entraîner leurs hommes qu’à draguer les filles. Ils ont apprécié la manière dont j’enseignais aux réservistes ou les entraînais ; et au surplus, à la popote, je m’étais procuré les refrains des bataillons de chasseurs, un par jour pour marquer la date du mois, et par lesquels le plus jeune officier ouvrait les repas.
J’ai constaté ensuite que les officiers de réserve gagnaient du galon en fonction de leur assiduité aux cours de perfectionnement : de la sorte, ceux qui avaient le moins à faire dans la vie se retrouvaient aux grades les plus élevés. Pas d’autre critère que le fayotage. Une des forces de l’Amérique en guerre, c’est qu’elle attribuait des grades correspondant aux capacités dans la vie civile. Et, d’un mot pour n’y pas revenir, Vichy a traîné les hommes politiques devant la Cour de Riom, cependant que les généraux, devant l’offensive allemande, avaient conservé à l’autre bout de la France, au camp du Larzac, dans la crainte de manquer de réserves, les chars dont on aurait eu besoin en première ligne.
Au rebours de mon père, très sédentaire après des voyages de jeune marié qui s’étaient limités à Cannes et Venise, j’ai immédiatement été tenté par le grand large.
Le directeur de Normale présidait le jury qui attribuait la bourse la mieux dotée pour une université américaine, celle de Princeton. Le collège où j’étais logé avait emprunté le style Tudor des universités britanniques. J’ai été surpris par ce que l’on y faisait en philosophie, de la « logistique », j’ai surpris par mes contributions aux séminaires d’économie où les professeurs menaient des discussions en petits groupes. Les Américains m’ont dit alors qu’ils comprenaient ce qu’on appelait en France la culture générale.
Surtout j’ai immédiatement acheté une voiture d’occasion, et j’ai parcouru quelque quarante mille kilomètres, un premier voyage jusqu’à la Floride et la Louisiane, un autre vers la Nouvelle-Angleterre et jusqu’au Canada français, un parcours final qui, zigzaguant de la frontière nord à la frontière sud, me faisait traverser les États-Unis, en atteignant même, par la route, des sommets de plus de quatre mille mètres. J...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Ouvrages du même auteur
- Copyright
- Préface
- Chapitre 1 - Une famille d’agrégés - 1911-1939
- Chapitre 2 - Périls et virages - 1939-1947
- Chapitre 3 - Relever la France - 1947-1950
- Chapitre 4 - La première Communauté - 1950-1952
- Chapitre 5 - De Luxembourg à Messine - 1952-1955
- Chapitre 6 - De Messine à Rome - 1955-1957
- Chapitre 7 - Les voies vers la sortie - 1957-1962
- Chapitre 8 - L’homme disponible - 1962-1966
- Chapitre 9 - Action au grand jour - 1966-1971
- Chapitre 10 - Dispersion ou conjonction ? - 1971-1981
- Chapitre 11 - Apports et déceptions - 1981-1988
- Chapitre 12 - Les facettes de la justice - 1988-1990
- Table