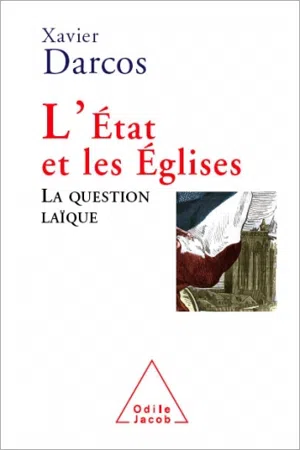Pour la première fois, en 2004, un musulman, Dalil Boubakeur, président du Conseil français du culte musulman, a été reçu par le chef de l’État pour la cérémonie des vœux de l’Élysée, en compagnie du cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris, du pasteur protestant Jean-Arnold de Clermont, président de la Fédération protestante de France, et du grand rabbin de France Joseph Sitruk. Une presse unanime a salué à juste titre l’importance de l’événement. Dalil Boubakeur s’est félicité pour sa part d’être ainsi « admis à la table de la République », et a vu dans ce « moment historique » un véritable acte fondateur marquant « l’an I de l’islam de France ». Et personne ne s’est scandalisé de cet événement. Ce rendez-vous, qui rassemble chaque année le président de la République et les représentants des principales confessions, est bel et bien entré dans les mœurs républicaines. Personne ne se souvient en réalité qu’il n’a été établi qu’en 1947 par un ancien militant socialiste, Vincent Auriol, devenu le premier président de la IVe République.
Cette innovation, qui a été reprise sans exception par tous ses successeurs, manifeste l’intérêt et le respect avec lequel la plus haute institution française considère les religions présentes dans le pays. Elle est une reconnaissance de leur diversité et de leur rôle dans la société, en même temps qu’une invitation faite à leurs fidèles de participer pleinement et entièrement à la vie de la nation. « Les grandes religions, affirmait Jacques Chirac en 2004, contribuent à ce vivre ensemble sans lequel il n’est pas de communauté de destin. » On aurait tort de voir dans cette déclaration une nouveauté ou un quelconque revirement susceptible de menacer la laïcité. Le chef de l’État exprime un état de fait. Sur fond d’incessantes controverses et de polémiques toujours prêtes à se rouvrir, l’État laïc n’a jamais véritablement cessé de rencontrer, d’une manière ou d’une autre, les religions et leurs représentants, ni de leur prêter attention ou de manifester son intérêt à leur égard.
Loin d’ignorer les aléas et les limites de ce dialogue, les pages qui suivent entendent l’éclairer sur trois points distincts : la place du religieux dans les cérémonies publiques, qui dévoile les enjeux symboliques de la laïcité ; la neutralité des pouvoirs publics, qui souligne dans son application concrète l’ambivalence de ce principe ; les relations entretenues avec le Saint-Siège, qui insèrent la République et ses valeurs dans une histoire qui les dépasse.
Des cérémonies en République
La politique de laïcisation de la France menée par les Républicains dans les dernières décennies du XIXe siècle n’a pas manqué de retentir sur l’organisation des cérémonies publiques. Si, dans un premier temps, une ligne dure l’a emporté, excluant toute manifestation religieuse au sein des célébrations de l’État, elle a cependant été abandonnée au profit d’une attitude plus modérée.
Liturgie religieuse et cérémonial public
La signature du Concordat de 1801 avait favorisé, au XIXe siècle, une étroite imbrication du civil et du religieux. Non seulement son préambule accordait une place éminente à « la religion catholique, apostolique et romaine », reconnue comme « la religion de la grande majorité des citoyens français », mais il insistait encore sur « la profession particulière » qu’en faisaient « les consuls de la République ». Ces principes, qui établissaient le catholicisme au cœur de l’appareil politique et du corps social, étaient appelés à régir, jusque dans l’organisation et le déroulement des rituels, les relations entre l’Église et l’État. Ainsi, l’article VIII de la convention conclue entre Napoléon Bonaparte et le pape Pie VII imposait « à la fin de l’office divin, dans toutes les églises de France », la récitation de l’invocation Domine, salvam fac Republicam ; Domine, salvos fac Consules1, qui plaçait le régime et son exécutif sous la protection divine. Cette prescription avait été élargie par les Articles organiques que la France avait promulgués unilatéralement pour compléter l’accord. Ce texte prévoyait en effet plus généralement que « les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieraient et feraient prier pour la prospérité de la République française et pour les consuls » (titre III, article LI). Obligation était aussi faite aux évêques, « lorsque le Gouvernement ordonnerait des prières publiques », de se concerter « avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l’heure et le mode d’exécution de ces ordonnances » (titre III, article XLIX).
Non seulement le clergé se trouvait ainsi contraint de révérer les autorités du pays au cours des célébrations religieuses, mais sa participation était encore requise dans les solennités publiques. Le décret du 24 messidor an XII (13 juillet 1804), qui fixait le protocole et le cérémonial de l’Empire, avait consacré ce rôle assigné à la religion catholique. Conformément aux usages de l’ancienne monarchie, qu’il copiait sur ce point, le document précisait par exemple que les cardinaux devaient prendre place immédiatement après les princes français et avant les grands dignitaires du régime dans les cérémonies officielles. L’Empereur y acceptait aussi de céder le pas au saint sacrement, et de longs développements fixaient avec minutie la nature des honneurs militaires qui devaient lui être rendus et les circonstances dans lesquelles ils lui étaient dus. Ces dispositions paraissent extraordinaires au lecteur d’aujourd’hui : « Lorsque le saint sacrement passera à la vue d’une garde ou d’un poste, les sous-officiers et soldats prendront les armes, les présenteront, mettront le genou droit en terre, inclineront la tête, porteront la main droite au chapeau, mais resteront couverts ; les tambours battront aux champs ; les officiers se mettront à la tête de leur troupe, salueront de l’épée, porteront la main gauche au chapeau, mais resteront couverts ; le drapeau saluera. »
Ce mélange des genres qui imprégnait toute la sphère publique est d’emblée rejeté par la majorité républicaine qui arrive au pouvoir dans les années 1880. Elle s’efforce ainsi d’imposer progressivement une nette distinction entre les festivités publiques et l’exercice du culte. Le dispositif des honneurs militaires est considérablement allégé par les décrets des 23 octobre 1883 et 4 octobre 1891. Le 14 août 1884, les prières publiques prononcées lors de la rentrée des Chambres sont abolies, tandis que la messe obligatoire du Saint-Esprit, qui marque la rentrée des cours et des tribunaux, est supprimée à son tour le 14 décembre 1900. C’est tout un mode traditionnel de représentation du pouvoir qui se trouve ainsi remis en cause, à mesure que s’affirment cette réglementation et les pratiques nouvelles qu’elle induit. En effet, pour les partisans de la laïcité, il s’agit non seulement de promouvoir une liturgie civile débarrassée de la participation de l’Église, mais aussi, dans le même temps, de ne plus compromettre l’autorité publique dans le déroulement des célébrations catholiques.
Bien malgré lui, le gouvernement Méline fait, en mai 1897, une expérience malheureuse en participant, aux côtés du président de la République Félix Faure et des corps constitués, au service funèbre organisé à Notre-Dame en l’honneur des victimes de l’incendie du Bazar de la Charité. L’opinion est alors profondément émue par ce drame qui a provoqué plus de 120 morts parmi la bonne société venue assister à une œuvre de bienfaisance. Mais cela n’empêche pas la polémique d’enfler autour de l’organisation de cette cérémonie et de la présence des plus hauts représentants de l’État dans la cathédrale. Le scandale est d’autant plus grand que le prédicateur monté en chaire, le père dominicain Ollivier, profite de l’occasion pour vilipender la République et dénoncer pêle-mêle « les crimes et défections de la France » et « l’orgueil de ce siècle ». Assumant jusqu’au bout ses responsabilités, le gouvernement n’en demande pas moins à la Chambre de prendre en charge les dépenses occasionnées par la célébration. Alors que des députés radicaux s’insurgent contre une manifestation religieuse portant atteinte à la laïcité, le ministre de l’Intérieur Louis Barthou cherche à se justifier en minimisant l’événement : le ministère souhaitait seulement accomplir son devoir, en rendant « un hommage public » aux victimes sous la forme qui paraissait « le mieux répondre à leur vie même » ; par ailleurs, il avait pris soin de sauver les apparences, en envoyant des invitations qui mentionnaient que les obsèques n’avaient pas « un caractère officiel ».
Comme en témoigne cette controverse, la participation des autorités de l’État aux services religieux est une question qui divise le camp républicain dans les dernières années du XIXe siècle. Alors que le concordat demeure en vigueur, perpétuant un lien étroit avec l’Église catholique, les plus modérés hésitent à remettre en cause des usages qui encouragent cette connivence dans les célébrations et donnent même au gouvernement une capacité d’initiative en ce domaine. À l’inverse, les partisans d’une stricte laïcité, qui plaident pour une séparation nette des sphères publique et religieuse, refusent les compromis, dans lesquels ils ne voient que compromissions avec le cléricalisme et menaces à l’encontre du principe laïc. Même si elle n’évoque pas explicitement le problème, la loi de 1905 conforte cette position intransigeante, en affirmant que la « République ne reconnaît […] aucun culte ». Le gouvernement y trouve un argument pour faire évoluer les pratiques et se tenir à l’écart des lieux de culte.
La messe impossible
Si elle rapproche l’État et les Églises, l’Union sacrée née au moment de la Première Guerre mondiale n’en ramène pas pour autant le pouvoir vers les cérémonies religieuses. Tout au long du conflit, le président de la République et les membres du gouvernement évitent soigneusement les prières et les services organisés par les différentes confessions pour soutenir l’effort de la nation dans l’épreuve des combats ; ils sont également absents des célébrations religieuses qui accompagnent la victoire en 1918. Ce retrait procède d’une volonté délibérée des autorités, sur laquelle le président du Conseil Georges Clemenceau est amené à s’expliquer à la fin des hostilités.
En mars 1918, le cardinal Andrieu, archevêque de Bordeaux, avait plaidé auprès de Clemenceau pour l’organisation d’une prière officielle, alors que les troupes françaises rencontraient des difficultés sur la Somme. Dans sa lettre, le prélat rappelait l’exemple de Clovis, qui avait promis de se convertir au cas où il l’emporterait à Tolbiac, l’épisode de Bouvines, où Philippe Auguste avait connu le succès après avoir entendu la messe, ou encore le souvenir de Jeanne d’Arc, qui s’était emparée d’Orléans en portant une bannière dédiée à Jésus et à Marie. Il avait conclu sur la nécessité de « mobiliser, après les forces matérielles, les forces spirituelles ». Le chef du gouvernement n’avait pas daigné répondre à cette requête un peu exaltée. Il prend en revanche la peine de répliquer quelques mois plus tard à une démarche similaire du cardinal Luçon, archevêque de Reims. Dans un message qu’il lui fait tenir par l’intermédiaire du président de la République Raymond Poincaré, il repousse clairement et fermement la proposition : « Le pouvoir que le gouvernement détient lui vient uniquement de la loi. Vous comprendrez qu’il ne m’est donc pas possible d’en organiser la subversion. »
L’immédiat après-guerre se caractérise par une rigueur similaire. À l’occasion de la victoire, le cardinal Amette, archevêque de Paris, invite les hauts responsables de l’État à un Te Deum d’action de grâces à Notre-Dame. La question est débattue en Conseil des ministres. Malgré les opinions contraires du président de la République et de certains membres de son cabinet, Georges Clemenceau s’y montre farouchement opposé et emporte gain de cause. Aucun représentant officiel ne se rend à la célébration, mais Mme Poincaré, accompagnée de Mme Deschanel, épouse du président de la Chambre, viennent néanmoins rendre hommage à la mobilisation des catholiques durant le conflit. Cette solution « diplomatique » souligne avec éclat la résolution du président du Conseil, qui se fonde sur une interprétation stricte du principe de laïcité. Il s’en explique à nouveau en 1919, dans une réponse au cardinal Mercier, archevêque de Malines-Bruxelles, qui souhaitait la participation des nations victorieuses à un office célébré dans la cathédrale de Paris pour l’ouverture de la Conférence de paix. Aux yeux de Clemenceau, il est impossible que le gouvernement de la République patronne ou organise quelque cérémonie confessionnelle que ce soit : « La loi française les a mises hors de portée pour laisser en matière religieuse aux citoyens comme aux Églises de tous les cultes le plein exercice d’une complète liberté. »
Fixée à une époque où les polémiques qui ont entouré la séparation restent encore vives dans l’opinion, cette règle connaît par la suite de nombreuses inflexions et d’incontestables assouplissements. L’attitude des gouvernements de l’entre-deux-guerres se fait ainsi plus modérée. Un pas supplémentaire est encore franchi en 1929. Les festivités exceptionnelles organisées autour du cinquième centenaire de la délivrance d’Orléans par Jeanne d’Arc en sont le théâtre. Pour la première fois depuis la Séparation, le président de la République assiste officiellement à une messe. Le protestant Gaston Doumergue, puisque c’est de lui qu’il s’agit, participe aussi à un culte réformé. À l’issue des cérémonies, il aurait déclaré au cardinal Lépicier, légat pontifical : « Monsieur le Cardinal, ma présence ici et celle de mon gouvernement signifient que la République française n’est ni athée ni antireligieuse. » Ce rapprochement spectaculaire entre l’État et les Églises, et notamment l’Église catholique, s’intensifie à la fin des années 1930. Le 19 juillet 1938, l’inauguration de la cathédrale de Reims, restaurée après les destructions de la Première Guerre mondiale, est un moment fort de ce cheminement. Le président de la République Lebrun et deux ministres radicaux du gouvernement, Paul Marchandeau, ministre des Finances, et Jean Zay, ministre de l’Éducation nationale, prennent place aux côtés du nonce apostolique Valerio Valeri et de cinquante-quatre archevêques et évêques pour un office solennel au cours duquel le cardinal Suhard exalte la France « championne de toutes les saines libertés » et de la « défense de la personne humaine ». Il y a dans cette unité comme une préfiguration des cérémonies spectaculaires qui scandent le désastre français de 1940 : le 19 mai, le gouvernement groupé autour du président du Conseil Paul Reynaud assiste à Notre-Dame à des prières pour la victoire ; le 31 mai suivant, plusieurs ministres sont présents dans la basilique de Montmartre pour une consécration de la France au Sacré-Cœur.
Une page se tourne définitivement dans le sillage de la Libération et des espoirs de réconciliation dont elle est porteuse. Après la délivrance de Paris, le général de Gaulle se rend ostensiblement à Notre-Dame pour y entendre un Magnificat. D’une façon générale, les différentes confessions sont étroitement associées aux célébrations de l’année 1945. En témoignent par exemple les manifestations du 11 novembre, jour choisi pour honorer les victimes de la Seconde Guerre mondiale en association avec celles du conflit de 1914-1918. Des offices religieux sont organisés dans toutes les églises catholiques de Paris, le 10 novembre en soirée ; une ultime messe est dite à minuit dans la chapelle Saint-Louis des Invalides, où sont déposés les quinze corps, représentatifs des Français et Françaises morts pour la France, qui doivent être inhumés le lendemain dans le monument commémoratif du mont Valérien. Le 11 novembre à 17 heures, un office a lieu en l’église réformée de l’Étoile. Enfin, la synagogue de la rue de la Victoire célèbre à son tour ses victimes le 12 novembre à 10 heures. Pour les responsables politiques de l’après-guerre, le respect de la Séparation n’exclut plus aussi rigoureusement l’association des Églises aux solennités publiques et la participation des autorités de l’État aux cérémonies religieuses. De nouvelles règles s’élaborent. Ainsi, durant tout le temps qu’il passe aux Affaires, le général de Gaulle, quoique catholique, manifeste à sa manière son attachement à la laïcité en s’abstenant de communier lorsqu’il assiste à une messe en tant que chef de l’exécutif. Cette maxime est reprise à sa suite par Georges Pompidou et par Valéry Giscard d’Estaing.
Ultimes controverses
En dépit d’un climat général plus apaisé, les anciennes querelles sont toujours susceptibles de resurgir brusquement. Les polémiques qui ont accompagné l’organisation des obsèques de François Mitterrand en sont un bon exemple.
Le cérémonial des funérailles nationales faisait pourtant l’objet, de longue date, d’un consensus républicain. Il pouvait être exclusivement civil, comme ce fut le cas pour Léon Gambetta, Victor Hugo, Georges Clemenceau ou Aristide Briand, mais il pouvait aussi comprendre une célébration religieuse. Même dans les périodes les plus difficiles des relations entre l’État et les Églises, ce principe n’avait pas été remis en cause, faisant ainsi exception à la règle alors admise d’une stricte séparation des cérémonies. En 1917, le président Poincaré et le gouvernement assistent aux obsèques religieuses du général Galliéni, alors qu’ils refusent en 1918 de participer au Te Deum de la victoire à Notre-Dame. Dans l’entre-deux-guerres, les funérailles nationales décrétées pour Foch, Joffre et Lyautey comportent une messe catholique. Celles de Mermoz, disparu en mer le 6 décembre 1936, ont lieu vingt-quatre jours plus tard en l’église des Invalides, devant le gouvernement de Front populaire. Avec les décès de Charles de Gaulle et Georges Pompidou, l’usage se prend, sous la Ve République, de doubler les obsèques privées de ces présidents par une cérémonie solennelle à Notre-Dame. Lors de la mort de François Mitterrand en 1996, son successeur Jacques Chirac se conforme à ces précédents et organise un hommage national à la cathédrale de Paris.
On se souvient peu aujourd’hui des infinies discussions provoquées en leur temps par cette décision, alors même qu’elle ne paraissait pas totalement contraire aux convictions du président défunt, puisque celui-ci avait laissé à sa famille la possibilité de célébrer ses obsèques privées dans le rite catholique. Dans la presse, à la radio, les voix n’ont pas manqué pour s’interroger sur « la légitimité d’une messe solennelle à Notre-Dame » et même pour re...