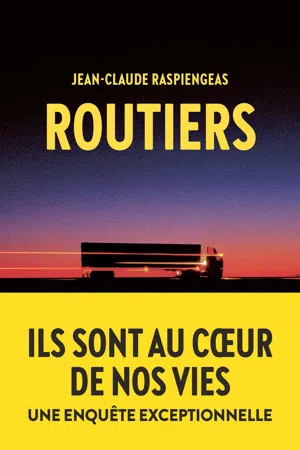PREMIER JOUR
3H, UN LUNDI DE NOVEMBRE
BURLIONCOURT (MOSELLE)
Le réveil, inutile, vient tirer Bruno Triquet des eaux noires où s’agitent ses sombres pensées. Sa nuit a été scandée, tous les quarts d’heure, par la cloche de l’église. Le sommeil ne venait pas.
« C’est dur ! J’ai dû dormir deux heures. Le blues du dimanche soir et l’angoisse de ne pas me réveiller. C’est comme ça toutes les semaines. » Il est là, dans sa cuisine, la mine fripée devant son café, Thermos à portée de main, sans rien avaler d’autre que cet excitant. Sa femme, Chantal, est restée au lit.
Dans ce village de 180 habitants, Bruno est sans doute l’un des rares d’attaque à cette heure-ci. Olivier, son frère cadet, routier lui aussi, a décollé il y a une demi-heure. Jérémy, son neveu, sur les traces de ses aînés, va suivre. Ils sont sept dans la famille Triquet à « tenir le cerceau ». Trois générations de camionneurs.
4H
Cueilli par la fraîcheur humide de l’automne, Bruno, équipé d’un sac à dos avec ses effets de rechange pour la semaine, se hisse dans son Volvo 500. Il ne sera de retour que vendredi soir. Ou samedi. À moins que la déveine de la route ne l’arraisonne sur un parking, loin de chez lui, pour le week-end. Comme tant d’autres.
Clef de contact. Le tableau de bord s’illumine. Bruno glisse sa carte personnelle, le mouchard portatif, dans la fente du chronotachygraphe. Le moteur s’allume, la cabine vibre, le temps d’installer ses affaires, de se caler sur le siège. Inspection rapide pour vérifier l’état général de son outil de travail, jauger les pneumatiques, détecter une fuite éventuelle d’eau, d’huile, de gas-oil.
Pour épargner le moteur, Bruno traverse lentement son village natal. Blottis sous l’édredon, dans leur demi-sommeil, certains habitants doivent reconnaître ce bruit familier. Ils songent peut-être, sans connaître leur drôle de vie, à ces enfants du pays qui partent on ne sait où avec leur cargaison.
Bruno se tourne vers moi, son passager pour la semaine. « Vous voyez la loupiote bleue sous le tableau de bord ? À partir de maintenant, mon patron sait que je suis sur la route. Il peut me suivre à la trace, minute par minute, avec exactitude, vérifier le nombre de kilomètres que j’ai avalés, et à quelle distance je me trouve de ma prochaine destination. »
Au loin, une voiture sort en marche arrière d’un garage. « C’est Jérémy. Il part à son tour. » Appel de phares complice. Les feux de son neveu s’évanouissent au loin.
Bruno accroche sa remorque, stationnée le week-end en lisière de la commune. Espadrilles aux pieds pour conduire, il retraverse Burlioncourt avec son lourd chargement – 24 tonnes de conserves, qui s’ajoutent aux 17 tonnes du tracteur –, qu’il doit livrer à Ludres (Meurthe-et-Moselle), près de Nancy. À une heure de route.
Premières rafales de vent et de pluie. Les feuilles mortes virevoltent devant le pare-brise. Au-delà du ballet des essuie-glaces et de la trouée des phares, partout l’obscurité.
Secoué mollement sur son siège hydraulique, Bruno manœuvre pour franchir la pénible série de ronds-points et de « gendarmes couchés » qui cassent l’allure aux carrefours et protègent l’entrée des communes. Cette mise en jambes déverrouille les muscles de ses épaules et de ses bras, sollicités pour enrouler et dérouler le volant. Compas dans l’œil et juste impulsion du pied pour freiner puis relancer, avec déjà dans les reins les obsessionnels coups de boutoir de la remorque qui encaisse chaque obstacle, Bruno se plaint de la dégradation des nationales, aux chaussées défoncées. « Depuis 2013, depuis que la charge des poids lourds est montée à 44 tonnes, les routes ont souffert. Les départements n’ont pas les moyens de les entretenir. »
5H
LUDRES (MEURTHE-ET-MOSELLE) – KM 50
Ponctuel, Bruno se présente à l’entrée, gardée et surveillée, de l’un de ces entrepôts gigantesques où les poids lourds viennent charger et décharger.
Interphone. Une voix enregistrée répète mécaniquement que sa demande est prise en compte. La barrière tarde à lui céder le passage. Pas de contact humain.
À la réception, derrière leur guichet, deux employés, gilet de sécurité sur les épaules, ne lèvent pas les yeux de leur ordinateur. Ni bonjour ni sourire. Plusieurs chauffeurs poireautent. Personne ne se préoccupe d’eux alors qu’ils viennent livrer ce qui a été commandé.
Pendant ce temps, casque émetteur sur les oreilles, des caristes exécutent les ordres qu’une voix de synthèse numérique leur transmet. Ils glissent, avec la cargaison qu’ils amassent au fur et à mesure des indications, le long d’interminables rangées de structures métalliques où la marchandise s’étage jusqu’à 20 mètres de haut. Ballet bien réglé, ambiance de film à la Jacques Tati, ponctuée de bips intempestifs pour signaler le passage d’un chariot élévateur qui s’annonce par ses clignotants bleutés.
5H30
Le jour n’est pas levé. Les chauffeurs attendent toujours. Aucune explication. Ils se regardent, haussent les épaules. Ils ont renoncé à toute forme de révolte ou d’énervement qu’ils savent contre-productive. Armée désordonnée de fantassins, soumis au bon vouloir des réceptionnaires. Et au pouvoir tout-puissant des caristes qui, sans avoir à se justifier, décident du moment et de l’heure où ils entreront en action, sans tenir compte de la charge de travail des routiers ni même leur accorder l’aumône d’un mot, d’une poignée de main.
Triste et saumâtre spectacle d’une classe ouvrière qui achève elle-même de briser la solidarité traditionnelle qui la liait et la rendait forte. Une hiérarchie absurde et sans fondement se met insidieusement en place, anonyme et fonctionnelle. Le capitalisme peut se frotter les mains. Il est parvenu à ses fins. La classe ouvrière est désormais fracturée, divisée, atomisée. Affaiblie, donc corvéable à volonté. Indispensables et négligés, les routiers en sont l’un des meilleurs exemples.
5H40
Des employés et des caristes entrent et sortent du bureau, sans un regard pour les chauffeurs. Quarante minutes se sont écoulées avant que l’un des réceptionnaires ouvre enfin la fenêtre de son guichet, papiers en main, et s’adresse à Bruno. « Tu vas quai 36 ! » C’est un tutoiement de supériorité, non d’égalité ni de camaraderie. Partout, le routier est traité comme un moins-que-rien, par cette forme détachée de routine impersonnelle.
6H
Installé à quai, Bruno enlève les barres « stop fret » qui bloquent les palettes pour les empêcher de bouger sur la route. Puis il attend de nouveau. Un cariste surgit soudain et s’engouffre dans la remorque. Il exécute le boulot sans un mot. Quand Bruno retourne à la réception récupérer sa « lettre de voiture » (son ordre de mission, avec le détail de la cargaison, la preuve du lien de l’expéditeur au destinataire), il est cette fois à la merci d’une vérificatrice qui vient d’embaucher. Elle papote avec ses collègues, prend son temps et disparaît sans que Bruno sache si c’est elle ou un autre qui va passer en revue sa livraison.
6H35
Une demi-heure plus tard, elle réapparaît, toujours aussi fermée, pour transmettre des papiers qu’un employé parcourt des yeux. Signature, coup de tampon, glissement de la vitre. Pas un au revoir, pas un merci. Les documents sont rendus à Bruno. Sans un mot.
Saynète ordinaire dans une plateforme logistique de la grande distribution. À ce petit jeu de l’indifférence, pour quinze minutes de déchargement, Bruno a déjà perdu plus d’une heure et demie qu’il ne pourra plus rattraper. Qui s’en soucie, dans ces bureaux où l’on travaille à heures fixes ?
6H45
Bruno ressort de cette enceinte fortifiée, l’un des fleurons flambant neuf d’une grande compagnie de logistique, l’une des plus importantes de France. « Il faut prendre son mal en patience. On n’a pas le choix. Même quand on arrive au bout de notre amplitude et qu’on les prévient de notre situation, ils n’en ont rien à foutre. C’est partout pareil. »
7H15
NEUVES-MAISONS, PRÈS DE NANCY – KM 60
Le Volvo 500 crapahute dans des ornières noires et boueuses, au milieu d’un décor du XIXe siècle. Usines métallurgiques aux vitres cassées, entassement de ferraille. Bruno vient charger onze bobines de fil machine pour du fer à béton. À livrer demain matin avant le lever du jour, à l’autre bout du pays, à Pierre-Buffière, dans le Limousin.
Sous une pluie battante et glacée, il dégrafe la bâche, la fait glisser, enlève les planches latérales qui maintiennent la structure de la remorque et la cargaison, fait coulisser les poteaux de soutien. Il attend. Encore et toujours.
Un cariste finit par rappliquer. L’opération est vite exécutée. Bruno doit maintenant sangler serrées ces lourdes bobines. Replacer les poteaux, fixer de nouveau les traverses latérales, refaire coulisser la bâche que la pluie alourdit. Quand il remonte dans sa cabine, il est trempé. Pas le temps de se changer, il séchera en roulant.
8H
Bruno tire ses 44 tonnes hors de ce bourbier, passe sur un pont de pesage, descend faire signer ses papiers en quatre exemplaires, remonte, franchit plusieurs barrières de sécurité avant de pouvoir s’élancer sur la grand-route.
Il envoie un SMS à son patron pour confirmer qu’il a chargé et qu’il met le cap sur Limoges.
Il a remis le compteur horaire à zéro. Tout routier a droit à deux fois 4 heures 30 de conduite. Avec une pause obligatoire de 45 minutes, qu’il peut fractionner en chemin (d’abord 15, puis 30 minutes) ou prendre en une fois.
Au volant, pris dans l’engrenage du flux tendu, soldats du juste-à-temps, les routiers ne cessent de calculer temps de conduite, temps de pause, temps de mise à disposition, temps de travail ; de refaire leurs comptes, d’estimer ce qu’il leur reste, d’imaginer, en tapotant sur leur écran de GPS, des trajets qui leur permettront de rabioter quelques minutes. Ils ont une épée de Damoclès à portée de regard : le chronotachygraphe numérique, qui enregistre tout et stocke les données.
Sous surveillance, les routiers sont des calculatrices ambulantes.
8H20
ROCADE DE NANCY – KM 75
Mauvaise heure. Bruno se retrouve d’entrée piégé dans les embouteillages. Pour occuper le temps, il appelle son frère et son neveu. Conversation à trois pour comparer leurs positions, évoquer leurs galères, discutailler de tout et de rien, tromper l’ennui, briser la solitude, évaluer s’ils ont une chance de se croiser.
8H45
Bruno avance à petits pas, à coups d’accélération et de freinage. Éprouvante, stressante, cette partie de yoyo est troublée par les automobilistes pressés qui se faufilent en douce, s’insinuent dans les angles morts, obligeant Bruno à piler en catastrophe son lourd convoi. Il ne proteste plus, n’enclenche plus sa puissante trompe de klaxon. « Ça ne sert à rien, soupire-t-il. Ils n’ont aucune conscience du risque qu’ils prennent, ni de nos contraintes. Ils forcent le passage. »
9H30
La perte de temps s’accumule. Quand Bruno, au travail depuis 4 heures du matin, s’extrait enfin de ce magma, il sort à peine de Nancy.
Un routier a droit, calculée sur 24 heures, à une amplitude de 15 heures, suivie de 9 heures de repos obligatoire en continu. Et, deux fois par semaine, à 13 heures d’amplitude, avec 11 heures de repos en continu.
10H15
RN4, STRASBOURG-PARIS
Bruno, en apparence placide, qui contrôle ses nerfs en toute circonstance, sur qui tout semble glisser, remarque tout, voit tout. Il parle peu mais ce qu’il dit exprime la profondeur d’une introspection à laquelle le voue sa solitude au volant. « J’adore conduire à l’automne et au printemps, regarder les paysages, les c...