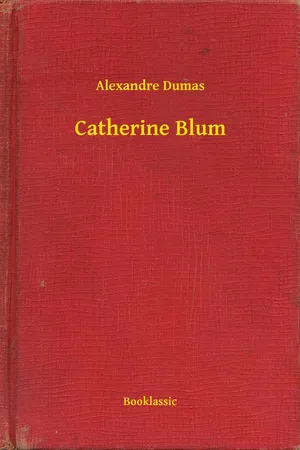Tu me disais hier, mon enfant :
– Cher père, tu ne fais pas assez de livres comme Conscience.
Ce à quoi je t’ai répondu :
– Ordonne : tu sais bien que je fais tout ce que tu veux. Explique-moi le livre que tu désires, et tu l’auras.
Alors, tu as ajouté :
– Eh bien ! je voudrais une de ces histoires de ta jeunesse, un de ces petits drames inconnus du monde, qui se passent à l’ombre des grands arbres de cette belle forêt dont les profondeurs mystérieuses t’ont fait rêveur, dont le mélancolique murmure t’a fait poète ; un de ces événements que tu nous racontes parfois en famille, pour te reposer des longues épopées romanesques que tu composes ; événements qui, selon toi, ne valent pas la peine d’être écrits. Moi, j’aime ton pays, que je ne connais pas, que j’ai vu de loin à travers tes souvenirs, comme on voit un paysage à travers un rêve !
– Oh ! et moi aussi, je l’aime, mon bon pays, mon cher village ! car ce n’est guère autre chose qu’un village, quoiqu’il s’appelle bourg et s’intitule ville ; je l’aime à en fatiguer, non pas vous autres, mes amis, mais les indifférents. Je suis, à l’endroit de Villers-Cotterêts, comme mon vieux Rusconi est à l’endroit de Colmar. Pour lui, Colmar est le centre de la terre, l’axe du globe ; l’univers tourne autour de Colmar ! c’est à Colmar qu’il a connu tout le monde : Carrel ! « Où avez-vous donc connu Carrel, Rusconi ? – J’ai conspiré avec lui à Colmar, en 1821. » Talma ! « Où avez-vous donc connu Talma, Rusconi ? – Je l’ai vu jouer à Colmar, en 1818. » Napoléon ! « Où avez-vous donc connu Napoléon, Rusconi ? – Je l’ai vu passer à Colmar, en 1808. » Eh bien ! tout date pour moi de Villers-Cotterêts, comme tout date de Colmar pour Rusconi.
Seulement, Rusconi a sur moi cet avantage ou ce désavantage de n’être pas né à Colmar : il est né à Mantoue, la ville ducale, la patrie de Virgile et de Sordello, tandis que moi je suis né à Villers-Cotterêts.
Aussi, tu le vois, mon enfant, ne faut-il pas me presser beaucoup pour me faire parler de ma bien-aimée petite ville, dont les maisons blanches, groupées dans le fond du fer à cheval que forme son immense forêt, ont l’air d’un nid d’oiseaux que l’église, avec son clocher au long col, domine et surveille comme une mère. Tu n’as qu’à ôter de mes lèvres le sceau qui y clôt mes pensées et y enferme mes paroles, pour que pensées et paroles s’en échappent vives et pétillantes comme la mousse du cruchon de bière, qui nous fait jeter un cri et nous écarte les uns des autres à notre table d’exil, ou comme celle du vin de Champagne, qui nous arrache un sourire et nous rapproche en nous rappelant le soleil de notre pays.
En effet, n’est-ce pas là que j’ai véritablement vécu, puisque c’est là que j’ai attendu la vie ? On vit par l’espérance bien plus que par la réalité. Qui fait les horizons d’or et d’azur ? Hélas ! mon pauvre enfant, tu sauras cela un jour : c’est l’espérance !
Là, je suis né ; là, j’ai jeté mon premier cri de douleur ; là, sous l’œil de ma mère, s’est épanoui mon premier sourire ; là, j’ai couru, tête blonde aux joues roses, après ces illusions juvéniles qui nous échappent ou qui, si on les atteint, ne nous laissent aux doigts qu’un peu de poussière veloutée, et qu’on appelle des papillons. Hélas ! c’est encore vrai et étrange ce que je vais te dire : on ne voit de beaux papillons que lorsqu’on est jeune ; plus tard viennent les guêpes, qui piquent ; puis les chauves-souris, qui présagent la mort.
Les trois périodes de la vie peuvent se résumer ainsi : jeunesse, âge mûr, vieillesse ; papillons, guêpes, chauves-souris !
C’est là que mon père est mort. J’avais l’âge où l’on ne sait pas ce que c’est que la mort, et où l’on sait à peine ce que c’est qu’un père.
C’est là que j’ai ramené ma mère morte ; c’est dans ce charmant cimetière, qui a bien plus l’air d’un enclos de fleurs à faire jouer des enfants que d’un champ funèbre où coucher des cadavres, qu’elle dort côte à côte avec le soldat du camp de Maulde et le général des Pyramides. Une pierre que la main d’une amie a étendue sur leur tombe les abrite tous deux.
À leur droite et à leur gauche gisent les grands-parents, le père et la mère de ma mère, des tantes dont je me rappelle le nom, mais dont je ne vois le visage qu’à travers le voile grisâtre des longues années.
C’est là enfin que j’irai dormir à mon tour, le plus tard possible, mon Dieu ! car ce sera bien malgré moi que je te quitterai, mon cher enfant !
Ce jour-là, je retrouverai, à côté de celle qui m’a allaité, celle qui me berça : la maman Zine, dont je parle dans mes Mémoires, et près du lit de laquelle le fantôme de mon père est venu me dire adieu !
Comment n’aimerais-je point à parler de cet immense berceau de verdure où chaque chose est pour moi un souvenir ? Je connaissais tout, là-bas, non seulement les gens de la ville, non seulement les pierres des maisons, mais encore les arbres de la forêt ! Au fur et à mesure que ces souvenirs de ma jeunesse ont disparu, je les ai pleurés. Têtes blanches de la ville, cher abbé Grégoire, bon capitaine Fontaine, digne père Niguel, cher cousin Deviolaine, j’ai essayé parfois de vous faire revivre ; mais vous m’avez presque effrayé, pauvres fantômes, tant je vous ai trouvés pâles et muets malgré ma tendre et amicale évocation ! Je vous ai pleurés, pierres sombres du cloître de Saint-Rémy, grilles colossales, escaliers gigantesques, cellules étroites, cuisines cyclopéennes, que j’ai vus tomber assise par assise, jusqu’à ce que le pic et la pioche découvrissent au milieu des débris vos fondations, larges comme des bases de remparts, et vos caves, béantes comme des abîmes ! Je vous ai pleurés, vous surtout, beaux arbres du parc, géants de la forêt, familles de chênes au tronc rugueux, de hêtres à l’écorce polie et argentée, de peupliers trembleurs, et de marronniers aux fleurs pyramidales, autour desquelles bourdonnaient, dans les mois de mai et de juin, des essaims d’abeilles au corps gonflé de miel, aux pattes chargées de cire ! Vous êtes tombés tout à coup en quelques mois, vous qui aviez encore tant d’années à vivre, tant de générations à abriter sous votre ombre, tant d’amours à voir passer mystérieusement et sans bruit sur le tapis de mousse que les siècles avaient étendu à vos pieds ! Vous aviez connu François Ier et madame d’Étampes, Henri II et Diane de Poitiers, Henri IV et Gabrielle ; vous parliez de ces illustres morts sur vos écorces creusées ; vous aviez espéré que ces croissants triplement enlacés, que ces chiffres amoureusement tordus les uns aux autres, que ces couronnes de lauriers et de roses vous sauvegarderaient d’un trépas vulgaire et de ce cimetière mercantile qu’on appelle un chantier. Hélas ! vous vous trompiez, beaux arbres ! Un jour, vous avez entendu le bruit retentissant de la cognée et le sourd grincement de la scie… C’était la destruction qui venait à vous ! c’était la mort qui vous criait : « À votre tour, orgueilleux ! »
Et je vous ai vus couchés à terre, mutilés des racines au faîte, avec vos branches éparses autour de vous ; et il m’a semblé que, plus jeune de cinq mille ans, je parcourais cet immense champ de bataille qui se déroule entre Pélion et Ossa, et que je voyais étendus à mes pieds ces titans aux trois têtes et aux cent bras qui avaient essayé d’escalader l’Olympe, et que Jupiter avait foudroyés !
Si jamais tu te promènes avec moi et appuyé à mon bras, cher enfant de mon cœur, au milieu de tous ces grands bois ; si tu traverses ces villages épars, si tu t’assieds sur ces pierres couvertes de mousse, si tu inclines la tête vers ces tombes, il te semblera d’abord que tout est silencieux et muet ; mais je t’apprendrai le langage de tous ces vieux amis de ma jeunesse, et alors tu comprendras quel doux murmure ils font à mon oreille, vivants ou morts.
Nous commencerons par l’orient, et c’est tout simple : pour toi, le soleil se lève à peine ; ses premiers rayons font encore cligner tes grands yeux bleus où le ciel se mire. Là, nous visiterons, en appuyant un peu au midi, ce charmant petit château de Villers-Hélon, où j’ai joué, tout enfant, cherchant au milieu des massifs, à travers les vertes charmilles, ces fleurs vivantes que nos jeux éparpillaient et qui s’appelaient Louise, Augustine, Caroline, Henriette, Hermine. Hélas ! aujourd’hui, deux ou trois de ces belles tiges si souples sont brisées sous le vent de la mort ; les autres sont mères, quelques-unes grand-mères. Il y a quarante ans de l’époque dont je te parle, mon cher enfant, à toi qui, dans vingt ans seulement, sauras ce que c’est que quarante ans.
Puis, continuant le périple, nous traverserons Lorcy. Vois-tu cette pente rapide parsemée de pommiers, et qui trempe sa base dans cet étang à l’eau et aux herbes vertes ? Un jour, trois jeunes gens, emportés dans un char à bancs par un cheval imbécile ou furieux, ils n’ont jamais bien su si c’était l’un ou l’autre, roulaient comme une avalanche, se précipitant tout droit dans cette espèce de Cocyte ! Par bonheur, une des roues accrocha un pommier ; ce pommier fut presque déraciné ! Deux des jeunes gens furent lancés par-dessus le cheval ! l’autre, comme Absalon, resta suspendu à une branche, non point par la chevelure, quoique sa chevelure eût fort prêté à cette pendaison, mais par la main ! Les deux jeunes gens qui avaient été lancés par-dessus le cheval étaient, l’un mon cousin Hippolyte Leroy, dont tu m’as quelquefois entendu parler, l’autre mon ami Adolphe de Leuven, dont tu m’entends parler toujours ; le troisième, c’était moi.
Que serait-il arrivé de ma vie, et, par conséquent de la tienne, mon pauvre enfant, si ce pommier ne se fût trouvé là, à point nommé, sur ma route ?
À une demi-lieue à peu près, toujours en nous avançant de l’est au midi, nous devons trouver une grande ferme. Tiens, la voilà avec son corps de logis couvert de tuiles, et ses dépendances coiffées de chaume : c’est Vouty.
Là, mon enfant, demeure encore, je l’espère, quoiqu’il doive avoir aujourd’hui plus de quatre-vingts ans, un homme qui a été à ma vie morale, si je puis m’exprimer ainsi, ce que ce bon pommier que je te montrais tout à l’heure, et qui arrêta notre char à bancs, a été à ma vie matérielle. Cherche dans mes Mémoires, et tu trouveras son nom : c’est ce vieil ami de mon père qui est entré un jour chez nous revenant de la chasse, une moitié de la main gauche emportée par son fusil qui avait crevé. Quand la rage me prit de quitter Villers-Cotterêts et de venir à Paris, au lieu de me mettre, comme les autres, des lisières aux épaules et des entraves aux jambes, il me dit : « Va ! c’est la destinée qui te pousse ! » et il me donna, pour le général Foy, cette fameuse lettre qui m’ouvrit l’hôtel du général et les bureaux du duc d’Orléans.
Nous l’embrasserons bien fort, ce bon cher vieillard à qui nous devons tant, et nous continuerons notre chemin, qui nous conduira sur une grande route, au faîte d’une montagne.
Regarde, du haut de cette montagne, cette vallée, cette rivière et cette ville.
Cette vallée et cette rivière sont la vallée et la rivière d’Ouroy.
Cette ville, c’est La Ferté-Milon, la patrie de Racine.
Il est inutile que nous descendions cette pente et que nous entrions dans la ville : personne ne saurait nous y montrer la maison qu’habita le rival de Corneille, l’ingrat ami de Molière, le poète disgracié de Louis XIV.
Ses œuvres sont dans toutes les bibliothèques ; sa statue, œuvre de notre grand sculpteur David, est sur la place publique ; mais sa maison n’est nulle part, ou plutôt la ville tout entière, qui lui doit sa gloire, est sa maison.
Enfin, on sait que Racine naquit à La Ferté-Milon, tandis qu’on ignore où naquit Homère.
Voilà maintenant que nous marchons du midi au couchant. Ce joli village qui semble être sorti il n’y a qu’un instant de la forêt pour venir se chauffer au soleil, c’est Boursonne. Te rappelles-tu la Comtesse de Charny, un des livres de moi que tu préfères, cher enfant ? Eh bien ! alors, ce nom de Boursonne t’est familier. Ce petit château, habité par mon vieil ami Hutin, c’est celui d’Isidore Charny ; de ce château, le jeune gentilhomme sortait furtivement le soir, courbé sur le cou de son cheval anglais, et, en quelques minutes, il était de l’autre côté de la forêt, sous l’ombre projetée par ces peupliers : de là, il pouvait voir s’ouvrir et se fermer la fenêtre de Catherine. Une nuit, il rentra tout sanglant : une des balles du père Billot lui avait traversé le bras ; une autre lui avait labouré le flanc. Enfin, un jour, il sortit pour ne plus rentrer ; il allait accompagner le roi à Montmédy, et resta couché sur la place publique de Varennes, en face de la maison de l’épicier Sausse.
Nous avons traversé la forêt du midi au couchant, en passant par Le Plessis-aux-Bois, La Chapelle-aux-Auvergnats, et Coyolles ; encore quelques pas, et nous sommes en haut de la montagne de Vauciennes.
C’est à cent pas derrière nous qu’un jour, ou plutôt une nuit, en revenant de Crépy, je trouvai le cadavre d’un jeune homme de seize ans. J’ai raconté, dans mes Mémoires, ce sombre et mystérieux drame. Le moulin à vent qui s’élève à gauche de la route, et qui fait lentement et mélancoliquement tourner ses grandes ailes, sait seul, avec Dieu, comment les choses se sont passées. Tous deux sont restés muets ; la justice des hommes a frappé au hasard : par bonheur, l’assassin en mourant a avoué qu’elle frappait juste.
La crête de montagne que nous allons suivre, et qui domine cette grande plaine à notre droite, cette belle vallée à notre gauche, c’est le théâtre de mes exploits cynégétiques. Là, j’ai débuté dans la carrière des Nemrod et des Levaillant, les deux plus grands chasseurs, à ce que je me suis laissé dire, des temps antiques et des temps modernes. À droite, c’était le domaine des lièvres, des perdrix et des cailles ; à gauche, celui des canards sauvages, des sarcelles et des bécassines. Vois-tu cet endroit plus vert que les autres, qui semble un charmant gazon peint par Watteau ? C’est une tourbière où j’ai failli laisser mes os ; je m’y enfonçais tout doucement : par bonheur, j’eus l’idée de passer mon fusil entre mes deux jambes ; la crosse d’un côté, le bout du canon de l’autre, rencontrèrent un terrain un peu plus solide que celui où je commençais à m’engloutir ; je m’arrêtai dans cette descente verticale, qui ne pouvait manquer de me conduire tout droit aux enfers. Je criai : le meunier de ce moulin que tu aperçois d’ici, couché près de la vanne de ce grand étang, accourut à mes cris ; il me jeta la corde de son chien ; j’attrapai la corde ; il me tira à lui, et je fus sauvé. Quant à mon fusil, auquel je tenais beaucoup, qui tuait de très loin, et que je n’étais point assez riche pour remplacer, je n’eus qu’à serrer les jambes, et il fut sauvé avec moi.
Poursuivons notre chemin. Nous allons maintenant de l’occident au nord. Là-bas, cette ruine, dont un fragment se dresse pareil au donjon de Vincennes, c’est la tour de Vez, seul reste d’un manoir féodal abattu depuis longtemps. Cette tour, c’est le spectre en granit des temps passés ; elle appartient à mon ami Paillet. Tu te rappelles cet indulgent maître clerc qui venait avec moi, en chassant de Crépy à Paris, et dont le cheval, quand nous apercevions un garde champêtre ou particulier, avait la bonté d’emporter le chasseur, son fusil, ses lièvres, ses perdreaux, ses cailles, tandis que l’autre chasseur, touriste inoffensif, se promenait les mains dans ses poches, admirant le paysage et étudiant la botanique.
Ce petit château, c’est le château des Fossés. Là s’éveillèrent mes premières sensations ; de là datent mes premiers souvenirs. C’est aux Fossés que je vis mon père sortant de l’eau, d’où, avec l’aide d’Hippolyte, ce nègre intelligent qui, de peur de la gelée, jetait les fleurs et rentrait les pots, il venait de tirer trois jeunes gens qui se noyaient. L’un des trois, celui qu’avait sauvé mon père, s’appelait Dupuy ; c’est le seul nom que je me rappelle. Hippolyte, excellent nageur, avait sauvé les deux autres.
Là cohabitaient Moquet, le garde champêtre cauchemardé qui mettait un piège sur sa poitrine pour prendre la mère Durand, et Pierre le jardinier, qui coupait en deux, avec sa bêche, des couleuvres du ventre desquelles sortaient des grenouilles toutes vivantes ; là, enfin, vieillissait majestueusement le vieux Truff, quadrupède non classé par monsieur de Buffon, moitié chien, moitié ours, sur le dos duquel on me plaçait à califourchon, et qui me permit de prendre mes premières leçons de haute école.
Maintenant, dans la direction du nord-ouest, voici Haramont, charmant village perdu sous ses pommiers, au milieu d’une clairière de la forêt, et illustré par la naissance de l’honnête Ange Pitou, le neveu de la tante Angélique, l’élève de l’abbé Fortier, le condisciple du jeune Gilbert, et le compagnon d’armes du patriote Billot. Cette illustration, contestée par des gens qui prétendent, avec quelque raison peut-être, que Pitou n’a jamais existé que dans mon imagination, étant la seule que puisse revendiquer Haramont, continuons notre route jusqu’à cette double mare du chemin de Compiègne et du chemin de Vivières, près de laquelle je reçus l’hospitalité de Boudoux, le jour où je m’enfuis de la maison maternelle pour ne pas aller au séminaire de Soissons, où j’eusse probablement été tué deux ou trois ans...