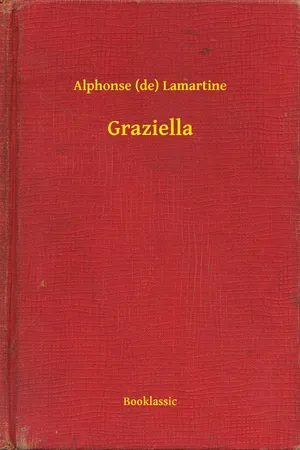À dix-huit ans, ma famille me confia aux soins d’une de mes parentes que des affaires appelaient en Toscane, où elle allait accompagnée de son mari. C’était une occasion de me faire voyager et de m’arracher à cette oisiveté dangereuse de la maison paternelle et des villes de province, où les premières passions de l’âme se corrompent faute d’activité. Je partis avec l’enthousiasme d’un enfant qui va voir se lever le rideau des plus splendides scènes de la nature et de la vie.
Les Alpes, dont je voyais de loin, depuis mon enfance, briller les neiges éternelles, à l’extrémité de l’horizon, du haut de la colline de Milly ; la mer dont les voyageurs et les poëtes avaient jeté dans mon esprit tant d’éclatantes images ; le ciel italien, dont j’avais, pour ainsi dire, aspiré déjà la chaleur et la sérénité dans les pages de Corinne et dans les vers de Gœthe :
Connais-tu cette terre où les myrtes fleurissent ?
les monuments encore debout de cette antiquité romaine, dont mes études toutes fraîches avaient rempli ma pensée ; la liberté enfin ; la distance qui jette un prestige sur les choses éloignées ; les aventures, ces accidents certains des longs voyages, que l’imagination jeune prévoit, combine à plaisir et savoure d’avance ; le changement de langue, de visages, de mœurs, qui semble initier l’intelligence à un monde nouveau, tout cela fascinait mon esprit. Je vécus dans un état constant d’ivresse pendant les longs jours d’attente qui précédèrent le départ. Ce délire, renouvelé chaque jour par les magnificences de la nature en Savoie, en Suisse, sur le lac de Genève, sur les glaciers du Simplon, au lac de Côme, à Milan et à Florence, ne retomba qu’à mon retour.
Les affaires qui avaient conduit ma compagne de voyage à Livourne se prolongeant indéfiniment, on parla de me ramener en France sans avoir vu Rome et Naples. C’était m’arracher mon rêve au moment où j’allais le saisir. Je me révoltai intérieurement contre une pareille idée. J’écrivis à mon père pour lui demander l’autorisation de continuer seul mon voyage en Italie, et, sans attendre la réponse, que je n’espérais guère favorable, je résolus de prévenir la désobéissance par le fait. « Si la défense arrive, me disais-je, elle arrivera trop tard. Je serai réprimandé, mais je serai pardonné ; je reviendrai, mais j’aurai vu. » Je fis la revue de mes finances très-restreintes ; mais je calculai que j’avais un parent de ma mère établi à Naples, et qu’il ne me refuserait pas quelque argent pour le retour. Je partis, une belle nuit, de Livourne, par le courrier de Rome.
J’y passai l’hiver seul dans une petite chambre d’une rue obscure qui débouche sur la place d’Espagne, chez un peintre romain qui me prit en pension dans sa famille. Ma figure, ma jeunesse, mon enthousiasme, mon isolement au milieu d’un pays inconnu, avaient intéressé un de mes compagnons de voyage dans la route de Florence à Rome. Il s’était lié d’une amitié soudaine avec moi. C’était un beau jeune homme à peu près de mon âge. Il paraissait être le fils ou le neveu du fameux chanteur David, alors le premier ténor des théâtres d’Italie. David voyageait aussi avec nous. C’était un homme d’un âge déjà avancé. Il allait chanter pour la dernière fois sur le théâtre Saint-Charles, à Naples.
David me traitait en père, et son jeune compagnon me comblait de prévenances et de bontés. Je répondais à ces avances avec l’abandon et la naïveté de mon âge. Nous n’étions pas encore arrivés à Rome que le beau voyageur et moi nous étions déjà inséparables. Le courrier, dans ce temps-là, ne mettait pas moins de trois jours pour aller de Florence à Rome. Dans les auberges, mon nouvel ami était mon interprète ; à table, il me servait le premier ; dans la voiture, il me ménageait à côté de lui la meilleure place, et, si je m’endormais, j’étais sûr que ma tête aurait son épaule pour oreiller.
Quand je descendais de voiture aux longues montées des collines de la Toscane ou de la Sabine, il descendait avec moi, m’expliquait le pays, me nommait les villes, m’indiquait les monuments. Il cueillait même de belles fleurs et achetait de belles figues et de beaux raisins sur la route ; il remplissait de ces fruits mes mains et mon chapeau. David semblait voir avec plaisir l’affection de son compagnon de voyage pour le jeune étranger. Ils se souriaient quelquefois en me regardant d’un air d’intelligence, de finesse et de bonté.
Arrivés à Rome la nuit, je descendis tout naturellement dans la même auberge qu’eux. On me conduisit dans ma chambre ; je ne me réveillai qu’à la voix de mon jeune ami qui frappait à ma porte et qui m’invitait à déjeuner. Je m’habillai à la hâte et je descendis dans la salle où les voyageurs étaient réunis. J’allais serrer la main de mon compagnon de voyage et je le cherchais en vain des yeux parmi les convives, quand un rire général éclata sur tous les visages. Au lieu du fils ou du neveu de David, j’aperçus à côté de lui une charmante figure de jeune fille romaine élégamment vêtue et dont les cheveux noirs, tressés en bandeaux autour du front, étaient rattachés derrière par deux longues épingles d’or à têtes de perles, comme les portent encore les paysannes de Tivoli. C’était mon ami qui avait repris, en arrivant à Rome, son costume et son sexe.
J’aurais dû m’en douter à la tendresse de son regard et à la grâce de son sourire. Mais je n’avais eu aucun soupçon. « L’habit ne change pas le cœur, me dit en rougissant la belle Romaine ; seulement vous ne dormirez plus sur mon épaule, et, au lieu de recevoir de moi des fleurs, c’est vous qui m’en donnerez. Cette aventure vous apprendra à ne pas vous fier aux apparences d’amitié qu’on aura pour vous plus tard ; cela pourrait bien être autre chose. »
La jeune fille était une cantatrice, élève et favorite de David. Le vieux chanteur la conduisait partout avec lui, il l’habillait en homme pour éviter les commentaires sur la route. Il la traitait en père plus qu’en protecteur, et n’était nullement jaloux des douces et innocentes familiarités qu’il avait laissées lui-même s’établir entre nous.