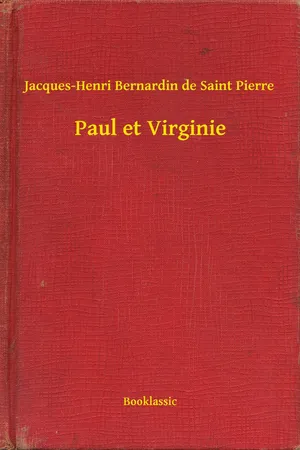Sur le côté oriental de la montagne qui s’élève derrière le Port Louis de Île de France, on voit, dans un terrain jadis cultivé, les ruines de deux petites cabanes. Elles sont situées presque au milieu d’un bassin formé par de grands rochers, qui n’a qu’une seule ouverture tournée au nord. On aperçoit à gauche la montagne appelée le Morne de la Découverte, d’où l’on signale les vaisseaux qui abordent dans l’île, et au bas de cette montagne la ville nommée le Port Louis ; à droite, le chemin qui mène du Port Louis au quartier des Pamplemousses ; ensuite l’église de ce nom, qui s’élève avec ses avenues de bambous au milieu d’une grande plaine ; et plus loin une forêt qui s’étend jusqu’aux extrémités de l’île. On distingue devant soi, sur les bords de la mer, la Baie du Tombeau ; un peu sur la droite, le Cap Malheureux ; et au-delà, la pleine mer, où paraissent à fleur d’eau quelques îlots inhabités, entre autres le Coin de Mire, qui ressemble à un bastion au milieu des flots.
À l’entrée de ce bassin, d’où l’on découvre tant d’objets, les échos de la montagne répètent sans cesse le bruit des vents qui agitent les forêts voisines, et le fracas des vagues qui brisent au loin sur les récifs ; mais au pied même des cabanes on n’entend plus aucun bruit, et on ne voit autour de soi que de grands rochers escarpés comme des murailles. Des bouquets d’arbres croissent à leurs bases, dans leurs fentes, et jusque sur leurs cimes, où s’arrêtent les nuages. Les pluies que leurs pitons attirent peignent souvent les couleurs de l’arc-en-ciel sur leurs flancs verts et bruns, et entretiennent à leurs pieds les sources dont se forme la petite Rivière des Lataniers. Un grand silence règne dans leur enceinte, où tout est paisible, l’air, les eaux et la lumière. À peine l’écho y répète le murmure des palmistes qui croissent sur leurs plateaux élevés, et dont on voit les longues flèches toujours balancées par les vents. Un jour doux éclaire le fond de ce bassin, où le soleil ne luit qu’à midi ; mais dès l’aurore ses rayons en frappent le couronnement, dont les pics s’élevant au-dessus des ombres de la montagne, paraissent d’or et de pourpre sur l’azur des cieux.
J’aimais à me rendre dans ce lieu où l’on jouit à la fois d’une vue immense et d’une solitude profonde. Un jour que j’étais assis au pied de ces cabanes, et que j’en considérais les ruines, un homme déjà sur l’âge vint à passer aux environs. Il était, suivant la coutume des anciens habitants, en petite veste et en long caleçon. Il marchait nu-pieds, et s’appuyait sur un bâton de bois d’ébène. Ses cheveux étaient tout blancs, et sa physionomie noble et simple. Je le saluai avec respect. Il me rendit mon salut, et m’ayant considéré un moment, il s’approcha de moi, et vint se reposer sur le tertre où j’étais assis. Excité par cette marque de confiance, je lui adressai la parole : « Mon père, lui dis-je, pourriez-vous m’apprendre à qui ont appartenu ces deux cabanes ? » Il me répondit : « Mon fils, ces masures et ce terrain inculte étaient habités, il y a environ vingt ans, par deux familles qui y avaient trouvé le bonheur. Leur histoire est touchante : mais dans cette île, située sur la route des Indes, quel Européen peut s’intéresser au sort de quelques particuliers obscurs ? Qui voudrait même y vivre heureux, mais pauvre et ignoré ? Les hommes ne veulent connaître que l’histoire des grands et des rois, qui ne sert à personne. – Mon père, repris-je, il est aisé de juger à votre air et à votre discours que vous avez acquis une grande expérience. Si vous en avez le temps, racontez-moi, je vous prie, ce que vous savez des anciens habitants de ce désert, et croyez que l’homme même le plus dépravé par les préjugés du monde aime à entendre parler du bonheur que donnent la nature et la vertu. » Alors, comme quelqu’un qui cherche à se rappeler diverses circonstances, après avoir appuyé quelque temps ses mains sur son front, voici ce que ce vieillard me raconta.
En 1726 un jeune homme de Normandie, appelé M. de la Tour, après avoir sollicité en vain du service en France et des secours dans sa famille, se détermina à venir dans cette île pour y chercher fortune. Il avait avec lui une jeune femme qu’il aimait beaucoup et dont il était également aimé. Elle était d’une ancienne et riche maison de sa province ; mais il l’avait épousée en secret et sans dot, parce que les parents de sa femme s’étaient opposés à son mariage, attendu qu’il n’était pas gentilhomme. Il la laissa au Port Louis de cette île, et il s’embarqua pour Madagascar dans l’espérance d’y acheter quelques Noirs, et de revenir promptement ici former une habitation. Il débarqua à Madagascar vers la mauvaise saison qui commence à la mi-octobre ; et peu de temps après son arrivée il y mourut des fièvres pestilentielles qui y règnent pendant six mois de l’année, et qui empêcheront toujours les nations européennes d’y faire des établissements fixes. Les effets qu’il avait emportés avec lui furent dispersés après sa mort, comme il arrive ordinairement à ceux qui meurent hors de leur patrie. Sa femme, restée à Île de France, se trouva veuve, enceinte, et n’ayant pour tout bien au monde qu’une négresse, dans un pays où elle n’avait ni crédit ni recommandation. Ne voulant rien solliciter auprès d’aucun homme après la mort de celui qu’elle avait uniquement aimé, son malheur lui donna du courage. Elle résolut de cultiver avec son esclave un petit coin de terre, afin de se procurer de quoi vivre.
Dans une île presque déserte dont le terrain était à discrétion elle ne choisit point les cantons les plus fertiles ni les plus favorables au commerce ; mais cherchant quelque gorge de montagne, quelque asile caché où elle pût vivre seule et inconnue, elle s’achemina de la ville vers ces rochers pour s’y retirer comme dans un nid. C’est un instinct commun à tous les êtres sensibles et souffrants de se réfugier dans les lieux les plus sauvages et les plus déserts ; comme si des rochers étaient des remparts contre l’infortune, et comme si le calme de la nature pouvait apaiser les troubles malheureux de l’âme. Mais la Providence, qui vient à notre secours lorsque nous ne voulons que les biens nécessaires, en réservait un à madame de la Tour que ne donnent ni les richesses ni la grandeur ; c’était une amie.
Dans ce lieu depuis un an demeurait une femme vive, bonne et sensible ; elle s’appelait Marguerite. Elle était née en Bretagne d’une simple famille de paysans, dont elle était chérie, et qui l’aurait rendue heureuse, si elle n’avait eu la faiblesse d’ajouter foi à l’amour d’un gentilhomme de son voisinage qui lui avait promis de l’épouser ; mais celui-ci ayant satisfait sa passion s’éloigna d’elle, et refusa même de lui assurer une subsistance pour un enfant dont il l’avait laissée enceinte. Elle s’était déterminée alors à quitter pour toujours le village où elle était née, et à aller cacher sa faute aux colonies, loin de son pays, où elle avait perdu la seule dot d’une fille pauvre et honnête, la réputation. Un vieux Noir, qu’elle avait acquis de quelques deniers empruntés, cultivait avec elle un petit coin de ce canton.
Madame de la Tour, suivie de sa négresse, trouva dans ce lieu Marguerite qui allaitait son enfant. Elle fut charmée de rencontrer une femme dans une position qu’elle jugea semblable à la sienne. Elle lui parla en peu de mots de sa condition passée et de ses besoins présents. Marguerite au récit de madame de la Tour fut émue de pitié ; et, voulant mériter sa confiance plutôt que son estime, elle lui avoua sans lui rien déguiser l’imprudence dont elle s’était rendue coupable.
« Pour moi, dit-elle, j’ai mérité mon sort ; mais vous, madame…, vous, sage et malheureuse ! » Et elle lui offrit en pleurant sa cabane et son amitié. Madame de la Tour, touchée d’un accueil si tendre, lui dit en la serrant dans ses bras : « Ah ! Dieu veut finir mes peines, puisqu’il vous inspire plus de bonté envers moi qui vous suis étrangère, que jamais je n’en ai trouvé dans mes parents. »
Je connaissais Marguerite, et quoique je demeure à une lieue et demie d’ici, dans les bois, derrière la Montagne Longue, je me regardais comme son voisin. Dans les villes d’Europe une rue, un simple mur, empêchent les membres d’une même famille de se réunir pendant des années entières ; mais dans les colonies nouvelles on considère comme ses voisins ceux dont on n’est séparé que par des bois et par des montagnes. Dans ce temps-là surtout, où cette île faisait peu de commerce aux Indes, le simple voisinage y était un titre d’amitié, et l’hospitalité envers les étrangers un devoir et un plaisir. Lorsque j’appris que ma voisine avait une compagne, je fus la voir pour tâcher d’être utile à l’une et à l’autre. Je trouvai dans madame de la Tour une personne d’une figure intéressante, pleine de noblesse et de mélancolie. Elle était alors sur le point d’accoucher. Je dis à ces deux dames qu’il convenait, pour l’intérêt de leurs enfants, et surtout pour empêcher l’établissement de quelque autre habitant, de partager entre elles le fond de ce bassin, qui contient environ vingt arpents. Elles s’en rapportèrent à moi pour ce partage. J’en formai deux portions à peu près égales ; l’une renfermait la partie supérieure de cette enceinte, depuis ce piton de rocher couvert de nuages, d’où sort la source de la Rivière des Lataniers, jusqu’à cette ouverture escarpée que vous voyez au haut de la montagne, et qu’on appelle l’Embrasure, parce qu’elle ressemble en effet à une embrasure de canon. Le fond de ce sol est si rempli de roches et de ravins qu’à peine on y peut marcher ; cependant il produit de grands arbres, et il est rempli de fontaines et de petits ruisseaux. Dans l’autre portion je compris toute la partie inférieure qui s’étend le long de la Rivière des Lataniers jusqu’à l’ouverture où nous sommes, d’où cette rivière commence à couler entre deux collines jusqu’à la mer. Vous y voyez quelques lisières de prairies, et un terrain assez uni, mais qui n’est guère meilleur que l’autre ; car dans la saison des pluies il est marécageux, et dans les sécheresses il est dur comme du plomb ; quand on y veut alors ouvrir une tranchée, on est obligé de le couper avec des haches. Après avoir fait ces deux partages j’engageai ces deux dames à les tirer au sort. La partie supérieure échut à madame de la Tour, et l’inférieure à Marguerite. L’une et l’autre furent contentes de leur lot ; mais elles me prièrent de ne pas séparer leur demeure, « afin, me dirent-elles, que nous puissions toujours nous voir, nous parler et nous entraider ». Il fallait cependant à chacune d’elles une retraite particulière. La case de Marguerite se trouvait au milieu du bassin précisément sur les limites de son terrain. Je bâtis tout auprès, sur celui de madame de la Tour, une autre case, en sorte que ces deux amies étaient à la fois dans le voisinage l’une de l’autre et sur la propriété de leurs familles. Moi-même j’ai coupé des palissades dans la montagne ; j’ai apporté des feuilles de latanier des bords de la mer pour construire ces deux cabanes, où vous ne voyez plus maintenant ni porte ni couverture. Hélas ! il n’en reste encore que trop pour mon souvenir ! Le temps, qui détruit si rapidement les monuments des empires, semble respecter dans ces déserts ceux de l’amitié, pour perpétuer mes regrets jusqu’à la fin de ma vie. À peine la seconde de ces cabanes était achevée que madame de la Tour accoucha d’une fille. J’avais été le parrain de l’enfant de Marguerite, qui s’appelait Paul. Madame de la Tour me pria aussi de nommer sa fille conjointement avec son amie. Celle-ci lui donna le nom de Virginie. « Elle sera vertueuse, dit-elle, et elle sera heureuse. Je n’ai connu le malheur qu’en m’écartant de la vertu ».
Lorsque madame de la Tour fut relevée de ses couches, ces deux petites habitations commencèrent à être de quelque rapport, à l’aide des soins que j’y donnais de temps en temps, mais surtout par les travaux assidus de leurs esclaves. Celui de Marguerite, appelé Domingue, était un Noir yolof,encore robuste, quoique déjà sur l’âge. Il avait de l’expérience et un bon sens naturel. Il cultivait indifféremment sur les deux habitations les terrains qui lui semblaient les plus fertiles, et il y mettait les semences qui leur convenaient le mieux. Il semait du petit mil et du maïs dans les endroits médiocres, un peu de froment dans les bonnes terres, du riz dans les fonds marécageux ; et au pied des roches, des giraumons, des courges et des concombres, qui se plaisent à y grimper. Il plantait dans les lieux secs des patates qui y viennent très sucrées, des cotonniers sur les hauteurs, des cannes à sucre dans les terres fortes, des pieds de café sur les collines, où le grain est petit, mais excellent ; le long de la rivière et autour des cases, des bananiers qui donnent toute l’année de longs régimes de fruits avec un bel ombrage, et enfin quelques plantes de tabac pour charmer ses soucis et ceux de ses bonnes maîtresses. Il allait couper du bois à brûler dans la montagne, et casser des roches çà et là dans les habitations pour en aplanir les chemins. Il faisait tous ces ouvrages avec intelligence et activité, parce qu’il les faisait avec zèle. Il était fort attaché à Marguerite ; et il ne l’était guère moins à madame de la Tour, dont il avait épousé la négresse à la naissance de Virginie. Il aimait passionnément sa femme, qui s’appelait Marie. Elle était née à Madagascar, d’où elle avait apporté quelque industrie, surtout celle de faire des paniers et des étoffes appelées pagnes, avec des herbes qui croissent dans les bois. Elle était adroite, propre, et très fidèle. Elle avait soin de préparer à manger, d’élever quelques poules, et d’aller de temps en temps vendre au Port Louis le superflu de ces deux habitations, qui était bien peu considérable. Si vous y joignez deux chèvres élevées près des enfants, et un gros chien qui veillait la nuit au-dehors, vous aurez une idée de tout le revenu et de tout le domestique de ces deux petites métairies.
Pour ces deux amies, elles filaient du matin au soir du coton. Ce travail suffisait à leur entretien et à celui de leurs familles ; mais d’ailleurs elles étaient si dépourvues de commodités étrangères qu’elles marchaient nu-pieds dans leur habitation, et ne portaient de souliers que pour aller le dimanche de grand matin à la messe à l’église des Pamplemousses que vous voyez là-bas. Il y a cependant bien plus loin qu’au Port Louis ; mais elles se rendaient rarement à la ville, de peur d’y être méprisées, parce qu’elles étaient vêtues de grosse toile bleue du Bengale comme des esclaves. Après tout, la considération publique vaut-elle le bonheur domestique ? Si ces dames avaient un peu à souffrir au-dehors, elles rentraient chez elles avec d’autant plus de plaisir. À peine Marie et Domingue les apercevaient de cette hauteur sur le chemin des Pamplemousses, qu’ils accouraient jusqu’au bas de la montagne pour les aider à la remonter. Elles lisaient dans les yeux de leurs esclaves la joie qu’ils avaient de les revoir. Elles trouvaient chez elles la propreté, la liberté, des biens qu’elles ne devaient qu’à leurs propres travaux, et des serviteurs pleins de zèle et d’affection. Elles-mêmes, unies par les mêmes besoins, ayant éprouvé des maux presque semblables, se donnant les doux noms d’amie, de compagne et de sœur, n’avaient qu’une volonté, qu’un intérêt, qu’une table. Tout entre elles était commun. Seulement si d’anciens feux plus vifs que ceux de l’amitié se réveillaient dans leur âme, une religion pure, aidée par des mœurs chastes, les dirigeait vers une autre vie, comme la flamme qui s’envole vers le ciel lorsqu’elle n’a plus d’aliment sur la terre.
Les devoirs de la nature ajoutaient encore au bonheur de leur société. Leur amitié mutuelle redoublait à la vue de leurs enfants, fruits d’un amour également infortuné. Elles prenaient plaisir à les mettre ensemble dans le même bain, et à les coucher dans le même berceau. Souvent elles les changeaient de lait. « Mon amie, disait madame de la Tour, chacune de nous aura deux enfants, et chacun de nos enfants aura deux mères. » Comme deux bourgeons qui restent sur deux arbres de la même espèce, dont la tempête a brisé toutes les branches, viennent à produire des fruits plus doux, si chacun d’eux, détaché du tronc maternel, est greffé sur le tronc voisin ; ainsi ces deux petits enfants, privés de tous leurs parents, se remplissaient de sentiments plus tendres que ceux de fils et de fille, de frère et de sœur, quand ils venaient à être changés de mamelles par les deux amies qui leur avaient donné le jour. Déjà leurs mères parlaient de leur mariage sur leurs berceaux, et cette perspective de félicité conjugale, dont elles charmaient leurs propres peines, finissait bien souvent par les faire pleurer ; l’une se rappelant que ses maux étaient venus d’avoir négligé l’hymen, et l’autre d’en avoir subi les lois ; l’une, de s’être élevée au-dessus de sa condition, et l’autre d’en être descendue : mais elles se consolaient en pensant qu’un jour leurs enfants, plus heureux, jouiraient à la fois, loin les cruels préjugés de l’Europe, des plaisirs de l’amour et du bonheur de l’égalité.
Rien en effet n’était comparable à l’attachement qu’ils se témoignaient déjà. Si Paul venait à se plaindre, on lui montrait Virginie ; à sa vue il souriait et s’apaisait. Si Virginie souffrait, on en était averti par les cris de Paul ; mais cette aimable fille dissimulait aussitôt son mal pour qu’il ne souffrît pas de sa douleur. Je n’arrivais point de fois ici que je ne les visse tous deux tout nus, suivant la coutume du pays, pouvant à peine marcher, se tenant ensemble par les mains et sous les bras, comme on représente la constellation des Gémeaux. La nuit même ne pouvait les séparer ; elle les surprenait souvent couchés dans le même berceau, joue contre joue, poitrine contre poitrine, les mains passées mutuellement autour de leurs cous, et endormis dans les bras l’un de l’autre.
Lorsqu’ils surent parler, les premiers noms qu’ils apprirent à se donner furent ceux de frère et de sœur. L’enfance, qui connaît des caresses plus tendres, ne connaît point de plus doux noms. Leur éducation ne fit que redoubler leur amitié en la dirigeant vers leurs besoins réciproques. Bientôt tout ce qui regarde l’économie, la propreté, le soin de préparer un repas champêtre, fut du ressort de Virginie, et ses travaux étaient toujours suivis des louanges et des baisers de son frère. Pour lui, sans cesse en action, il bêchait le jardin avec Domingue, ou, une petite hache à la main, il le suivait dans les bois ; et si dans ces courses une belle fleur, un bon fruit, ou un nid d’oiseaux se présentaient à lui, eussent-ils été au haut d’un arbre, il l’escaladait pour les apporter à sa sœur.
Quand on en rencontrait un quelque part on était sûr que l’autre n’était pas loin. Un jour que je descendais du sommet de cette montagne, j’aperçus à l’extrémité du jardin Virginie qui accourait vers la maison, la tête couverte de son jupon qu’elle avait relevé par derrière, pour se mettre à l’abri d’une ondée de pluie. De loin je la crus seule ; et m’étant avancé vers elle pour l’aider à marcher, je vis qu’elle tenait Paul par le bras, enveloppé presque en entier de la même couverture, riant l’un et l’autre d’être ensemble à l’abri sous un parapluie de leur invention. Ces deux têtes charmantes renfermées sous ce jupon bouffant me rappelèrent les enfants de Léda enclos dans la même coquille.
Toute leur étude était de se complaire et de s’entraider. Au reste ils étaient ignorants comme des Créoles, et ne savaient ni lire ni écrire. Ils ne s’inquiétaient pas de ce qui s’était passé dans des temps reculés et loin d’eux ; leur curiosité ne s’étendait pas au-delà de cette montagne. Ils croyaient que le monde finissait où finissait leur île ; et ils n’imaginaient rien d’aimable où ils n’étaient pas. Leur affection mutuelle et celle de leurs mères occupaient toute l’activité de leurs âmes. Jamais des sciences inutiles n’avaient fait couler leurs larmes ; jamais les leçons d’une triste morale ne les avaient remplis d’ennui. Ils ne savaient pas qu’il ne faut pas dérober, tout chez eux étant commun ; ni être intempérant, ayant à discrétion des mets simples ; ni menteur, n’ayant aucune vérité à dissimuler. On ne les avait jamais effrayés en leur disant que Dieu réserve des punitions terribles aux enfants ingrats ; chez eux l’amitié filiale était née de l’amitié maternelle. On ne leur avait appris de la religion que ce qui la fait aimer ; et s’ils n’offraient pas à l’église de longues prières, partout où ils étaient, dans la maison, dans les champs, dans les bois, ils levaient vers le ciel des mains innocentes et un cœur plein de l’amour de leurs parents.
Ainsi se passa leur première enfance comme une belle aube qui annonce un plus beau jour. Déjà ils partageaient avec leurs mères tous les soins du ménage. Dès que le chant du coq annonçait le retour de l’aurore, Virginie se levait, allait puiser de l’eau à la source voisine, et rentrait dans la maison pour préparer le déjeuner. Bientôt après, quand le soleil dorait les pitons de cette enceinte, Marguerite et son fils se rendaient chez madame de la Tour : alors ils commençaient tous ensemble une prière suivie du premier repas ; souvent ils le prenaient devant la porte, assis sur l’herbe sous un berceau de bananiers, qui leur fournissait à la fois des mets tout préparés dans leurs fruits substantiels, et du linge de table dans leurs feuilles larges, longues, et lustrées. Une nourriture saine et abo...