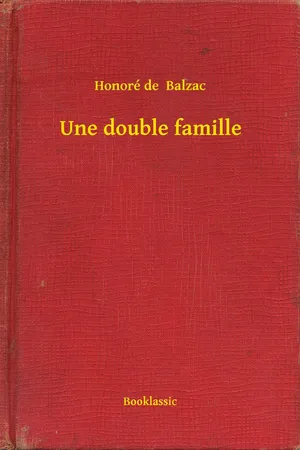A MADAME LA COMTESSE LOUISE DE TURHEIM,
Comme une marque du souvenir et de l'affectueux respect de son humble serviteur,
DE BALZAC.
La rue du Tourniquet-Saint-Jean, naguère une des rues les plus tortueuses et les plus obscures du vieux quartier qui entoure l'Hôtel-de-Ville, serpentait le long des petits jardins de la Préfecture de Paris et venait aboutir dans la rue du Martroi, précisément à l'angle d'un vieux mur maintenant abattu. En cet endroit se voyait le tourniquet auquel cette rue a dû son nom, et qui ne fut détruit qu'en 1823, lorsque la ville de Paris fit construire, sur l'emplacement d'un jardinet dépendant de l'Hôtel-de-Ville, une salle de bal pour la fête donnée au duc d'Angoulême à son retour d'Espagne. La partie la plus large de la rue du Tourniquet était à son débou- ché dans la rue de la Tixeranderie, où elle n'avait que cinq pieds de largeur. Aussi, par les temps pluvieux, des eaux noirâtres baignaient-elles promptement le pied des vieilles maisons qui bordaient cette rue, en entraînant les ordures déposées par chaque ménage au coin des bornes. Les tombereaux ne pouvant point passer par-là, les habitants comptaient sur les orages pour nettoyer leur rue toujours boueuse, et comment aurait-elle été propre ? lorsqu'en été le soleil dardait en aplomb ses rayons sur Paris, une nappe d'or, aussi tranchante que la lame d'un sabre, illuminait momentanément les ténèbres de cette rue sans pouvoir sécher l'humidité permanente qui régnait depuis le rez-de-chaussée jusqu'au premier étage de ces maisons noires et silencieuses. Les habitants, qui au mois de juin allumaient leurs lampes à cinq heures du soir, ne les éteignaient jamais en hiver. Encore aujourd'hui, si quelque courageux piéton veut aller du Marais sur les quais, en prenant, au bout de la rue du Chaume, les rues de l'Homme-Armé, des Billettes et des Deux-Portes qui mènent à celle du Tourniquet-Saint-Jean, il croira n'avoir marché que sous des caves. Presque toutes les rues de l'ancien Paris, dont les chroniques ont tant vanté la splendeur, ressemblaient à ce dédale humide et sombre où les antiquaires peuvent encore admirer quelques singularités historiques. Ainsi, quand la maison qui occupait le coin formé par les rues du Tourniquet et de la Tixeranderie subsistait, les observateurs y remarquaient les vestiges de deux gros anneaux de fer scellés dans le mur, un reste de ces chaînes que le quartenier faisait jadis tendre tous les soirs pour la sûreté publique. Cette maison, remarquable par son antiquité, avait été bâtie avec des précautions qui attestaient l'insalubrité de ces anciens logis, car pour assainir le rez-de-chaussée, on avait élevé les berceaux de la cave à deux pieds environ au-dessus du sol, ce qui obligeait à monter trois marches pour entrer dans la maison. Le chambranle de la porte bâtarde décrivait un cintre plein, dont la clef était ornée d'une tête de femme et d'arabesques rongés par le temps. Trois fenêtres, dont les appuis se trouvaient à hauteur d'homme, appartenaient à un petit appartement situé dans la partie de ce rez-de-chaussée qui donnait sur la rue du Tourniquet d'où il tirait son jour. Ces croisées dégradées étaient défendues par de gros barreaux en fer très-espacés et finissant par une saillie ronde semblable à celle qui termine les grilles des boulangers. Si pendant la journée quelque passant curieux jetait les yeux sur les deux chambres dont se composait cet appartement, il lui était impossible d'y rien voir, car pour découvrir dans la seconde chambre deux lits en serge verte réunis sous la boiserie d'une vieille alcôve, il fallait le soleil du mois de juillet ; mais le soir, vers les trois heures, une fois la chandelle allumée, on pouvait apercevoir, à travers la fenêtre de la première pièce, une vieille femme assise sur une escabelle au coin d'une cheminée où elle attisait un réchaud sur lequel mijotait un de ces ragoûts semblables à ceux que savent faire les portières. Quelques rares ustensiles de cuisine ou de ménage accrochés au fond de cette salle se dessinaient dans le clair-obscur. A cette heure, une vieille table, posée sur une X, mais dénuée de linge, était garnie de quelques couverts d'étain et du plat cuisiné par la vieille. Trois méchantes chaises meublaient cette pièce, qui servait à la fois de cuisine et de salle à manger. Au-dessus de la cheminée s'élevaient un fragment de miroir, un briquet, trois verres, des allumettes et un grand pot blanc tout ébréché. Le carreau de la chambre, les ustensiles, la cheminée, tout plaisait néanmoins par l'esprit d'ordre et d'économie que respirait cet asile sombre et froid. Le visage pâle et ridé de la vieille femme était en harmonie avec l'obscurité de la rue et la rouille de la maison. A la voir au repos, sur sa chaise, on eût dit qu'elle tenait à cette maison comme un colimaçon tient à sa coquille brune ; sa figure, où je ne sais quelle vague expression de malice perçait à travers une bonhomie affectée, était couronnée par un bonnet de tulle rond et plat qui cachait assez mal des cheveux blancs ; ses grands yeux gris étaient aussi calmes que la rue, et les rides nombreuses de son visage pouvaient se comparer aux crevasses des murs. Soit qu'elle fût née dans la misère, soit qu'elle fût déchue d'une splendeur passée, elle paraissait résignée depuis long-temps à sa triste existence. Depuis le lever du soleil jusqu'au soir, excepté les moments où elle préparait les repas et ceux où chargée d'un panier elle s'absentait pour aller chercher les provisions, cette vieille femme demeurait dans l'autre chambre devant la dernière croisée, en face d'une jeune fille. A toute heure du jour les passants apercevaient cette jeune ouvrière, assise dans un vieux fauteuil de velours rouge, le cou penché sur un métier à broder, travaillant avec ardeur. Sa mère avait un tambour vert sur les genoux et s'occupait à faire du tulle ; mais ses doigts remuaient péniblement les bobines ; sa vue était affaiblie, car son nez sexagénaire portait une paire de ces antiques lunettes qui tiennent sur le bout des narines par la force avec laquelle elles les compriment. Quand venait le soir, ces deux laborieuses créatures plaçaient entre elles une lampe dont la lumière, passant à travers deux globes de verre remplis d'eau, jetait sur leur ouvrage une forte lueur qui permettait à l'une de voir les fils les plus déliés fournis par les bobines de son tambour, et à l'autre les dessins les plus délicats tracés sur l'étoffe qu'elle brodait. La courbure des barreaux avait permis à la jeune fille de mettre sur l'appui de la fenêtre une longue caisse en bois pleine de terre où végétaient des pois de senteur, des capucines, un petit chèvrefeuille malingre et des volubilis dont les tiges débiles grimpaient autour des barreaux. Ces plantes presque étiolées produisaient de pâles fleurs, harmonie de plus qui mêlait je ne sais quoi de triste et de doux dans le tableau présenté par cette croisée, dont la baie encadrait bien ces deux figures. A l'aspect fortuit de cet intérieur, le passant le plus égoïste emportait une image complète de la vie que mène à Paris la classe ouvrière, car la brodeuse ne paraissait vivre que de son aiguille. Bien des gens n'atteignaient pas le tourniquet sans s'être demandé comment une jeune fille pouvait conserver des couleurs en vivant dans cette cave. Un étudiant passait-il par là pour gagner le pays latin, sa vive imagination lui faisait déplorer cette vie obscure et végétative, semblable à celle du lierre qui tapisse de froides murailles, ou à celle de ces paysans voués au travail, et qui naissent, labourent, meurent ignorés du monde qu'ils ont nourri. Un rentier se disait après avoir examiné la maison avec l'oeil d'un propriétaire : – Que deviendront ces deux femmes si la broderie vient à n'être plus de mode ? Parmi les gens qu'une place à l'Hôtel-de-Ville ou au Palais forçait à passer par cette rue à des heures fixes, soit pour se rendre à leurs affaires, soit pour retourner dans leurs quartiers respectifs, peut-être se trouvait-il quelque cœur charitable. Peut-être un homme veuf ou un Adonis de quarante ans, à force de sonder les replis de cette vie malheureuse, comptait-il sur la détresse de la mère et de la fille pour posséder à bon marché l'innocente ouvrière dont les mains agiles et potelées, le cou frais et la peau blanche, attrait dû sans doute à l'habitation de cette rue sans soleil, excitaient son admiration. Peut-être aussi quelque honnête employé à douze cents francs d'appointements, témoin journalier de l'ardeur que cette jeune fille por- tait au travail, estimateur de ses mœurs pures, attendait-il de l'avancement pour unir une vie obscure à une vie obscure, un labeur obstiné à un autre, apportant au moins et un bras d'homme pour soutenir cette existence, et un paisible amour, décoloré comme les fleurs de la croisée. De vagues espérances animaient les yeux ternes et gris de la vieille mère. Le matin, après le plus modeste de tous les déjeuners, elle revenait prendre son tambour, plutôt par maintien que par obligation, car elle posait ses lunettes sur une petite travailleuse de bois rougi, aussi vieille qu'elle, et passait en revue, de huit heures et demie à dix heures environ, les gens habitués à traverser la rue ; elle recueillait leurs regards, faisait des observations sur leurs démarches, sur leurs toilettes, sur leurs physionomies, et semblait leur marchander sa fille, tant ses yeux babillards essayaient d'établir entre eux de sympathiques affections, par un manége digne des coulisses. On devinait facilement que cette revue était pour elle un spectacle, et peut-être son seul plaisir. La fille levait rarement la tête, la pudeur, ou peut-être le sentiment pénible de sa détresse, semblait retenir sa figure attachée sur le métier ; aussi, pour qu'elle montrât aux passants sa mine chiffonnée, sa mère devait-elle avoir poussé quelque exclamation de surprise. L'employé vêtu d'une redingote neuve, ou l'habitué qui se produisait avec une femme à son bras, pouvaient alors voir le nez légèrement retroussé de l'ouvrière, sa petite bouche rose, et ses yeux gris toujours pétillants de vie, malgré ses accablantes fatigues ; ses laborieuses insomnies ne se trahissaient guère que par un cercle plus ou moins blanc dessiné sous chacun de ses yeux, sur la peau fraîche de ses pommettes. La pauvre enfant semblait être née pour l'amour et la gaieté, pour l'amour qui avait peint au-dessus de ses paupières bridées deux arcs parfaits, et qui lui avait donné une si ample forêt de cheveux châtains qu'elle aurait pu se trouver sous sa chevelure comme sous un pavillon impénétrable à l'oeil d'un amant ; pour la gaieté qui agitait ses deux narines mobiles, qui formait deux fossettes dans ses joues fraîches et lui faisait si vite oublier ses peines ; pour la gaieté, cette fleur de l'espérance qui lui prêtait la force d'apercevoir sans frémir l'aride chemin de sa vie. La tête de la jeune fille était toujours soigneusement peignée. Suivant l'habitude des ouvrières de Paris, sa toilette lui semblait finie quand elle avait lissé ses cheveux et retroussé en deux arcs le petit bouquet qui se jouait de chaque côté des tempes et tranchait sur la blancheur de sa peau. La naissance de sa chevelure avait tant de grâce, la ligne de bistre nettement dessinée sur son cou donnait une si charmante idée de sa jeunesse et de ses attraits, que l'observateur, en la voyant penchée sur son ouvrage, sans que le bruit lui fit relever la tête, devait l'accuser de coquetterie. De si séduisantes promesses excitaient la curiosité de plus d'un jeune homme qui se retournait en vain dans l'espérance de voir ce modeste visage.
– Caroline, nous avons un habitué de plus, et aucun de nos anciens ne le vaut.
Ces paroles, prononcées à voix basse par la mère, dans une matinée du mois d'août 1815, avaient vaincu l'indifférence de la jeune ouvrière qui regarda vainement dans la rue : l'inconnu était déjà loin.
– Par où s'est-il envolé ? demanda-t-elle.
– Il reviendra sans doute à quatre heures, je le verrai venir, et t'avertirai en te poussant le pied. Je suis sûre qu'il repassera, voici trois jours qu'il prend par notre rue ; mais il est inexact dans ses heures : le premier jour il est arrivé à six heures, avant-hier à quatre, et hier à trois. Je me souviens de l'avoir vu autrefois de temps à autre. C'est quelque employé de la préfecture qui aura changé d'appartement dans le Marais. – Tiens, ajouta-t-elle, après avoir jeté un coup d'oeil dans la rue, notre monsieur à l'habit marron a pris perruque, comme cela le change !
Le monsieur à l'habit marron devait être celui des habitués qui fermait la procession quotidienne, car la vieille mère remit ses lunettes, reprit son ouvrage en poussant un soupir et jeta sur sa fille un si singulier regard, qu'il eût été difficile à Lavater lui-même de l'analyser. L'admiration, la reconnaissance, une sorte d'espérance pour un meilleur avenir, se mêlaient à l'orgueil de posséder une fille si jolie. Le soir, sur les quatre heures, la vieille poussa le pied de Caroline, qui leva le nez assez à temps pour voir le nouvel acteur dont le passage périodique allait animer la scène. Grand, mince, pâle et vêtu de noir, cet homme paraissait avoir quarante ans environ, et sa démarche avait quelque chose de solennel ; quand son oeil fauve et perçant rencontra le regard terni de la vieille, il la fit trembler ; elle crut s'apercevoir qu'il savait lire au fond des cœurs. L'inconnu se tenait très-droit, et son abord devait être aussi glacial que l'était l'air de cette rue ; le teint terreux et verdâtre de son visage était-il le résultat de travaux excessifs, ou produit par une santé frêle et maladive ? Ce problème fut résolu par la vieille mère de vingt manières différentes matin et soir. Caroline seule devina tout d'abord sur ce visage abattu les traces d'une longue souffrance d'âme : ce front facile à se rider, ces joues légèrement creusées gardaient l'empreinte du sceau avec lequel le malheur marque ses sujets, comme pour leur laisser la consolation de se reconnaître d'un oeil fraternel et de s'unir pour lui résister. Si le regard de la jeune fille s'anima d'abord d'une curiosité tout innocente, il prit une douce expression de sympathie à mesure que l'inconnu s'éloignait, semblable au dernier parent qui ferme un convoi. La chaleur était en ce moment si forte, et la distraction du passant si grande, qu'il n'avait pas remis son chapeau en traversant cette rue malsaine, Caroline put alors remarquer, pendant le moment où elle l'observa, l'apparence de sévérité que ses cheveux relevés en brosse au-dessus de son front large répandaient sur sa figure. L'impression vive, mais sans charme, ressentie par Caroline à l'aspect de cet homme, ne ressemblait à aucune des sensations que les autres habitués lui avaient fait éprouver ; pour la première fois, sa compassion s'exerçait sur un autre que sur elle-même et sur sa mère, elle ne répondit rien aux conjectures bizarres qui fournirent un aliment à l'agaçante loquacité de sa vieille mère, et tira silencieusement sa longue aiguille dessus et dessous le tulle tendu ; elle regrettait de ne pas avoir assez vu l'étranger, et attendit au lendemain pour porter sur lui un jugement définitif. Pour la première fois aussi, l'un des habitués de la rue lui suggérait autant de réflexions. Ordinairement, elle n'opposait qu'un sourire triste aux suppositions de sa mère qui voulait voir dans chaque passant un protecteur pour sa fille. Si de sem...