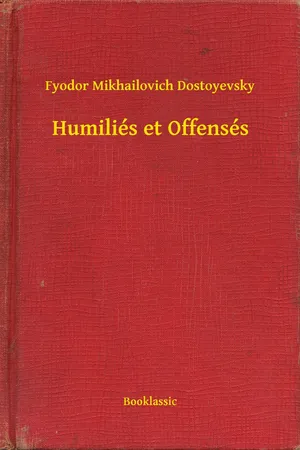L’an dernier, le 22 mars au soir, il m’arriva une aventure des plus étranges. Tout le jour, j’avais parcouru la ville à la recherche d’un appartement. L’ancien était très humide et à cette époque déjà j’avais une mauvaise toux. Je voulais déménager dès l’automne, mais j’avais traîné jusqu’au printemps. De toute la journée, je n’avais rien pu trouver de convenable. Premièrement, je voulais un appartement indépendant, non sous-loué ; et, deuxièmement, je me serais contenté d’une chambre, mais il fallait absolument qu’elle fût grande, et bien entendu en même temps le meilleur marché possible. J’ai remarqué que dans un appartement exigu les pensées même se trouvent à l’étroit. En méditant mes futures nouvelles, j’ai toujours aimé à aller et venir dans ma chambre. À propos : il m’a toujours été plus agréable de réfléchir à mes œuvres et de rêver à la façon dont je les composerais que de les écrire et vraiment, ce n’est pas par paresse. D’où cela vient-il donc ?
Le matin déjà, je n’étais pas dans mon assiette et vers le coucher du soleil je commençai même à me sentir très mal ; je fus pris d’une sorte de fièvre. De plus, j’étais resté sur mes jambes toute la journée et j’étais fatigué. Sur le soir, juste avant le crépuscule, je passai par l’avenue de l’Ascension. J’aime le soleil de mars à Pétersbourg, surtout le coucher du soleil, quand la journée est froide et claire, bien sûr. Toute la rue est brusquement éclairée, inondée d’une lumière éclatante. Toutes les maisons semblent se mettre à étinceler soudainement. Leurs teintes grises, jaunes, vert sale, perdent en un clin d’œil leur aspect rébarbatif ; c’est comme si l’âme s’illuminait, comme si l’on était saisi d’un frisson, ou si quelqu’un vous poussait du coude. Un regard nouveau, de nouvelles pensées… C’est étonnant ce que peut faire un rayon de soleil dans l’âme d’un homme !
Mais le rayon de soleil avait disparu ; le froid se faisait plus vif et commençait à vous picoter le nez ; l’obscurité s’épaississait ; le gaz brillait dans les magasins et les boutiques. Arrivé à la hauteur de la confiserie Müller, je m’arrêtai soudain comme cloué au sol et me mis à regarder l’autre côté de la rue, comme si je pressentais qu’il allait m’arriver tout de suite quelque chose d’extraordinaire ; et, à cet instant précis, du côté opposé, j’aperçus un vieillard et son chien. Je me souviens très bien que mon cœur se serra sous le coup d’une sensation des plus désagréables, et que je ne pus moi-même éclaircir de quelle nature était cette sensation.
Je ne suis pas un mystique ; je ne crois presque pas aux pressentiments et aux divinations ; cependant il m’est arrivé dans ma vie, comme à tout le monde peut-être, plusieurs aventures assez inexplicables. Par exemple, quand ce ne serait que ce vieillard : pourquoi, lorsque je le rencontrai alors, ai-je senti immédiatement que ce même soir il m’adviendrait quelque chose qui ne serait pas tout à fait courant ? D’ailleurs, j’étais malade ; et les impressions maladives sont presque toujours trompeuses.
D’un pas lent et incertain, avançant les jambes comme des baguettes, presque sans les plier, le dos arrondi et frappant légèrement de sa canne les dalles du trottoir, le vieux approchait de la confiserie. De ma vie, je n’avais aperçu silhouette si extravagante et si singulière. Auparavant déjà, avant cette rencontre, lorsque nous nous étions retrouvés chez Müller, il m’avait toujours causé une impression douloureuse. Sa haute taille, son dos voûté, son visage mort d’octogénaire, son vieux paletot, déchiré aux coutures, son chapeau rond tout cabossé qui datait de vingt ans, couvrant un crâne dénudé où avait subsisté, juste sur la nuque, une petite touffe de cheveux non pas blancs, mais jaunâtres, ses mouvements, qui semblaient dépourvus de sens et commandés par un ressort, tout cela frappait involontairement celui qui le rencontrait pour la première fois. Réellement, il paraissait étrange de voir ce vieillard, à la limite de son âge, seul, sans surveillance, d’autant plus qu’il ressemblait à un fou échappé à ses gardiens. Ce qui m’avait frappé aussi, c’était sa maigreur extrême ; il n’avait presque plus de corps, c’était comme s’il ne lui restait que la peau sur les os. Ses yeux, grands mais éteints, entourés d’un cerne bleu sombre, regardaient toujours droit devant eux, jamais de côté, et jamais ils ne voyaient rien, j’en suis convaincu. Tout en vous regardant, il marchait droit sur vous, comme s’il avait un espace vide devant lui. Je l’ai remarqué plusieurs fois. Il y avait peu de temps qu’il se montrait chez Müller, on ne savait d’où il venait, et il était toujours accompagné de son chien. Aucun des clients de la confiserie ne s’était jamais décidé à lui parler, et lui-même n’adressait la parole à personne.
« Pourquoi se traîne-t-il chez Müller, et qu’a-t-il de y faire ? » songeai-je, planté de l’autre côté de la rue et le suivant irrésistiblement du regard. Une irritation, conséquence de la maladie et de la fatigue, commençait à bouillonner en moi. À quoi pense-t-il ? continuai-je à part moi, qu’a-t-il dans la tête ? Et pense-t-il encore à quelque chose ? Son visage est si mort qu’il n’exprime déjà absolument plus rien. Et où a-t-il déniché cet abominable chien qui ne le quitte jamais, comme s’il constituait avec lui un tout inséparable, et qui lui ressemble tellement ?
Ce malheureux chien semblait lui aussi avoir près de quatre-vingts ans ; oui, il devait sûrement en être ainsi. Premièrement, il avait l’air plus vieux qu’aucun chien du monde, et deuxièmement, pourquoi, dès la première fois que je l’avais vu, m’était-il tout de suite venu à l’idée que ce chien ne pouvait pas être comme les autres chiens ; que c’était un chien extraordinaire, qu’il devait absolument y avoir en lui quelque chose de fantastique, de magique ; que c’était peut-être une sorte de Méphistophélès sous l’apparence d’un chien et que son destin avait été uni à celui de son maître par des liens mystérieux et inconnus. En le regardant, vous eussiez tout de suite convenu qu’il y avait à coup sûr une vingtaine d’années qu’il avait mangé pour la dernière fois. Il était maigre comme un squelette, ou, mieux encore, comme son maître. Son poil était presque entièrement tombé, même sur la queue qu’il tenait toujours entre ses jambes et qui était raide comme un bâton. Sa tête aux longues oreilles pendait lamentablement. Jamais je n’avais vu chien si répugnant. Lors qu’ils passaient tous deux dans la rue, le vieux en avant, le chien derrière, son museau touchant les pans du manteau de son maître comme s’il y était attaché, leur démarche et tout leur aspect semblaient dire à chaque pas :
« Pour être vieux, nous sommes vieux, Seigneur, comme nous sommes vieux ! »
Je me souviens qu’un jour il me vint encore à l’esprit que le vieux et son chien s’étaient échappés d’une page d’Hoffmann illustrée par Gavarni, et qu’ils se promenaient par le vaste monde sous forme d’affiches ambulantes pour une édition. Je traversai la rue et entrai derrière le vieillard dans la confiserie.
Dans la boutique, le vieux se comportait de la façon la plus étrange, et Müller, debout derrière son comptoir, s’était même mis, les derniers temps, à faire une grimace de mécontentement à l’entrée de ce visiteur importun. Tout d’abord, ce client singulier ne demandait jamais rien. Chaque fois, il se dirigeait tout droit vers le coin du poêle et s’asseyait sur une chaise. Si sa place près du poêle était occupée, il restait debout un instant, dans une irrésolution stupide, devant le monsieur qui avait pris sa place, puis gagnait comme frappé de stupeur, l’autre coin, près de la fenêtre. Là, il choisissait une chaise, s’y asseyait lentement, ôtait son chapeau, le mettait à côté de lui sur le plancher, posait sa canne auprès du chapeau, puis, se renversant sur le dossier de sa chaise, il restait immobile pendant trois ou quatre heures. Jamais il ne prenait un journal, jamais il n’émettait ni une parole ni un son ; il se contentait de rester assis, regardant devant lui de tous ses yeux, mais d’un regard si hébété, si privé de vie, qu’on pouvait parier qu’il ne voyait rien de ce qui l’entourait et n’entendait rien. Quant au chien, après avoir tourné deux ou trois fois sur place, il se couchait d’un air morose à ses pieds, fourrait son museau entre les bottes de son maître, poussait un profond soupir et, après s’être allongé de tout son long sur le plancher, restait immobile lui aussi toute la soirée, comme s’il mourait pendant ce temps-là. On pouvait croire que ces deux êtres gisaient morts quelque part tout le jour et que, dès que le soleil était couché, ils ressuscitaient brusquement, uniquement pour se rendre à la confiserie Müller et s’acquitter ainsi de quelque mystérieuse obligation, inconnue de tous. Après être resté assis trois ou quatre heures, le vieux, enfin, se levait, prenait son chapeau et partait chez lui. Le chien se levait lui aussi, et, la queue entre les jambes, tête basse, de son même pas lent, le suivait machinalement. Les clients de la confiserie, les derniers temps, évitaient le vieillard de toute manière et ne s’asseyaient même pas à côté de lui, comme s’il leur inspirait de la répulsion. Lui, il ne remarquait rien de tout cela.
Les habitués de cette confiserie étaient pour la plupart des Allemands. Ils venaient là de toute l’avenue de l’Ascension ; tous étaient patrons de différents établissements : serruriers, boulangers, teinturiers, fabricants de chapeaux, selliers, tous gens patriarcaux dans le sens allemand du mot. Chez Müller, en général, on observait les mœurs patriarcales. Le patron se joignait souvent à ses clients familiers, s’asseyait à leur table et l’on vidait force punchs. Les chiens et les petits enfants du patron venaient aussi trouver les clients, et ceux-ci caressaient et les enfants et les chiens. Tous se connaissaient et s’estimaient mutuellement. Et tandis que les habitués s’absorbaient dans la lecture des journaux allemands, derrière la porte, dans l’appartement du patron, vibraient les notes de « Mein lieber Augustin », joué sur un piano aux sons grêles par la fille aînée de l’hôte, une petite Allemande aux boucles blondes, qui ressemblait beaucoup à une souris blanche. La valse était accueillie avec plaisir. J’allais chez Müller les premiers jours de chaque mois lire les journaux russes.
En entrant dans la confiserie, je vis que le vieillard était déjà assis près de la fenêtre et que son chien était comme les autres fois étendu à ses pieds. Je m’assis sans rien dire dans un coin et me posai intérieurement cette question : « Pourquoi suis-je entré ici ; alors que je n’ai absolument rien à y faire, que je suis malade, et qu’il serait plus indiqué de regagner ma maison, de boire du thé et de me coucher ? Est-il possible vraiment que je sois ici uniquement pour contempler ce vieillard ? » Je fus pris d’un mouvement d’humeur. « Qu’ai-je à m’occuper de lui ? » me dis-je en me rappelant cette sensation bizarre et maladive que j’éprouvais déjà en le regardant dans la rue. « Et qu’ai-je à faire avec tous ces Allemands ennuyeux ? Pourquoi cette humeur fantasque ? Pourquoi cette inquiétude de basse qualité pour des bêtises, inquiétude que je discerne en moi ces derniers temps et qui m’empêche de vivre et de porter sur la vie un regard clair, comme me l’a fait remarquer déjà un profond critique, dans son analyse indignée de ma dernière nouvelle ? » Mais, tout en hésitant et en m’affligeant, je restais à ma place et pendant ce temps mon malaise empirait, si bien qu’il me parut regrettable d’abandonner la douce température de la pièce. Je pris la gazette de Francfort, en lus deux lignes et m’assoupis. Les Allemands ne me gênaient pas. Ils lisaient, fumaient et de temps en temps seulement ; une fois toutes les demi-heures environ, se communiquaient, à bâtons rompus et à mi-voix, quelque nouvelle de Francfort ou encore quelque bon mot ou boutade du célèbre humoriste allemand Saphir ; après quoi, avec une fierté nationale accrue, ils se replongeaient dans leur lecture.
Je somnolai près d’une demi-heure et fus réveillé par un violent frisson. Il fallait décidément que je rentre chez moi. Mais, à ce moment, une scène muette qui se déroulait dans la pièce me retint encore une fois. J’ai déjà dit que le vieux, dès qu’il s’était assis sur sa chaise, dirigeait son regard quelque part et ne le détournait pas de toute la soirée. Il m’advint à moi aussi de tomber sous ce regard, absurdement obstiné, qui ne distinguait rien ; la sensation était des plus déplaisantes, insupportable même, et d’ordinaire je changeais de place le plus vite possible. Pour l’instant, la victime du vieillard était un petit Allemand replet et miraculeusement propre, avec un col droit fortement empesé et un visage extraordinairement rouge. C’était un hôte de passage, un marchand de Riga, Adam Ivanytch Schultz, comme je l’appris par la suite, ami intime de Müller, mais qui ne connaissait pas encore le vieux ni bon nombre des habitués. Il lisait avec délices Dorf barbier et buvait son punch à petites gorgées lorsque soudain, levant la tête il aperçut le regard du vieillard fixé sur lui. Cela l’abasourdit. Adam Ivanytch était un homme très susceptible et très chatouilleux, comme le sont en général tous les Allemands « nobles ». Il lui parut étrange et offensant qu’on le dévisageât avec tant d’insistance et de sans-gêne. Étouffant son indignation, il détourna les yeux du client indélicat, marmotta quelque chose dans sa barbe et, sans mot dire, se cacha derrière son journal. Mais il ne put y tenir et, quelques minutes après, jeta de derrière son journal un coup d’œil soupçonneux : même regard entêté, même contemplation dépourvue de sens. Adam Ivanytch se tut cette fois encore. Mais lorsque cette circonstance se reproduisit une troisième fois, il éclata et estima de son devoir de défendre sa noblesse et de ne pas laisser porter atteinte devant un public noble à la belle ville de Riga dont, vraisemblablement, il se considérait comme le représentant. Avec un geste d’impatience, il jeta son journal sur la table, en frappant énergiquement de la baguette dans laquelle il était inséré et, flambant de dignité, tout rouge de punch et de bravoure, il arrêta à son tour ses petits yeux enflammés sur l’irritant vieillard. On eût dit que tous deux, l’Allemand et son adversaire, voulaient venir à bout l’un de l’autre par la puissance magnétique de leurs regards et attendaient qui le premier perdrait contenance et baisserait les yeux. Le bruit de la baguette et la pose excentrique d’Adam Ivanytch attirèrent l’attention de tous les assistants. Tous, à l’instant, ajournèrent leurs occupations et, avec une curiosité grave et silencieuse observèrent les deux adversaires. La scène devenait très comique. Mais le magnétisme des petits yeux provocants du rubicond Adam Ivanytch demeura sans effet. Le vieux, sans se soucier de rien, continuait à regarder hardiment M. Schultz, fou de rage, et ne remarquait décidément pas qu’il était devenu l’objet de la curiosité générale. Tout comme s’il eût été dans la lune et non sur la terre. Finalement, Adam Ivanytch fut à bout de patience ; il fit explosion.
« Pourquoi me regardez-vous avec tant d’attention ? » cria-t-il en allemand, d’une voix rude et perçante et d’un air menaçant.
Mais son adversaire continuait à se taire, comme s’il n’avait pas compris ni même entendu la question. Adam Ivanytch se décida à parler en russe.
« Che fous temante, pourquoi fous me recardez afec tant d’insistance ! vociféra-t-il avec une fureur redoublée. Che suis connu à la Cour, tantis que fous n’y êtes bas connu ! » ajouta-t-il en se levant brusquement.
Mais le vieux ne cilla même pas. Un murmure d’indignation courut parmi les Allemands. Müller lui-même, attiré par le bruit, entra dans la pièce. Mis au fait de l’incident, il songea que le vieux était sourd et se pencha jusqu’à son oreille.
« Monsieur Schultz fous a temanté te ne pas le recarder ainsi », dit-il aussi fort que possible en regardant droit dans les yeux l’incompréhensible visiteur.
Le vieux jeta machinalement un coup d’œil sur Müller et, brusquement, son visage jusque-là immobile laissa voir les indices d’une angoisse, d’une agitation inquiète. Il se mit à s’affairer, se pencha avec un gémissement vers son chapeau, le saisit précipitamment ainsi que sa canne, se leva, et, avec un sourire pitoyable, le sourire humilié du pauvre que l’on chasse de la place qu’il a occupée par erreur, se prépara à quitter la salle. Cette hâte docile et humble du malheureux vieillard branlant éveillait si bien la pitié et cette émotion qui littéralement fait chavirer le cœur dans la poitrine que toute l’assistance, à commencer par Adam Ivanytch, regarda aussitôt l’affaire avec d’autres yeux. Il était clair que le vieillard non seulement ne pouvait offenser personne, mais sentait lui-même à chaque minute qu’on pouvait le chasser de partout, comme un mendiant.
Müller était un homme bon et compatissant.
« Non, non, reprit-il en donnant des petites tapes réconfortantes sur l’épaule du vieux, asseyez-fous ! Aber Herr Schultz fous prie te ne pas le recarder si fixement. Il est connu à la Cour. »
Mais le malheureux ne comprit pas davantage ; il s’agita plus encore, se pencha pour ramasser son cache-nez, un vieux cache-nez bleu foncé plein de trous qui était tombé de son chapeau, et se mit à appeler son chien qui était allongé immobile sur le plancher, et semblait plongé dans un profond sommeil, le museau recouvert par ses deux pattes.
« Azor ! Azor ! zézaya-t-il d’une voix sénile et tremblante. Azor ! »
Azor ne bougea pas.
« Azor ! Azor ! » répéta le vieillard d’un ton angoissé ; il poussa le chien avec sa canne, mais celui-ci demeura dans la même position.
La canne tomba de ses mains. Il se pencha, se mit à genoux et souleva à deux mains la tête d’Azor. Pauvre Azor ! Il était mort. Il avait expiré sans bruit aux pieds de son maître, peut-être de vieillesse et peut-être aussi de faim. Le vieux le regarda un instant, comme stupéfait, ne semblant pas comprendre qu’Azor était déj...