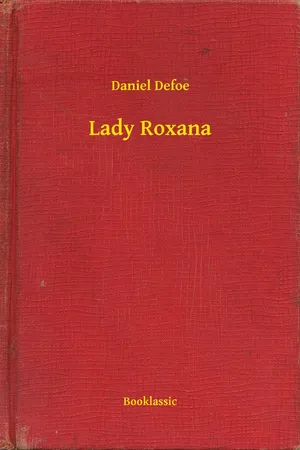SOMMAIRE. – Je suis mariée à un riche brasseur. – Mort de mon père et du père de mon mari. – Mystérieuse disparition de mon mari. – Je vends mes effets pour vivre. – Attachement de ma servante, Amy. – Conseils de deux amies. – Mes enfants sont envoyés à leur tante. – Conduite haineuse de la tante. – Caractère aimable de l’oncle. – Générosité de mon propriétaire. – Mon propriétaire dîne avec moi. – Le mobilier de ma maison est restauré. – Déclaration d’amour. – Mon propriétaire devient mon locataire. – Le piège de la pauvreté. – Je me résous à partager le lit de mon propriétaire. – Nous nous prenons comme époux.
Je suis née, comme je l’ai appris de mes amis, dans la ville de Poitiers, province ou comté de Poitou, en France, d’où je fus amenée en Angleterre par mes parents, qui s’enfuirent à cause de leur religion vers l’an 1683, époque où les protestants furent bannis de France par la cruauté de leurs persécuteurs.
Moi, qui ne savais que peu de chose, ou rien du tout, de ce qui m’avait fait amener ici, j’étais assez contente de m’y trouver. Londres, ville grande et gaie, me plut infiniment ; car, en ma qualité d’enfant, j’aimais la foule, et à voir beaucoup de beau monde.
Je ne conservai rien de la France que le langage, mon père et ma mère étant de meilleur ton que ne l’étaient ordinairement, en ce temps-là, ceux qu’on appelle réfugiés. Ayant fui de bonne heure, lorsqu’il était encore facile de réaliser leurs ressources, ils avaient, avant leur traversée, envoyé ici des sommes importantes, ou, autant que je m’en souviens, des valeurs considérables en eau-de-vie de France, papier et autres marchandises. Tout cela se vendit dans des conditions très avantageuses, et mon père se trouva fort à l’aise en arrivant, de sorte qu’il s’en fallait qu’il eût à s’adresser aux autres personnes de notre nation qui étaient ici, pour en obtenir protection ou secours. Au contraire, sa porte était continuellement assiégée d’une foule de pauvres misérables créatures mourant de faim, qui, en ce temps-là, s’étaient réfugiées ici, pour des raisons de conscience ou pour quelque autre cause.
J’ai même entendu mon père dire qu’il était harcelé par bien des gens qui, pour la religion qu’ils avaient, auraient aussi bien pu rester où ils étaient auparavant. Mais ils accouraient ici par troupeaux, pour y trouver ce qu’on appelle en anglais a livelihood, c’est-à-dire leur subsistance, ayant appris que les réfugiés étaient reçus à bras ouverts en Angleterre, qu’ils trouvaient promptement de l’ouvrage, car la charité du peuple de Londres leur facilitait les moyens de travailler dans les manufactures de Spitalfields, de Canterbury et autres lieux, – qu’ils avaient pour leur travail un salaire bien plus élevé qu’en France, et autres choses semblables.
Mon père, disais-je, m’a raconté qu’il était plus harcelé des cris de ces gens-là que de ceux qui étaient de vrais réfugiés, ayant fui dans la misère pour obéir à leur conscience.
J’avais à peu près dix ans lorsqu’on m’amena dans ce pays où, comme je l’ai dit, mon père vécut fort à l’aise, et où il mourut environ onze ans plus tard. Pendant ce temps, je m’étais formée pour la vie mondaine, et liée avec quelques-unes de nos voisines anglaises, comme c’est la coutume à Londres. Tout enfant, j’avais choisi trois ou quatre compagnes et camarades de jeux d’un âge assorti au mien, de sorte qu’en grandissant nous nous habituâmes à nous appeler amies et intimes ; et ceci contribua beaucoup à me perfectionner pour la conversation et pour le monde.
J’allais à des écoles anglaises, et, comme j’étais jeune, j’appris la langue parfaitement bien, ainsi que toutes les manières des jeunes filles anglaises. Je ne conservai donc rien des Françaises que la connaissance du langage ; encore n’allai-je pas jusqu’à garder des restes de locutions françaises cousues dans mes discours, comme la plupart des étrangers ; mais je parlais ce que nous appelons le pur anglais, aussi bien que si j’étais née ici.
Puisque j’ai à donner la description de ma personne, il faut qu’on m’excuse de la donner aussi impartialement que possible, et comme si je parlais d’une autre. La suite vous fera juger si je me flatte ou non.
J’étais (je parle de moi lorsque j’avais environ quatorze ans) grande, et très bien faite ; d’une sagacité de faucon dans les questions qui ne dépassent pas le niveau ordinaire des connaissances ; prompte et vive dans mes discours, portée à la satire, toujours prête à la repartie, et un peu trop libre dans la conversation, ou, comme nous disons en anglais, un peu trop hardie (bold), bien que d’une modestie parfaite dans ma conduite. Étant née Française, je devais danser, comme quelques-uns le prétendent, naturellement ; en effet, j’aimais extrêmement la danse ; je chantais bien également, et si bien que, comme vous le verrez, cela me fut plus tard de quelque avantage. Avec tout cela, je ne manquais ni d’esprit, ni de beauté, ni d’argent. C’est ainsi que j’entrai dans le monde, possédant tous les avantages qu’une jeune femme pouvait désirer pour se faire bien venir des autres et se promettre une vie heureuse pour l’avenir.
Vers l’âge de quinze ans, mon père me donna une dot de 25,000 livres, comme il disait en français, c’est-à-dire deux mille livres sterling, et me maria à un gros brasseur de la cité. Excusez-moi si je tais son nom, car bien qu’il soit la cause première de ma ruine, je ne saurais me venger de lui si cruellement.
Avec cette chose qu’on appelle un mari, je vécus huit années fort convenablement, et pendant une partie de ce temps j’eus une voiture, c’est-à-dire une sorte de caricature de voiture, car toute la semaine les chevaux travaillaient aux camions ; mais, le dimanche, j’avais le privilège de sortir dans mon carrosse, pour aller soit à l’église, soit ailleurs, suivant que mon mari et moi pouvions en tomber d’accord, ce qui, soit dit en passant, n’arrivait pas souvent. Mais nous reparlerons de cela.
Avant de m’engager davantage dans l’histoire de la partie matrimoniale de mon existence, il faut me permettre de faire le portrait de mon mari aussi impartialement que j’ai fait le mien. C’était un gaillard jovial et beau garçon autant qu’aucune femme peut en désirer un pour le compagnon de sa vie ; grand et bien fait ; peut-être de dimensions un peu trop fortes, mais pas jusqu’à avoir l’air vulgaire. Il dansait bien, et c’est, je crois, ce qui nous rapprocha tout d’abord. Il avait un vieux père qui dirigeait les affaires avec soin, de sorte qu’il n’avait, de ce côté-là, pas grand’chose à faire, si ce n’est, de temps en temps, de faire une apparition et de se montrer. Et il en profitait ; car il s’inquiétait très peu de son commerce, mais il sortait, voyait du monde, chassait beaucoup et aimait excessivement ce dernier plaisir.
Après vous avoir dit que c’était un bel homme et un bon sportsman,j’ai vraiment tout dit. Je fus assez malheureuse, comme tant d’autres jeunes personnes de notre sexe, de le choisir parce qu’il était bel homme et bon vivant, comme je l’ai dit ; car, pour le reste, c’était un être aussi faible, à tête aussi vide, et aussi dénué d’instruction qu’une femme ait jamais pu en désirer pour son compagnon. Et ici, il faut que je prenne la liberté, quelques reproches que j’aie d’ailleurs à me faire dans ma conduite ultérieure, de m’adresser à mes sœurs, les jeunes filles de ce pays, et de les prémunir en quelques mots. Si vous avez quelque considération pour votre bonheur futur, quelque désir de vivre bien avec un mari, quelque espoir de conserver votre fortune ou de la rétablir après un désastre, jamais, mesdemoiselles, n’épousez un sot ; un mari quelconque, mais pas un sot ; avec certains autres maris vous pouvez être malheureuses, mais avec un sot vous serez misérables ; avec un autre mari vous pouvez, dis-je, être malheureuses, mais avec un sot vous le serez nécessairement. Il y a plus : le voudrait-il, il ne saurait vous rendre heureuse ; tout ce qu’il fait est si gauche, tout ce qu’il dit est si vide, qu’une femme de quelque intelligence ne peut s’empêcher d’être fatiguée et dégoûtée de lui vingt fois par jour. Quoi de plus contrariant pour une femme que de mener dans le monde un grand gaillard de mari, bel homme et joli garçon, et d’être obligée de rougir de lui chaque fois qu’elle l’entend parler ? D’entendre les autres hommes causer sensément, quand lui n’est capable de rien dire, et a l’air d’un sot ? Ou, ce qui est pire, de l’entendre dire des stupidités et faire rire de lui comme d’un sot ?
D’un autre côté, il y a tant de sortes de sots, une si infinie variété de sots, et il est si difficile de savoir quel est le pire de l’espèce, que je suis obligée de vous dire : Pas de sot, mesdemoiselles, absolument, aucune espèce de sot, sot furieux ou sot modéré, sot sage ou sot idiot ; prenez n’importe quoi, si ce n’est un sot ; bien plus, soyez n’importe quoi vous-même, soyez même vieille fille, la pire des malédictions de la nature, plutôt que de ramasser un sot.
Mais laissons cela un moment, car j’aurai l’occasion d’en reparler. Mon cas était particulièrement pénible, et je trouvais, dans cette malheureuse union, toute une complication de sottises variées.
D’abord, – et la chose, il faut l’avouer, est parfaitement insupportable, – mon mari était un sot vaniteux, tout opiniâtre[1]. Tout ce qu’il disait était juste, était le mieux dit et décidait la question, sans la moindre considération pour aucune des personnes présentes, ni pour rien de ce qui pouvait avoir été avancé par d’autres, même avec toute la modestie imaginable. Et néanmoins, quand il en venait à défendre son avis par l’argumentation et la raison, il le faisait d’une façon si faible, si vide, et si éloignée de son but, que c’en était assez pour dégoûter ceux qui l’écoutaient et les faire rougir de lui.
En second lieu, il était affirmatif et entêté, et il l’était surtout dans les choses les plus simples ou les plus contradictoires et telles qu’il était impossible d’avoir la patience de les entendre énoncer.
Ces deux qualités, même s’il n’y en avait pas eu d’autres, suffisaient à le rendre la plus insupportable créature qu’on pût avoir pour époux ; et l’on imagine, à première vue, l’espèce de vie que je menais. Cependant, je m’en tirais aussi bien que je pouvais, et retenais ma langue ; ce qui était la seule victoire que je remportasse sur lui. En effet, lorsqu’il voulait m’entretenir de son bavardage bruyant et vide, et que je ne voulais pas lui répondre ou entrer en conversation avec lui sur le point qu’il avait choisi, il se levait dans une rage inimaginable, et s’en allait. C’était ainsi que je me délivrais à meilleur marché.
Je pourrais m’étendre ici sur la méthode que j’adoptai pour me faire une vie passable et facile avec le caractère le plus incorrigible du monde ; mais ce serait trop long, et les détails trop frivoles. Je me bornerai à en mentionner quelques-uns que les événements que j’ai à raconter rendent nécessaires à mon récit.
J’étais mariée depuis quatre ans environ, lorsque je perdis mon père. – Ma mère était morte auparavant. – Mon union lui plaisait si peu, et il voyait si peu de motifs d’être satisfait de la conduite de mon mari, que, tout en me laissant, à sa mort, cinq mille livres et plus, il les laissa entre les mains de mon frère aîné. Celui-ci, s’étant témérairement aventuré dans ses opérations commerciales, fit faillite, et perdit, non seulement ce qu’il avait à lui, mais aussi ce qu’il avait à moi, comme vous l’apprendrez tout à l’heure.
Ainsi je perdis la dernière marque de la libéralité de mon père, parce que j’avais un mari à qui l’on ne pouvait se fier : voilà un des avantages d’épouser un sot.
Dans la seconde année qui suivit la mort de mon père, le père de mon mari mourut aussi. Je crus que sa fortune s’en trouvait considérablement augmentée, car tout le commerce de la brasserie, lequel était excellent, lui appartenait désormais en propre.
Mais cette augmentation de propriété fut sa ruine, car il n’avait pas le génie des affaires. Il n’avait aucune connaissance des comptes de sa maison. Il eut bien l’air de se remuer à ce sujet, dans les commencements, et il prit un visage d’homme affairé. Mais il se relâcha vite. C’était chose au-dessous de lui que d’examiner ses livres ; il laissait ce soin à ses commis et à ses comptables ; et tant qu’il trouvait de l’argent en caisse pour payer le malteur et les droits et pour en mettre un peu dans sa poche, il se sentait parfaitement à l’aise et sans souci, laissant le plus important aller au hasard.
Je prévoyais les conséquences, et plusieurs fois j’essayai de le persuader de s’appliquer à ses affaires. Je lui rappelai combien ses clients se plaignaient de la négligence de ses employés d’un côté, et combien, de l’autre, augmentait le nombre de ses débiteurs, par suite de l’insouciance de son commis à assurer les rentrées, et autres choses semblables. Mais il me repoussait soit avec de dures paroles, soit d’une façon détournée, en me représentant les choses autrement qu’elles n’étaient.
Quoi qu’il en soit, pour couper court à une ennuyeuse histoire qui n’a pas le droit d’être longue, il finit par trouver que son commerce déclinait, que son capital diminuait, bref, qu’il ne pouvait pas continuer les affaires. Une ou deux fois il dut mettre en gages ses ustensiles de brasseur pour satisfaire l’excise ; et, la dernière fois, il eut toutes les peines du monde à les dégager.
Il en fut alarmé, et résolut de cesser le commerce. Il n’en était pas fâché, d’ailleurs, prévoyant que s’il ne le faisait pas à temps, il serait forcé de cesser d’une autre manière, je veux dire en faisant banqueroute. De mon côté, je ne demandais pas mieux qu’il s’en retirât pendant qu’il lui restait encore quelque chose, de peur de me trouver dépouillée dans ma propre maison et mise à la porte avec mes enfants ; car j’avais maintenant cinq enfants. C’est le seul ouvrage, peut-être, à quoi les sots soient bons.
Je me considérais comme heureuse lorsqu’il eut trouvé quelqu’un à qui céder la brasserie.
En effet, après avoir payé une grosse somme, mon mari se trouva libéré, toutes ses dettes acquittées, et ayant encore de deux à trois mille livres sterling en poche. Obligés de déménager de la brasserie, nous prîmes une maison à X***, village situé à dix milles de la ville environ. Tout bien considéré, je me crus heureuse, je le répète, d’être sortie d’embarras à d’aussi bonnes conditions ; et si mon bel homme avait eu seulement son plein bonnet de bon sens, je n’aurais pas encore été trop mal.
Je lui proposai d’acheter quelque bien avec l’argent, ou avec une partie, lui offrant d’apporter ma part qui existait encore et qui pouvait se réaliser sûrement. De cette façon nous aurions pu vivre tolérablement, au moins pendant sa vie. Mais comme c’est le propre d’un sot de ne pas prendre d’avis, il négligea celui-là, vécut comme auparavant, garda ses chevaux et ses gens, sortit tous les jours à cheval pour chasser dans la forêt ; et, pendant ce temps-là, rien ne se faisait. Mais l’argent filait bon train, et il me semblait que je voyais la ruine accourir, sans aucun moyen praticable de l’arrêter.
Je ne négligeai rien de tout ce que la persuasion et les prières peuvent tenter ; mais tout fut inutile. Lui représenter comme notre argent s’en allait vite et ce que serait notre situation quand il n’y en aurait plus, cela ne faisait aucune impression sur lui. Comme un insensé, il continuait sans nul souci de tout ce qu’on pourrait supposer que les larmes et les lamentations sont capables de faire. Il ne diminuait ni sa dépense personnelle, ni son train, ni ses chevaux, ni son domestique, jusqu’à la fin, où il ne lui resta plus même cent livres sterling au monde.
Il ne fallut pas plus de trois ans pour dépenser ainsi tout l’argent comptant. Et il le dépensa, je puis le dire, sottement ; car les compagnies qu’il fréquentait n’avaient rien d’estimable ; c’étaient généralement des chasseurs, des maquignons et des gens inférieurs à lui : autre conséquence de la sottise chez un homme. Les sots, en effet, ne sauraient trouver d’attrait à la société d’hommes plus sages et plus capables qu’eux ; ce qui fait qu’ils entretiennent commerce avec des coquins, boivent de la bière avec les portefaix, et font toujours leur compagnie de gens au dessous d’eux.
C’était là ma triste situation, lorsqu’un matin mon mari me dit qu’il comprenait qu’il en était arrivé à un état misérable, et qu’il voulait aller chercher fortune quelque part, ou ailleurs. Il avait déjà dit des choses semblables plusieurs fois auparavant, lorsque je le pressais de considérer ses ressources et les ressources de sa famille avant qu’il fût trop tard ; mais, comme j’avais vu que dans tout cela il n’y avait aucune idée sérieuse, – et, à la vérité, il n’y avait guère jamais aucune idée dans ses paroles, quoi qu’il dît, – je pensai encore cette fois-ci que ce n’était que des mots en l’air. Lorsqu’il avait bien répété qu’il voulait s’en aller, je souhaitais d’ordinaire secrètement à part moi, et même je me le disais nettement en pensée : Que ne le faites-vous donc ! car si vous continuez ainsi, vous nous ferez tous mourir de faim.
Cependant il resta à la maison toute la journée, et y passa la nuit. Le lendemain, de grand matin, il se lève du lit, va à une fenêtre qui donnait sur les écuries, et sonne de son cor français, comme il l’appelait. C’était son signal ordinaire pour appeler ses gens quand il sortait pour la chasse.
On était vers la fin d’août ; il faisait donc encore clair dès cinq heures, et ce fut à peu près à cette heure-là que je l’entendis, lui et deux de ses gens, sortir, et fermer les portes de la cour derrière eux. Il ne m’avait rien dit de plus qu’il ne le faisait d’ordinaire lorsqu’il sortait pour son exercice favori. De mon côté, je ne me levai pas, et ne lui dis rien de particulier ; mais je repris mon sommeil après son départ, et dormis pendant deux heures, ou environ.
Le lecteur sera sans doute un peu surpris d’apprendre brusquement que, depuis, je n’ai plus jamais revu mon époux. Il y a plus : non seulement je ne l’ai jamais revu, mais je n’ai jamais eu de ses nouvelles, ni directement, ni indirectement, non plus que d’aucun de ses deux domestiques, ni des chevaux ; je n’ai jamais su ce qu’ils devinrent, ou ni dans quelle direction ils étaient allés, ce qu’ils firent ou avaient l’intention de faire, pas plus que si le sol s’était ouvert et les avait engloutis, et que personne n’en eût eu connaissance, si ce n’est comme je le dirai ci-après.
Je ne fus aucunement surprise, ni le premier, ni le second soir ; non, et même je ne le fus guère pendant les deux premières semaines, pensant que s’il lui était arrivé quelque malheur, j’en entendrais toujours parler as...