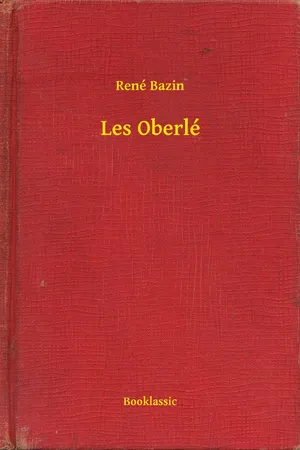La lune se levait au-dessus des brumes du Rhin. Un homme qui descendait, en ce moment, par un sentier des Vosges, grand chasseur, grand promeneur à qui rien n’échappait, venait de l’apercevoir dans l’échancrure des futaies. Il était aussitôt rentré dans l’ombre des sapinières. Mais ce simple coup d’œil jeté, au passage d’une clairière, sur la nuit qui devenait lumineuse, avait suffi pour lui rappeler la beauté de cette nature où il vivait. L’homme tressaillit de plaisir. Le temps était froid et calme. Un peu de brume montait aussi des ravins. Elle ne portait point encore le parfum des jonquilles et des fraisiers sauvages, mais l’autre seulement qui n’a pas de nom et n’a pas de saison, le parfum des résines, des feuilles mortes, des gazons reverdis, des écorces soulevées sur la peau neuve des arbres, et l’haleine de cette fleur éternelle qu’est la mousse des bois. Le voyageur respira profondément cette senteur qu’il aimait ; il la but à grands traits, la bouche ouverte, pendant plus de dix pas, et, si habitué qu’il fût à cette fête nocturne de la forêt, lueurs du ciel, parfums de la terre, frémissements de la vie silencieuse, il dit à demi-voix : « Bravo, l’hiver ! Bravo les Vosges ! Ils n’ont pas pu vous gâter ! » Et il mit sa canne sous son bras, afin de faire moins de bruit encore sur le sable et sur les aiguilles de sapin du sentier en lacet, puis, détournant la tête :
– Trotte avec précaution, Fidèle, mon bon ami : c’est trop beau !
À trois pas derrière, trottait un épagneul haut sur pattes, efflanqué, fin de museau comme un lévrier, qui paraissait tout gris, mais qui était, en plein jour, feu et café au lait, avec des franges de poils souples qui dessinaient la ligne de ses pattes, de son ventre et de sa queue. La bonne bête eut l’air de comprendre son maître, car elle continua de le suivre, sans faire plus de bruit que la lune qui glissait sur les aigrettes des sapins.
Bientôt la lumière pénétra entre les branches, émietta l’ombre ou la balaya par larges places, s’allongea sur les pentes, enveloppa les troncs d’arbres ou les étoila, et, toute froide, imprécise et bleue, créa, avec les mêmes arbres, une forêt nouvelle que le jour ne connaissait pas. Ce fut une création immense, enchanteresse et rapide. Dix minutes y suffirent. Pas un frisson ne l’annonça. M. Ulrich Biehler continua de descendre, saisi d’une émotion grandissante, se baissant quelquefois pour mieux voir les sous-bois, se penchant au-dessus des ravins, le cœur battant, la tête aux aguets, comme les chevreuils qui devaient quitter les combes et gagner le pacage.
Ce voyageur enthousiaste et jeune encore d’esprit n’était cependant plus un homme jeune. M. Ulrich Biehler, – qu’on appelait partout, dans la contrée, M. Ulrich, – avait soixante ans, et ses cheveux et sa barbe d’un gris presque blanc en témoignaient ; mais il avait eu plus de jeunesse que d’autres, comme on a plus de bravoure ou de beauté, et il en avait gardé quelque chose. Il habitait au milieu de la montagne de Sainte-Odile, exactement à quatre cents mètres en l’air, une maison forestière sans architecture et sans dépendance territoriale d’aucune sorte, si ce n’est le pré en pente où elle était posée et, en arrière, un tout petit verger, ravagé périodiquement par les grands hivers. Il était demeuré fidèle à cette maison, héritée de son père qui l’avait achetée seulement pour y passer les vacances, et il y passait toute l’année, solitaire, bien que ses amis, comme ses terres, fussent assez nombreux dans la plaine. Il n’était pas sauvage, mais il n’aimait pas livrer sa vie. Un peu de légende l’entourait donc. On racontait qu’en 1870, il avait fait toute la campagne coiffé d’un casque d’argent au cimier duquel pendait, en guise de crinière, la chevelure d’une femme. Personne ne pouvait dire si c’était de l’histoire. Mais vingt bonnes gens de la plaine d’Alsace pouvaient affirmer qu’il n’y avait point eu, parmi les dragons français, un cavalier plus infatigable, un éclaireur plus audacieux, un compagnon de misère plus tendre et plus oublieux de sa propre souffrance que M. Ulrich, propriétaire de Heidenbruch dans la montagne de Sainte-Odile.
Il était resté Français sous la domination allemande. C’était sa joie et la cause, également, de nombreuses difficultés qu’il tâchait d’aplanir, ou de supporter en compensation de la faveur qu’on lui faisait de le laisser respirer l’air d’Alsace. Il savait demeurer digne, dans ce rôle de vaincu toléré et surveillé. Aucune concession qui eût trahi l’oubli du cher pays de France, mais aucune provocation, aucun goût de démonstration inutile. M. Ulrich voyageait beaucoup dans les Vosges, où il possédait, çà et là, des parties de forêts, qu’il administrait lui-même. Ses bois étaient réputés parmi les mieux aménagés de la Basse-Alsace. Sa maison, depuis trente ans fermée pour cause de deuil, avait cependant une réputation de confort et de raffinement. Les quelques personnes, françaises ou alsaciennes, qui en avaient franchi le seuil, disaient l’urbanité de l’hôte et son art de bien recevoir. Les paysans surtout l’aimaient, ceux qui avaient fait la guerre avec lui, et même leurs fils, qui levaient leur chapeau quand M. Ulrich apparaissait au coin de leur vigne ou de leur luzerne. On le reconnaissait de loin, à cause de sa taille élancée et mince, et de l’habitude qu’il avait de ne porter que des vêtements légers, qu’il achetait à Paris et qu’il choisissait invariablement dans les couleurs brunes, depuis le brun foncé du noyer jusqu’au brun clair des chênes. Sa barbe en pointe, très soignée, allongeait son visage, où il y avait peu de sang et peu de rides ; la bouche souriait volontiers sous les moustaches ; le nez proéminent et droit d’arête disait la race ; les yeux gris, indulgents et fins, prenaient vite une expression de hauteur et de défi quand on parlait de l’Alsace ; enfin, le front large mettait un peu de songe dans cette physionomie d’homme de combat, et s’agrandissait de deux clairières enfoncées en plein taillis de cheveux durs, serrés et coupés droit.
Or, ce soir, M. Ulrich rentrait de visiter une coupe de bois dans les montagnes de la vallée de la Bruche, et ses domestiques ne s’attendaient pas à le voir sortir de nouveau, quand, après dîner, il avait dit à la femme de chambre, la vieille Lise, qui servait à table :
– Mon neveu Jean a dû arriver ce soir à Alsheim, et, sans doute, si j’attendais jusqu’à demain, je pourrais le voir ici, mais je préfère le voir là-bas, dès aujourd’hui. Et je pars. Laisse la clef sous la porte, et couche-toi.
Il avait aussitôt sifflé Fidèle, pris sa canne et descendu le sentier qui, à cinquante pas de Heidenbruch, entrait sous bois.
M. Ulrich était vêtu, selon sa coutume, d’une vareuse et d’une culotte couleur feuille morte, et coiffé d’une bombe de chasse en velours. Il avait marché vite, et, en moins d’une demi-heure, se trouvait rendu à un endroit où le sentier rejoignait une allée plus large, faite pour les promeneurs et les pèlerins de Sainte-Odile. Le lieu était indiqué dans les guides, parce que, sur cent mètres de longueur, on dominait le cours d’un torrent qui traversait plus bas, dans la plaine, le village d’Alsheim ; parce que, surtout, dans l’ouverture du ravin, dans l’angle que formaient les pentes rapprochées des terres, on pouvait apercevoir, en jour, un coin de l’Alsace, des villages, des champs, des prés, très loin un vague trait d’argent qui était le Rhin, et les montagnes de la Forêt-Noire, bleues comme du lin et rondes comme un feston. Malgré la nuit qui bornait la vue, M. Ulrich, en arrivant dans l’allée, regarda devant lui, par la force de l’habitude, et ne vit qu’un triangle de nuit, de la couleur de l’acier, où brillaient en haut de vraies étoiles, en bas des points lumineux de grosseur égale, mais légèrement voilés et entourés d’un halo, et qui étaient les lampes et les chandelles du village d’Alsheim. Le voyageur pensa à son neveu, qu’il allait tout à l’heure serrer contre son cœur, et se demanda : « Qui vais-je trouver ? Que va-t-il être, après trois ans d’absence, et trois ans d’Allemagne ? »
Ce ne fut qu’un arrêt d’un instant. M. Ulrich traversa l’allée, et, voulant couper au plus court, entra sous les branches d’une futaie de hêtres qui descendait, en pente rapide, vers une nouvelle sapinière où il retrouverait le chemin. Quelques feuilles mortes tremblaient encore au bout des basses branches, mais la plupart étaient tombées sur celles de l’année précédente, qui ne laissaient pas à découvert un seul pouce du sol, et, devenues elles-mêmes minces comme de la soie, et toutes pâles, elles ressemblaient à un dallage extrêmement uni et blond ; les troncs se dressaient, marbrés de mousses, réguliers comme des colonnes, et les cimes se rapprochaient au-dessus, bien haut, et s’unissaient par leurs rameaux ténus, qui dessinaient seulement la voûte et laissaient passer la lumière. Quelques buissons rompaient l’harmonie des lignes. À une centaine de mètres en contrebas, le barrage des arbres verts formait comme le mur solide de cette cathédrale en ruines.
Tout à coup, M. Ulrich entendit un bruit léger et tel qu’un autre homme ne l’eût sans doute pas remarqué, en avant, dans les sapins vers lesquels il se dirigeait. C’était le bruit d’une pierre roulant sur les pentes, accélérant sa vitesse, heurtant des obstacles et rebondissant. Il diminua, et finit par un éclatement à la fois ténu et clair, qui prouvait que la pierre avait atteint le fond caillouteux d’un ravin et s’y brisait. La forêt reprenait son silence, quand une seconde pierre, beaucoup moins grosse encore, à en juger par le son qu’elle éveilla, se mit, elle aussi, à rouler dans l’ombre. En même temps, le chien hérissa ses poils, et revint en grognant vers son maître.
– Tais-toi, Fidèle, dit celui-ci, il ne faut pas qu’ils me voient !
M. Ulrich se jeta aussitôt derrière le tronc d’un arbre, comprenant qu’un être vivant montait à travers bois, et devinant qui allait apparaître. En effet, trouant le noir du rideau de sapins, il aperçut la tête, les deux pieds de devant, et bientôt le corps tout entier d’un cheval. Un souffle blanc, précipité, s’échappait des naseaux et fumait dans la nuit. L’animal faisait effort pour grimper la pente trop raide. Tous les muscles tendus, les pieds de devant en crochet, le ventre près de terre, il avançait par soubresauts, mais presque sans bruit, enfonçant dans la mousse et dans l’épaisse toison végétale du sol, et ne déplaçant guère que des feuilles, qui coulaient les unes sur les autres avec un murmure de gouttes d’eau. Il portait un cavalier bleu clair, penché sur l’encolure et tenant sa lance presque horizontalement comme si l’ennemi avait été proche. L’haleine de l’homme se mêlait à celle du cheval dans la nuit froide. Ils avancèrent, se démenant comme s’ils luttaient. Bientôt le voyageur distingua les ganses jaunes cousues sur la tunique, les bottes noires au-dessous de la culotte sombre, le sabre droit pendu à l’arçon, et il reconnut un cavalier du régiment de hussards rhénans en garnison à Strasbourg ; puis plus près, il distingua, sur la flamme noire et blanche de la lance, un aigle jaune, indiquant un sous-officier ; il vit, sous le bonnet plat, un visage imberbe, sanguin, en sueur, des yeux roux inquiets, farouches, fouettés par la crinière en mouvement et fréquemment tournés à droite, et il nomma tout bas Gottfried Hamm, fils de Hamm le policier d’Obernai, et maréchal des logis chef aux hussards rhénans. L’homme passa, frôlant l’arbre derrière lequel se cachait M. Ulrich ; l’ombre de son corps et de son cheval s’allongea sur les pieds de l’Alsacien et sur les mousses voisines ; une odeur de sueur et de harnais traînait en arrière. Au moment où il dépassait l’arbre, il tourna la tête, encore une fois, vers la droite. M. Ulrich regarda dans cette direction, qui était celle de la plus grande longueur de la hêtrée. À une trentaine de mètres plus loin, il découvrit, montant sur la même ligne, un second cavalier, puis un troisième, qui n’était déjà plus qu’une silhouette grise entre les colonnes, puis, à des mouvements d’ombre, plus loin encore, il devina d’autres soldats et d’autres chevaux qui escaladaient la montagne. Et soudain, il y eut un éclair dans les profondeurs du bois, comme si une luciole avait volé. C’était un ordre. Tous les hommes firent un à droite, et, se mettant en file, silencieux, sans un mot, continuèrent leur manœuvre mystérieuse.
Des ombres s’agitèrent encore un instant dans les profondeurs de la futaie ; le murmure des feuilles foulées et croulantes diminua ; puis il cessa tout à fait, et la nuit parut, de nouveau, inhabitée.
– Redoutable, dit à demi-voix M. Ulrich, redoutable adversaire, qui s’exerce jour et nuit ! Il y avait un officier, bien sûr, là-bas, dans le sentier. C’est vers lui qu’ils regardaient tous. Il a levé son sabre, clair sous la lune, et les plus proches l’ont vu. Tous ont tourné. Comme ils faisaient peu de bruit ! J’en aurais tout de même démoli deux, si nous avions été en guerre.
Puis, remarquant son chien qui le regardait, tranquille à présent, le museau levé et remuant la queue :
– Oui, oui, ils sont partis… Tu ne les aimes pas plus que moi…
Il attendit, pour reprendre sa route, qu’il fût certain que les hussards ne reviendraient pas de son côté. Il n’aimait pas la rencontre des soldats allemands. Il en souffrait dans sa fierté ombrageuse de vaincu, dans sa fidélité à la France, dans son amour qui craignait toujours une guerre nouvelle, une guerre dont il avait vu avec étonnement la date reculer et reculer toujours. Il lui arrivait de faire de longs détours pour éviter une troupe en marche sur les routes. Pourquoi ces hussards étaient-ils venus troubler sa descente à Alsheim ? Encore des manœuvres, encore la pensée de l’Ouest qu’ils ont tenace, là-bas ; encore la bête carnassière qui rôde, souple, agile, au sommet des Vosges, et qui regarde si elle doit descendre…
M. Ulrich dévalait la hêtrée, baissant la tête, l’esprit tout plein de souvenirs tristes qui revivaient pour un mot, pour moins encore, car hélas ! ils avaient, mêlée avec eux et prompte à se relever du passé, toute la jeunesse de cet homme… Il évitait, lui aussi, de faire du bruit, tenait son chien derrière lui et ne le caressait pas, quand la brave bête frottait son museau contre la main pendante de son maître, pour dire : « Qu’avez-vous donc, puisqu’ils sont partis ? » En un quart d’heure, par le chemin plus large qu’il retrouva au bout de la hêtrée, M. Ulrich gagna la lisière de la forêt. Une brise plus froide et plus vive courait dans les tailles de chênes et de noisetiers qui bordaient la plaine. Il s’arrêta, écouta à droite, et, mécontent, leva les épaules en disant :
– C’est comme ça qu’ils reviendront ! Personne ne les aura entendus ! Pour l’instant, oublions-les, et allons dire bonjour à Jean Oberlé !
M. Ulrich descendit un dernier raidillon. Quelques pas encore, et les écrans de baliveaux et de broussailles qui cachaient l’espace furent franchis. Le ciel entier se dévoila et, en dessous, devant, à gauche, à droite, quelque chose d’un bleu plus doux et plus brumeux, qui était la terre d’Alsace. L’odeur des guérets et des herbes mouillées par la rosée se levait du sol comme une moisson de la nuit. Le vent la poussait, le vent froid, passant familier de cette plaine, compagnon vagabond du Rhin. On ne pouvait distinguer aucun détail dans l’ombre où dormait l’Alsace, si ce n’est, à quelques centaines de mètres, des lignes de toits ramassés et pressés autour d’un clocher gris, tout rond d’abord et terminé en pointe. C’était le village d’Alsheim. M. Ulrich se hâta, retrouva bientôt le cours du torrent, devenu un ruisseau rapide, qu’il avait côtoyé dans la montagne, le suivit, et vit se dégager, haute et massive, dans son parc d’arbres dépouillés par l’hiver, la première maison d’Alsheim, celle des Oberlé.
Elle était bâtie à droite de la route, dont elle était séparée d’abord par un mur blanc, puis par le ruisseau qui traversait le domaine sur plus de deux cents mètres de longueur, fournissant d’abord l’eau nécessaire aux machines, et coulant ensuite, agrandi et dirigé savamment, parmi les arbres, jusqu’à la sortie. M. Ulrich franchit la large grille en fer forgé qui ouvrait sur la route, puis le pont, et, passant devant le petit chalet du concierge, laiss...