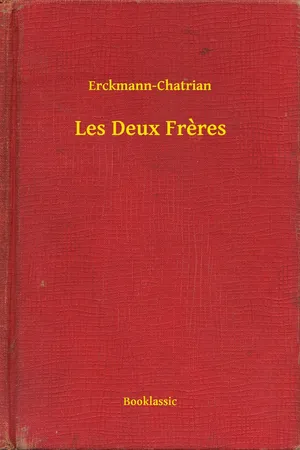À quelques lieues au-dessus de la Maladrie, en
remontant la Sarre, vous trouvez, dans une gorge paisible des
Vosges, le petit village des Chaumes. Une centaine de maisonnettes
hautes, basses, couvertes de bardeaux ou de vieilles tuiles grises,
bordent la rivière. De loin en loin un petit pont la traverse, avec
ses deux perches où les enfants se penchent pour regarder le
fourmillement des ablettes au soleil, autour d’un vermisseau, le
mouvement des grandes herbes appelées queues de chat, et le passage
des canards qui remontent le courant, en allongeant derrière eux
leurs larges pattes jaunes. Ils sont là durant des heures, les
cheveux ébouriffés, le pantalon et la veste déchirés, le petit sac
d’école à sa ficelle sur la hanche, car le village a son école,
mais jamais ils ne se pressent d’y aller. Puis c’est une femme qui
passe en jupon, les pieds nus, le cuveau de sapin sur la tête,
rempli de linge : Marie-Jeanne ou Catherinette vont au lavoir.
Après cela des bœufs et des chèvres défilent ; le vieux
Minique, sa pioche sur l’épaule et la tête penchée, va détourner
l’eau sur son pré ; M. le curé, la soutane relevée et son
tricorne à la main, se dépêche d’aller dire la messe ; ainsi
de suite !
Tout cela se voit de loin, dans la grande
prairie verdoyante, au milieu des palissades et des haies vives des
jardinets, où pend la lessive des ménages.
À gauche, s’élève la colline, avec ses orges,
ses avoines, ses champs de seigle et de pommes de terre, ses vieux
pommiers tout noueux, déjetés et penchés par le vent.
Depuis cinquante ans que j’habite les Chaumes,
je n’ai jamais pu décider les propriétaires à redresser leurs
arbres ; les trois quarts ne veulent connaître ni la taille ni
la greffe, et laissent tout pousser à la grâce de Dieu. Cela fait
du fruit bien aigre, mais ils s’en contentent !
Cette culture monte à la lisière des bois,
qui, le soir couvrent champs, vergers, village et rivière de leur
ombre. Il ne reste qu’une bande de lumière sur les prés ; elle
diminue toujours et finit par disparaître à la nuit.
C’est l’heure où les troupeaux rentrent, où la
corne du hardier chante, où chèvres et pourceaux courent dans le
village chercher leur logis ; ils ne se trompent jamais de
porte, et grognent ou bêlent d’une voix plaintive, jusqu’à ce qu’on
vienne leur ouvrir.
Ce bruit s’éteint à son tour.
On n’entend plus dans la vallée que le doux
murmure des crapauds, le long de la rivière, et la grande voix
traînante des grenouilles au milieu du silence.
Alors les petites lumières sont allumées dans
les baraques. On soupe, on se repose de la journée. En deux ou
trois endroits commence la veillée ; et la vieille église
compte les heures du bavardage, jusqu’au moment où les bonnes
femmes avec leurs rouets, les filles avec leur broderie et leur
tricot retournent dormir à la maison.
Voilà le village des Chaumes.
Plus loin, à deux ou trois cents pas, se
trouvent les moulins du père Lazare, où l’eau tombe en franges
comme un cristal des vieilles roues moussues, et, plus loin encore,
sous bois, dans la gorge étroite, les scieries de Frentselle et du
Gros-Sapin.
Lorsque je reçus ma nomination d’instituteur
aux Chaumes, M. Fortier en était le maire et M. Rigaud,
aubergiste Au Pied de Bœuf, l’adjoint ; mais les deux
frères Rantzau jouissaient d’une grande influence par leur richesse
et gouvernaient en quelque sorte le conseil municipal. Le vieux
Rantzau, leur père, mort deux ou trois ans avant, avait été
cultivateur, marchand de bois et de salin. Il avait gagné de
l’argent ; ensuite il était mort, comme nous mourrons tous,
laissant ses biens à sa fille Catherine, mariée avec Louis Picot,
brasseur à Lutzelbourg, et à ses deux fils, Jean et Jacques, qui
malheureusement ne trouvaient pas tous les deux le partage à leur
convenance.
C’est du moins ce qui parut alors, car eux,
qui s’aimaient du vivant de leur père, qui se soutenaient contre
tous, et qui s’étaient mariés en même temps avec les deux filles du
vieux juge de paix Lefèvre, depuis ce moment-là se détestaient et
ne pouvaient plus se voir.
Jean, l’aîné, était un grand gaillard chauve,
rempli d’orgueil et de l’amour des biens de la terre. Par son
testament le père lui donnait la maison hors part, d’abord comme
étant l’aîné de la famille, ensuite pour l’avoir soutenu de son
travail. Ce partage était injuste, car si Jean avait aidé le père
dans sa culture et son commerce de salin, Jacques ne lui avait pas
été moins utile pour l’exploitation des coupes.
On ne connaissait pas de plus grande maison au
pays que celle du vieux Rantzau, avec hangars, jardin sur la
rivière, des écuries pour quinze pièces de gros bétail et des
granges pour entasser foin, paille, fourrages de toute sorte,
autant qu’il en faut pour toute l’année.
En outre, belles caves, distillerie et
buanderie, enfin une maison superbe, recrépite à neuf et les volets
peints en vert.
Jean était content. Il trouvait tout naturel
d’avoir la maison du père ; mais cet article du testament ne
plaisait pas à Jacques, qui fit bâtir aussitôt une maison en face
de l’autre, séparée seulement par la rue, hangar contre hangar,
grange contre grange, écuries contre écuries, portes contre portes,
fenêtres contre fenêtres, avec une place semblable pour le fumier,
le fagotage et le bois. – C’était une déclaration de guerre !
Jean le comprit. Mais ce qui l’ennuya bien plus, c’est que trois
mois après Jacques acheta le grand pré de Guîsi, le plus beau pré
du vallon, et qu’il le paya comptant douze mille francs, ce qui ne
s’était jamais vu et ne se reverra sans doute jamais aux
Chaumes.
Jean, en apprenant cela, devint tout
pâle ; il ne dit rien, car les Rantzau sont trop fiers pour
crier contre leur propre famille ; mais les deux frères, l’un
en face de l’autre, forcés de se voir vingt fois tous les jours, ne
s’adressaient plus la parole. Ils allaient et venaient, sans avoir
l’air de se connaître. La femme de Jean venait de mettre au monde
une petite fille, celle de Jacques un garçon. Tout le village et la
vallée se partageaient entre ces deux hommes, donnant raison ou
tort à Jacques ou à Jean, chacun selon ses intérêts.
C’est dans cet état que je trouvai le pays,
sous le règne de Louis XVIII, lorsque je vins remplacer aux Chaumes
l’ancien instituteur Labadie, hors de service à cause de son grand
âge, et que j’épousai sa fille unique Marie-Anne, à laquelle je
dois tout le bonheur de ma vie depuis cinquante ans et qui m’a
donné de braves enfants.
Le beau-père et moi nous continuâmes de vivre
ensemble au logement de la maison d’école ; il m’aidait encore
quelquefois dans mon travail, et me prodiguait les meilleurs
conseils.
« Ne vous mêlez jamais des affaires du
village, Florence, me disait-il ; n’entrez dans aucune
querelle particulière ; tâchez d’être bien avec tout le monde.
Remplissez vos devoirs à l’école, à l’église, à la mairie, avec
zèle, et respectez ceux qui peuvent vous donner des ordres. Cela ne
vous empêchera pas d’avoir votre opinion sur tout, mais n’en dites
rien. De cette manière vous pourrez vivre en paix et faire quelque
bien autour de vous. »
Ainsi parlait cet excellent homme. Il me
raconta la haine terrible que se portaient les frères Rantzau, me
recommandant pour eux, encore plus que pour tous les autres, d’être
prudent ; recommandation d’autant plus sage, que les enfants
de Jean et de Jacques devaient tôt ou tard venir à mon école, et
que la moindre préférence marquée pour l’un ou pour l’autre pouvait
me faire le plus grand tort.
Ces premières années où le jeune homme quitte
son pays et va chercher fortune ailleurs sont les plus pénibles de
la vie ; heureux celui qui trouve un bon conseiller, il évite
souvent des fautes irréparables. Moi, je n’ai pas eu de regrets par
la suite, ayant toujours écouté les conseils de la prudence, et ces
premiers temps me reviennent avec plaisir.
Quelle différence entre la plaine, que je
quittais, et la montagne où je me trouvais alors ! Mon vieux
maître de Dieuze en Lorraine, homme instruit pour l’époque, m’avait
donné le goût des choses naturelles, l’amour des plantes et des
insectes, il m’avait appris le peu de musique qu’il savait. Combien
ces premières études me furent utiles !… Combien elles
servirent à me faire prendre en patience le travail souvent ingrat
de l’école !… Tous les soirs, aussitôt après la classe, je
passais la bretelle de mon petit herbier sur l’épaule, et je
grimpais le sentier de la côte. Les grands genêts en fleur, les
bruyères roses, les mille plantes sauvages attachées aux
rochers ; les mouches dorées, argentées, couvertes de velours
sombre ou de soie éclatante, qui s’élevaient à chaque pas et
produisaient aux derniers rayons du jour, un bourdonnement immense,
toutes ces choses me remplissaient le cœur d’attendrissement.
J’allais, je choisissais ; n’ayant pas
grande science, je croyais toujours faire quelque découverte. Et
puis en haut, contre les ruines du vieux château, où les ronces et
le vieux lierre de cent ans tout flétri s’étendent sous les jeunes
couches vivaces, je m’arrêtais, regardant la vallée calme et
paisible, la rivière miroitante, les petits toits à la file,
l’église, la maison de cure avec sa gloriette et son rucher, le
moulin, les scieries lointaines déjà dans l’ombre, et ce spectacle
me faisait rêver… Je me disais :
« Voilà le coin du monde où tu vas passer
ton existence. Regarde ! C’est ici que tu dois rendre service
à tes semblables, élever les enfants que Dieu te donnera, et puis
te reposer dans la paix du Seigneur. Travaille, étudie… Qui sait si
parmi les élèves assis sur les bancs de ton école, en guenilles et
les pieds nus, pauvres ignorants, presque abandonnés comme les
sauvageons de la forêt, qui sait s’il ne se trouvera pas un homme
utile, bienfaisant et même remarquable par ses lumières ? Car
le Seigneur ne regarde pas aux conditions, il sème partout le bon
grain. Tâche de suivre son exemple ! Beaucoup de tes leçons
tomberont dans les ronces, beaucoup sur le rocher ; mais
pourvu qu’une seule graine utile tombe dans la bonne terre, tu
seras heureux. »
Ainsi venait le soir.
Alors je redescendais lentement la côte,
songeant aux nouvelles plantes que j’avais recueillies, aux
nouveaux insectes que j’avais piqués sur mon chapeau, et tâchant de
les classer, non d’après la science, je n’avais pas assez de savoir
ni de livres pour cela, mais d’après les familles de plantes et les
appellations du pays.
Le beau-père, qui m’attendait sur la porte, en
me voyant revenir à la nuit close s’écriait :
« Vous êtes en retard, Florence ;
Marie-Anne a la table mise depuis une heure, la soupe ne sera plus
chaude. »
Il riait.
« Hé ! monsieur Labadie, lui
disais-je, que voulez-vous ? On trouve tant de belles choses
dans vos montagnes !… c’est une vraie bénédiction.
– Allons, montons, montons ! »
faisait-il de bonne humeur.
Ma femme était là, souriante. On
soupait ; on causait, je parlais de botanique et le beau-père
s’écriait :
« Oui, je comprends cela ! De mon
temps c’était affaire de grands savants. Nous autres, dans nos
montagnes, nous n’entendions parler de M. de Billion, de
Linné, de Jussieu que par hasard. Ah ! que nous aurions
pourtant été bien placés pour étudier l’herbage des Vosges et
rendre aux savants de vrais services ; mais on ne pensait pas
à nous, et toute la science des plantes, qui devrait être répandue
jusqu’au fond des hameaux, est dans les bibliothèques des grandes
villes. »
Il s’égayait, non sans conserver un regret des
belles années perdues au milieu de toutes ces richesses.
Après cela, son amour à lui, c’était la
musique !… Nous avions un petit clavecin de quatre octaves
dans la salle à manger et, la nuit venue, les volets fermés, le
père Labadie s’asseyait dans son fauteuil de cuir, ses larges pieds
sur les pédales et ses mains osseuses sur les touches noires,
jouant des requiem, des alleluia, des in
excelsis, accompagnant le plain-chant qu’il se figurait
entendre, et se balançant, les yeux en l’air, avec un véritable
attendrissement. Il possédait une caisse pleine de vieilleries
d’anciens maîtres allemands, qu’il élevait jusqu’aux nues, et tout
le pays savait que le père Labadie, des Chaumes, était le premier
organiste parmi les catholiques. Les luthériens en ont beaucoup de
bons, ils s’adonnent à la musique et s’en font un grand honneur. Je
n’espérais pas devenir jamais aussi fort que le beau-père ;
mais grâce à ses bonnes leçons, j’en sus bientôt autant que Letcher
de Dâbo, ce qui suffisait pour tenir l’orgue, même dans les
occasions solennelles, comme les jours de confirmation, en présence
de Mgr de Forbin-Janson, l’évêque de notre diocèse.